FRANÇAIX Jean

« L’art doux et urbain de Jean Françaix communique d’emblée sa fraîcheur de séduction et son intelligence de style assurée. Ses qualités lui ont attaché des générations successives de musiciens et de mélomanes, depuis l’apparition de premières partitions de maturité de Françaix, autour de 1931-32, alors même que sa composition la plus ancienne – une pièce pour piano seul intitulée Pour Jacqueline, remonte à 1918, quand il n’avait que six ans. Sa disparition en 1997, à l’âge de 85 ans, a fauché la scène musicale contemporaine d’un de ses maîtres les plus instantanément captivants. »
Robert Matthew-Walker, extrait du texte du livret du disque Hypérion, 2002
« Parmi les compositeurs qui approchent aujourd’hui de la maturité de l’âge et du talent, Jean Françaix est peut-être le seul que l’on sente à l’aise dans son temps, dans son œuvre et, pour ainsi parler dans sa peau. En lui le don, la science et la conscience font aussi naturellement bon ménage qu’en Joseph Haydn, modèle si grandement enviable et si rarement envié du génie disponible et du bonheur quotidien. Combien de musiciens de ce temps (je pense, en particulier, à nos jeunes Prix de Rome) ont acquis les moyens de cette heureuse disponibilité et ne savent qu’en faire dans un monde qui achève de perdre son unité de conscience : que de paroles perdues, que de temps gâché à poursuivre l’impossible à travers l’inutile, à s’interroger sur ce qu’il faut faire quand l’art vit de “comment” et meurt de ses “pourquoi” ! »
Roland-Manuel, Revue Combat, 30-31 Mars 1947
Jean Françaix, MUSICIENS FRANÇAIS no 11
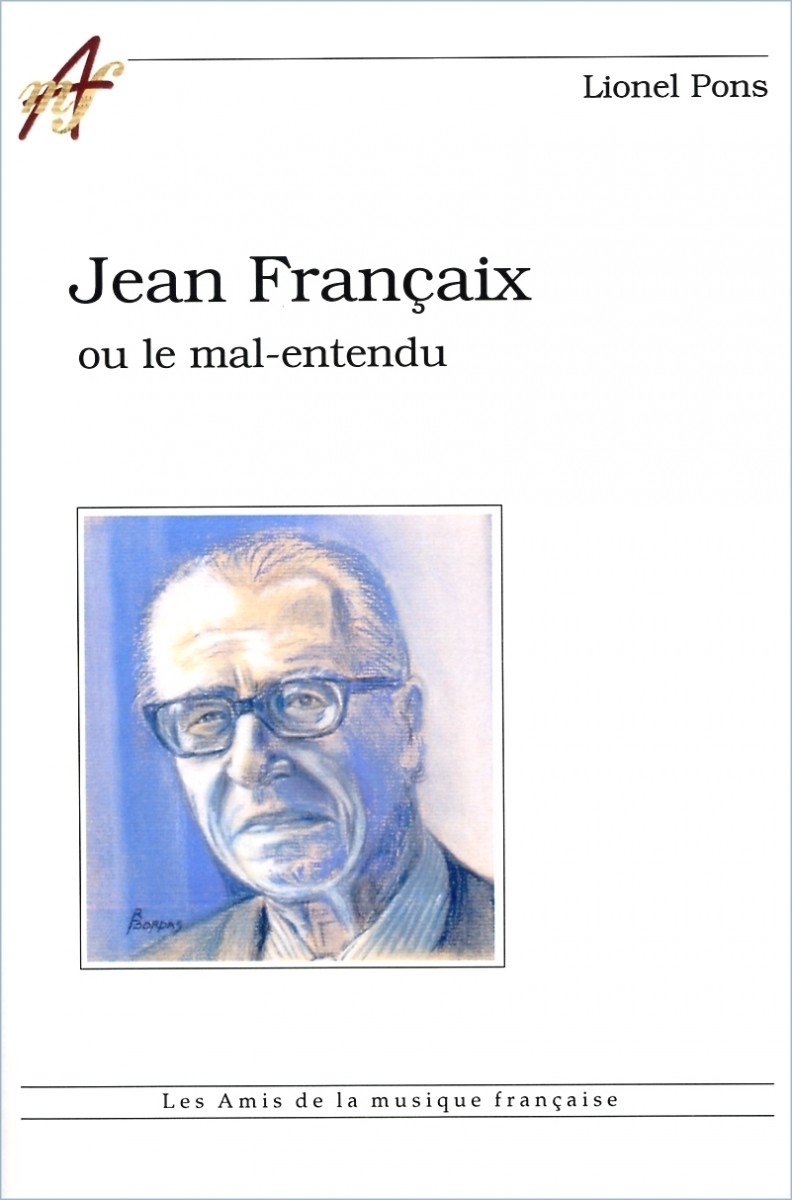
Dossiers
INTRODUCTION
Jean Alain JOUBERT
22, 25 & 27 août 2006
Les médias annonçaient, ce 25 septembre 1997, la disparition du compositeur Jean Françaix. Un événement inattendu : l’homme était brillant, actif et alerte bien que né en 1912. Quelques jours auparavant, le 10 septembre, le décès de Jacques Leguerney, remarquable mélodiste né en 1906, m’avait déjà attristé.
Quand l’artiste disparaît demeure l’œuvre. Créateur prolixe, Jean Françaix nous laisse un catalogue de plus de deux cents œuvres d’une éblouissante diversité ; il se fit le devoir, doublé d’un évident plaisir, d’explorer tous les domaines de l’art musical. Son langage reste tonal tout en parcourant maints chemins de traverse. Son inspiration symbolise l’éclosion d’un éternel printemps, fertile de digressions : champêtres, enfantines, amusées ou amoureuses. De la vraie musique de gémeaux, faite de symétrie, de netteté, de logique, d’harmonie, de tempérance confiante en la destinée qui, il est vrai, lui fut souriante de bonne heure. Le 1er janvier 1923, Ravel adressait à son père Alfred, qui l’avait interrogé sur les dispositions musicales de son fils, une lettre dans laquelle il soulignait que la curiosité de l’enfant s’avérait être un des dons les plus féconds que l’on puisse souhaiter chez un créateur. Curiosité et intuition resteront les clefs de son univers créatif. Par l’entremise d’une compositrice très oubliée aujourd’hui et qui fut l’une des très proches amies de jeunesse de Krishnamurti, Marcelle de Manziarly, il fut présenté à la grande Nadia Boulanger qui, dès lors, veilla attentivement sur lui sans pouvoir le détourner de sa prédilection pour la liberté. L’enfance est en fête la vie durant chez les natifs du premier décan des gémeaux, qui n’ont point la fougue virevoltante de ceux du troisième qui vit naître Offenbach. Chez ces derniers, le vertige ressemble à une fuite en avant. Chez Jean Françaix au contraire, il y a du gourmet, de l’esthète, du fin lettré, du poète bucolique et bien sûr du charmeur. « J’aime l’allure poétique, à sauts et à gambades » convenait-il avec Michel de Montaigne. Vif, subtil et rapide, il est insaisissable comme l’air qui le symbolise. Tous les enfermements lui sont étrangers, comme une atteinte à l’essence même de la vie et de l’intelligence. Si nous cherchions à lui dessiner un arbre généalogique musical, nous y trouverions Haydn, Mozart, Schubert, Chabrier, Poulenc… Son humour était d’une vivacité propre à faire reculer de lourds fantassins nombrilistes ; j’ai encore en tête le souvenir de termes crus et bien envoyés d’une lettre reçue avec ravissement par Ludovic Florin. Ces « éternels enfants » peuvent aussi, comme l’enfant Mozart, animés par une dualité lune et soleil, blanc et noir… descendre dans la profondeur, la densité. Qui le contesterait à l’écoute de l’oratorio l’Apocalypse selon saint Jean ou de l’opéra La Main de gloire ?
En effet, Jean Françaix, comme presque tous les musiciens que nous avons déjà illustrés, eut à affronter les grands conflits musicaux du XXe siècle et à les subir. Il était et continue à être peu joué en France. La terreur maligne qu’imposa un certain « confiscador » ne peut qu’offenser… « par un manque d’humilité qui est sans exemple depuis que la vanité, la publicité et le paraître servent de colonnes au temple1 ».
Aussi, lorsque Lionel Pons me fit le récit de la visite de Jacques Françaix dans l’officine marseillaise, je fus assuré de savoir que l’artiste allait être défendu avec éloquence, conviction, respect et passion. Et lorsqu’on estime notre patrimoine si lamentablement abandonné, le verbe d’un tel avocat s’inscrit en victoire sur le vaste tableau de l’ignorance, de l’inculture que génère une société avide, robotisée et hébétée.
Avec force et gravité, selon sa manière d’être, il entreprit ce travail, travail souvent éclairé par ce fils attentif. Ils s’attachèrent tous deux à mettre de la lumière sur les points d’écueils ou incertains, donnant des précisions qui valent mieux que les ombres malsaines de la suspicion, fait à mettre à l’honneur de Jacques Françaix, particulièrement engagé dans ce travail, acceptant de plus — ce qui n’est pas coutume — de rédiger la préface de cet opuscule. Son texte d’une grande beauté, témoignage d’un fils sur un père et un musicien, évoque un artiste fondamentalement humain, une résurgence de gentilhomme du XVIIe siècle égaré en notre temps et un disciple de Montaigne pour la conduite de sa propre vie. Notre association ne peut que se louer d’un tel investissement, surtout lorsqu’il s’avère d’une aussi rare qualité.
Publier dans ce livret un texte de Roland-Manuel est un honneur, une fierté. Ce compositeur doté d’un vrai talent s’est toujours cependant voulu au service des autres musiciens, aussi bien dans ses écrits que sur les ondes de la Radio nationale. Certains s’en souviennent encore avec émotion. Roland-Manuel, en effet, nous a tous précédés dans l’exemplaire travail de défense du patrimoine musical. Quelle admirable approche de l’Apocalypse selon saint Jean signait-il là, dans la revue Combat.
La passion éclairée de Lionel Pons sur notre patrimoine musical le met aux antipodes de ce qui se dit, oraisons des bien-pensants — autrement dit de ceux qui ne pensent pas, ne colportant que les idées reçues (la maladie d’Alzheimer une fois venue ne les prive donc d’aucune liberté… douce consolation à leurs vies entièrement vouées au culte d’une idéale et reposante vacuité intellectuelle !). Certains, cependant, reconnaîtront en ces poncifs des braiments d’âne2, ce qui les rend donc préférables au silence, à l’indifférence que notre société cultive aujourd’hui avec succès et on se demande même, il se peut, avec maligne intention (abêtir pour mieux assujettir !). Le compositeur dira lui-même avec toute sa fine ironie : « La Nature est variée à l’infinie dans ses imaginations : je voudrais que ma musique le soit aussi, tour à tour riante ou sérieuse, mais jamais ennuyeuse. Ce faisant, je sais que ma fameuse force me pousse à contre-courant, le genre ennuyeux étant fort répandu dans les concerts : j’en demande pardon aux connaisseurs postés aux carrefours importants, d’où ils gouvernent l’opinion des mélomanes. »
Idée reçue que celle qui professe qu’il n’y a pas de véritables compositeurs français, postulat qui d’ailleurs avait été émis par le vieux Brahms et qu’un de nos très oubliés compositeurs eut l’insigne joie d’ouïr, alors qu’il tentait d’obtenir audience auprès du monumental et quelque peu grincheux maître germanique !
Nous n’en croyons rien et nous professerons tout le contraire de ce qui s’assimile à notre avis à une sordide et crasse ignorance. L’art français existe bel et bien et connaît toujours à l’étranger un renom et un attrait dont Jean Françaix reste un des plus éminents fleurons. Jacques Françaix nous fait part de la notoriété du compositeur hors nos frontières.
Jean Françaix s’exprimait sur l’une de ses œuvres — et nous pensons pouvoir le généraliser à toutes — de poétique façon : « Il y a beaucoup de notes […] ; mais la pensée générale en reste claire et j’ai soigneusement compté les gouttes de cette pluie ». Heinrich Strobel écrivait lors de l’exécution, au Festival de musique de chambre de Baden-Baden, du Concertino pour piano et orchestre : « Après tant de musique problématique ou inauthentique, ce Concertino fut comme de l’eau fraîche qui jaillit de la source avec la spontanéité gracieuse de tout ce qui est naturel, et en même temps, comme la création d’un artiste doué d’une lucidité et d’une conscience rares de nos jours. » Aujourd’hui, en écoutant la musique de Jean Françaix, ayons à l’esprit, sauf à être très attentifs à cet univers de cristalline et ondoyante intuition, ces mots de Michel de Montaigne : « Mon métier et mon art, c’est vivre ». Et cette musique est intelligemment et humainement vivante. Pour être l’expression d’un homme libre, telle celle de Mozart, elle s’impose universelle, enchanteresse, indispensable. Il n’existe pas d’Art véritable et digne de ce nom sans cette liberté fondamentale affranchie de toutes les conventions, de tous les dogmes, de toutes les règles qu’imposent — et pour cause ! — ceux qui nous gouvernent en toutes choses pour être si tristement privés d’intuition et de génie. Entendre la musique de Jean Françaix revient à se libérer du connu, du conventionnel, de l’ennuyeux pour se délecter des harmonies de l’inédit !
_____________________
PRÉFACE
C’est avec un réel plaisir que j’ai accepté de rédiger la préface de l’ouvrage, relativement modeste par ses dimensions, mais remarquable sur le fond, que Lionel Pons a consacré à Jean Françaix, mon père. Sa connaissance en profondeur d’un catalogue d’environ deux cent trente œuvres est absolument confondante, et la seule aide que j’ai pu lui apporter a été de lui fournir quelques enregistrements difficiles à trouver en dehors des archives familiales.
Car si beaucoup d’interprètes connaissent bien les oeuvres concernant leur instrument, ils n’ont généralement pas le temps d’entreprendre des investigations plus larges. Quant aux chefs d’orchestres qui auraient la possibilité de faire connaître le répertoire symphonique, mélodique ou lyrique, il leur est souvent difficile de s’affranchir de toutes sortes de contraintes, ne serait-ce que celle d’un certain conformisme des responsables des programmes de concerts (tributaires, à leur décharge, de considérations extra-musicales). Soulignons toutefois qu’il n’en a pas toujours été ainsi et que la liste des grands chefs qui ont dirigé ses oeuvres jusque dans les années soixante-dix est impressionnante (de Paul Paray à Karajan en passant par Charles Münch ou Seiji Ozawa), quelques rescapés, comme Georges Prêtre, ayant tenu bon jusqu’au début des années quatre-vingt dix1.
Les écrits biographiques ou musicographiques sont par ailleurs peu nombreux2 et aucun, à ma connaissance, n’a abordé l’ensemble du catalogue. L’étude réalisée par Lionel Pons apparaît donc comme particulièrement bienvenue et nous serions heureux s’il pouvait la développer encore par la suite.
Elle commence en soulignant le paradoxe d’un compositeur très joué dans le monde et dont le nom est pourtant inconnu de la plupart des mélomanes. Dans les années quatre-vingt, beaucoup ont été étonnés d’apprendre, par une indiscrétion d’un hebdomadaire français s’appuyant sur des données (pourtant confidentielles) de la SACEM, qu’à cette époque Jean Françaix était le compositeur français vivant le plus joué à l’étranger. A notre connaissance, huit ans après sa disparition, et sans le moindre tapage médiatique, son audience internationale n’a pas baissé. Peut-être n’est-il pas inutile de rappeler, à ce propos, les étapes d’une carrière de compositeur hors du commun.
Sa première oeuvre, Pour Jacqueline, est publiée par les éditions Sénart dès sa onzième année. Il n’a que vingt-et-un ans quand les éditions Schott lui proposent d’éditer sa musique, avec une option sur tout ce qu’il composera. Il n’accepte qu’après trois courriers de cette maison, aucune proposition ne lui étant faite dans son pays.
Par la suite, toutes ses oeuvres seront éditées et exécutées, en général dans l’année suivant leur composition, par les plus grands interprètes. A titre d’exemple, son Trio à cordes, composé en 1932, est rapidement enregistré par Jasha Haifetz, Grégor Piatigorski et Joseph de Pasquale. Le célèbre Trio Pasquier, qui en est le dédicataire, le jouera plus de 1500 fois. Cette oeuvre, ainsi qu’un certain nombre d’autres telles que le Quintette à vent no1, le Concerto pour clarinette ou l’ Horloge de Flore, pour hautbois et orchestre, sont considérées à ce jour comme des classiques respectifs de leur genre. Ses pages de musique de chambre sont constamment jouées et la quasi totalité en a été enregistrée, certaines à de multiples reprises.
Et pourtant, depuis deux ou trois décennies, ses compositions orchestrales et symphoniques (celles qui font la notoriété publique d’un compositeur) sont de moins en moins programmées3 au point que beaucoup de musiciens ignorent jusqu’à leur existence. C’est ainsi que, depuis au moins dix années, les deux orchestres de la Radio française (Orchestre National de France et Orchestre Pilharmonique de Radio France) n’ont, à ma connaissance, programmé aucune de ses œuvres, ce qui est proprement incroyable compte tenu de son audience internationale.
De son côté, la critique officielle ne sort le plus souvent de son silence que pour dénigrer un compositeur qu’elle taxe de légèreté et auquel elle va jusqu’à reprocher le plaisir que procure sa musique, ce qui demeurait pourtant ‟l’humble but” de Debussy.
Lionel Pons analyse ces critiques avec beaucoup de finesse et d’autant plus de compétence qu’il a réellement pris le temps d’écouter la musique dont il parle. Cela ne va pas toujours de soi, comme on serait en droit de le penser et, à titre d’exemple, je citerai seulement les propos d’un critique parlant, à propos d’un enregistrement de la musique du ballet Scuola di ballo (dans sa version pour deux pianos), de « variations assez insipides » sur un thème de Boccherini. Or, de variations sur un thème donné il n’est pas question dans cette oeuvre, composée sur différents thèmes de ce compositeur que Jean Françaix a orchestrés et assemblés, à la demande de son futur éditeur Schott (et que Darius Milhaud lui-même avait pourtant trouvée tout à fait à son goût à l’époque de ses premières représentations en 1933). On en déduira, sans a priori, que le critique en question a jugé l’œuvre sans l’avoir écoutée, ce qui n’est pas très… fair-play.
Le résultat de cette situation est que Jean Françaix n’est jamais cité, dans son pays, comme un compositeur qui compte (contrairement à l’opinion qui prévaut à l’étranger) et qu’une grande partie du public mélomane va jusqu’à ignorer son nom. Ajoutons que sa disparition en 1997 a été littéralement escamotée.
Je n’oublierai pas un fait dont j’ai été le témoin à Nice, il y a quelques mois seulement et qui illustre bien l’évolution que je viens de décrire. On jouait, de mon père, et à l’initiative du Trio Chaudière4, le Divertissement pour Trio à cordes et orchestre. Avant d’exécuter l’œuvre, le chef s’adressa au public pour lui demander si quelqu’un dans la salle avait entendu parler de Jean Françaix. Le silence qui suivit montra éloquemment à quel point la mise à l’écart de Jean Françaix du milieu musical français avait, si l’on peut dire, porté ses fruits. Car, à l’origine, la première représentation de cette oeuvre avait été donnée avec le concours du célèbre Trio Pasquier sous la direction du non moins célèbre Paul Paray.
Pourquoi cette situation, que l’on est bien en droit de considérer comme une véritable mise à l’index, et dont le compositeur a souffert au point d’écrire un jour : « Je vis en exil dans mon propre pays, ravitaillé par l’étranger » ? Pourquoi ce silence qui, pour un musicien est la pire des punitions et dont Pascal lui-même, pour en avoir été la victime à une époque de sa vie, disait qu’il était la pire des persécutions? La clé de cette question tient peut-être dans ce mot d’un journaliste canadien terminant une interview du musicien : « Jean Françaix, vous êtes incontrôlable », et il ajouta : « je vous en suis très reconnaissant et je vous remercie ».
Car si la musique de Jean Françaix est aussi claire et authentique, c’est qu’elle est l’expression d’un homme qui, dans son art, a refusé tous les compromis qui auraient pu, en lui faisant renier ses convictions, le faire rentrer dans le giron des modes musicales de son temps. Chacun sait que le prix à payer pour conserver sa liberté, dans les sociétés humaines, est toujours très élevé : à une époque où la musique n’adoucit plus les mœurs, ce prix a été celui du mépris, du dénigrement, voire de la diffamation, et finalement, du silence.
Est-ce une consolation de savoir que bien d’autres musiciens ont subi le même sort, à commencer par Franz Liszt qui, devant les attaques dont il était l’objet, en était arrivé à conseiller à ses élèves de ne pas dire qu’il était leur professeur, afin de ne pas nuire à leur carrière ? Des génies comme Stravinsky et Prokofiev, dits ‟néoclassiques”, eussent peut-être connu le même destin s’ils étaient nés un peu plus tard. Francis Poulenc, de treize années l’aîné de Jean Françaix, semble avoir pu, lui, s’extraire de justesse d’un purgatoire post mortem (il y a curieusement, on l’a vu, des purgatoires ante mortem).
J’espère que l’on voudra bien m’excuser pour toutes ces considérations tellement étrangères à la musique elle-même, et dont j’assure le lecteur qu’elles ont été, pour cette raison, encore plus pénibles pour moi à écrire que pour lui à les lire. Et, puisque l’occasion m’en est donnée, à moi qui puis me vanter d’avoir bien connu mon père, j’aimerais dire quelques mots sur l’homme et le musicien que j’ai eu le privilège de côtoyer.
À toute personne qui désirerait connaître sa personnalité profonde, je dirais sans hésitation qu’il est inutile de lire sa biographie détaillée (cela tombe bien, elle n’existe pas), mais simplement d’écouter sa musique. Disant cela, je sais que j’agacerai prodigieusement les musicologues, mais c’est un fait qu’il se livrait infiniment plus dans sa musique que dans la vie. Mais j’ajouterai qu’il y faut plusieurs conditions: une interprétation fidèle à l’esprit de sa musique et une écoute attentive, l’écriture en étant extrêmement riche, variée et pleine d’imprévu. Que l’on dénie très souvent toute profondeur à sa musique (ce qui n’est heureusement pas l’avis de tout le monde) a toujours été pour moi incompréhensible. Et cet a priori peut avoir des conséquences fâcheuses dans la façon dont certains interprètes abordent ses œuvres : il m’est arrivé d’entendre des exécutions (dans les deux sens du terme) d’une légèreté tellement aérienne que la musique en était littéralement vidée de sa substance.
Car la réputation de légèreté que certains lui ont faite, au sens de superficialité, ne correspond aucunement à la réalité, ni de son personnage, ni donc de sa musique. Ses aspirations intellectuelles et spirituelles le tenaient en effet très éloigné des préoccupations matérialistes de notre époque, ce qui ne l’empêchait pas de s’intéresser de très près aux découvertes scientifiques les plus récentes. Il ignorait superbement les divertissements qui font l’essentiel de la vie d’une majorité d’entre nous car, en dehors de la lecture, qui en faisait un homme extrêmement cultivé, tout son temps était consacré à son activité de compositeur et de pianiste, le mot « vacances » étant pour lui sans signification.
Sa foi, qu’il mettait en application dans sa relation avec autrui, était profonde, comme en témoigne, musicalement, son oratorio L’Apocalypse selon Saint Jean, reconnu par beaucoup comme un chef-d’œuvre de la musique sacrée du XXe siècle5 et à propos duquel son professeur, Nadia Boulanger, écrivait (dans une lettre à Jeanne Françaix, mère du compositeur) : « j’ai toujours su que votre fils était marqué du signe de Dieu ». Alors que cette œuvre de vastes proportions ait été enregistrée pour la première fois en Autriche en 19976, (trois mois après la mort du compositeur, et quarante-huit ans après sa composition) et en France en 19997, je n’ai pas connaissance que l’un de ces disques ait été, depuis, diffusé une seule fois sur une chaîne radiophonique française.
Quelle belle occasion manquée, pour ceux qui ne supportent pas sa légèreté et son humour, de se réjouir enfin de constater que Jean Françaix fut capable de sortir de ses « enfantillages » pour s’élever vers des sommets qu’ils fréquentent eux-mêmes assidûment ! Peut-être auront-ils un jour l’occasion de se rattraper à l’écoute de son opéra La Princesse de Clèves, oeuvre dont le sujet ne déchaîne pas l’hilarité, et représentée, pour la première et la dernière fois en France, au Théâtre de Rouen en 1965. Mais quand ? Peut-être entre deux représentations de Fifi ou du Chanteur de Mexico…
Je pense que l’on ne verra pas, dans les lignes qui précèdent, le portrait d’un homme superficiel. Toutes ces dispositions auraient même pu en faire quelqu’un d’austère, voire d’ennuyeux, s’il n’avait été doué d’une intelligence très vive lui permettant de porter sur les choses et sur lui-même un regard perpétuellement critique et distancié, d’où un humour en permanente activité. Il avait une façon extrêmement originale et personnelle de considérer les choses les plus banales et possédait, en outre, un talent épistolaire et une imagination qui lui permettaient d’écrire des lettres extrêmement drôles sur les sujets les plus communs de l’existence.
Comme beaucoup d’artistes, il avait conservé un côté enfantin qui, chez lui, contrastait avec une certaine tendance au pessimisme. C’était aussi un homme bon, hypersensible et sans défense devant les coups bas de l’existence.
Tout cela se retrouve bien sûr dans sa musique qui, en particulier, reflète parfaitement certaines contradictions apparentes : la joie et le bonheur qu’elle procure sont d’autant plus profonds qu’ils sont l’expression d’une réaction contre la mélancolie ou la tristesse. Car ces sentiments, que certains considèrent comme plutôt négatifs, alors que d’autres y voient un signe de grande profondeur, sont bien présents dans sa musique, très souvent d’une façon sous-jacente ; ils peuvent surgir au moment où l’on s’y attend le moins comme, précisément, dans le dernier mouvement du Divertissement pour trio à cordes et orchestre (Finale prestissimo), où un tempo endiablé est interrompu par un passage dont la mélancolie est d’autant plus frappante qu’elle est tout à fait imprévisible. Peut-on mieux faire comprendre, sans insister pesamment, que l’on est pas dupe de sa propre gaieté ?
Cette opinion est, bien sûr, toute personnelle et, ne voulant pas être taxé d’apologie filiale, je voudrais préciser qu’il ne s’agit aucunement, dans ces lignes, d’exprimer une admiration béate et sans réserve sur l’homme ou sur le musicien, et ceci pour la raison bien simple que mon père, lui-même, avait l’humilité de ne s’attribuer aucun mérite personnel dans les dons musicaux qu’il avait reçus. Il se considérait seulement comme une sorte de médium et, si admiration il devait y avoir, ce serait pour le travail acharné qu’il a déployé afin de ne pas dilapider ces dons. Quant au résultat de ces efforts continus, j’aimerais, à ce propos, et pour en terminer, livrer un témoignage dont on pourra d’autant moins suspecter la complaisance qu’il émane d’un autre compositeur, le regretté Pierre-Petit.
Cet extrait de l’allocution qu’il prononça lors de la remise du Grand Prix de la SACD attribué à Jean Françaix en 1983, m’apparaît comme un résumé idéal de ce que l’on peut dire de sa musique, replacée dans son temps :
Avec un nom comme le sien, et puisqu’on dit que personne n’est prophète en son pays, il est tout naturel que la gloire de Jean Françaix ait tout d’abord été une gloire européenne. Et, de fait, c’est outre-Rhin que, très tôt, cet éblouissant élève de la grande Nadia Boulanger – notre voisine… – a conquis ses premiers lauriers. Il incarnait en effet, avec une sorte de perfection, toutes les qualités que l’on se complaît à reconnaître à nos compatriotes.
La grâce et l’humour, la clarté et la pudeur, la tendresse et l’intelligence, tout cela se retrouvait, bien avant la dernière guerre, dans des œuvres qui constituaient déjà le plus exact et le plus flatteur des portraits que nous puissions souhaiter de notre propre héritage. (…)
Peu importe que le style de Jean Françaix ne s’inscrive point dans les sentiers parfois tortueux de l’avant-garde : il est, il se veut le continuateur d’une lignée qui, après Debussy et Ravel, ne s’encombre point de partis pris, et entend poursuivre sans tourner la tête une trajectoire lumineuse, réconfortante – et heureuse. Je crois d’ailleurs que c’est là le mot qui définit le mieux la musique de Jean Françaix : le bonheur. Même lorsqu’il s’attaque à des sujets graves ou même austères, il réussit, selon son propre mot, à « faire de la musique sérieuse sans gravité ». Il nous ouvre alors des horizons souvent profonds, parfois sévères, mais il réussit toujours, en même temps, à nous rassurer, et à préserver, au moment même où nous pourrions les mettre en doute, les raisons que nous avons de croire en la vie. C’est cela, une musique heureuse : c’est cela, le secret du bonheur que nous dispense à chaque instant la musique de Jean Françaix.
_____________________
JEAN FRANÇAIX OU LE MAL-ENTENDU
Musicien des paradoxes, image (ou même parangon, si la plume est mal intentionnée et, le concernant, elle l’est souvent) d’une certaine musique française tout aussi agréable que suspecte par le plaisir que l’on peut prendre à l’écouter, célèbre et inconnu à la fois, Jean Françaix continue de susciter intérêt et questions, sans pourtant que son œuvre ne profite, aujourd’hui encore, d’une lecture propre à lui reconnaître ses qualités intrinsèques. Pourtant, après avoir fait de lui le compositeur français le plus joué dans le monde de son vivant, l’œuvre de Jean Françaix échappe au purgatoire qui suit malheureusement presque toujours le départ d’un compositeur. Enregistrements et concerts se succèdent, donnant un large aperçu de la diversité de son œuvre, l’une des plus abondantes de son temps. D’où vient, dès lors, que Françaix reste si mal connu ? Sur quoi peut se baser cette assimilation, si vite opérée, au statut de charmant petit maître, d’une musique « ravissante » (avec ce que l’adjectif peut sous-entendre de dubitatif), mais dont la quête de plaisir, parfois avouée, signifie du même coup l’absence de profondeur, voire l’inutilité ?
Les préjugés ont la vie dure et en musique, plus que dans tout autre domaine, nul n’est prophète en son pays : alors même que de nombreux interprètes sont fidèles à une œuvre et un compositeur dont ils connaissent la richesse et la profondeur, Jean Françaix continue, tant dans les écrits musicologiques que dans les colonnes de la presse dite spécialisée, de figurer une sorte de survivance, un marquis poudré à frimas, tant il est commode qu’une musique, et plus largement une œuvre d’art, ne soit que ce qu’elle paraît être. Or justement, l’œuvre vaste et diverse de Jean Françaix a quelque chose de cet Atlantide englouti, connue surtout pour l’infime part qui en demeure émergée. Combien, dès lors, de jugements faux ou hâtifs ont été émis sans que leurs auteurs n’aient visiblement entendu une seule note de La Princesse de Clèves (1961-1965), La Main de Gloire (1945) ou L’Apocalypse selon saint Jean (1939) !
Le présent travail ne saurait prétendre constituer une réhabilitation, en premier lieu parce que ceci dépasserait ses ambitions et ses limites, ensuite parce que, redisons-le, le compositeur reste présent dans les programmes de concert et que la musique de Jean Françaix reste son meilleur avocat, plaidant sa propre cause avec suffisamment de chaleur pour que public et interprètes lui rendent fréquemment hommage. Mais il peut raisonnablement espérer mettre en lumière des aspects plus secrets, moins connus de l’homme et de l’œuvre, lesquels contribueront à mieux cerner une personnalité riche, complexe et attachante, aussi éloignée que possible de l’image d’aimable ordonnateur de divertissements que l’on se plaît encore trop souvent à forger et à lui accoler.
Aucun domaine de création musicale n’a été dédaigné par Jean Françaix, de la musique de chambre aux ouvrages lyriques de vastes dimensions, en passant par la musique de ballet, la musique de film, les pièces pour piano (son instrument, qu’il a pratiqué toute sa vie en virtuose), les pièces pour orgue (moins nombreuses, mais toutes intéressantes), le répertoire symphonique comme le répertoire pour orchestre à cordes, corpus auquel il faut adjoindre quelque trente-neuf pages à caractère concertant pour quasiment tous les instruments (y compris les très rares tuba, trombone et accordéon de concert). Aussi, notre but ne saurait être de dresser un catalogue raisonné complet, lequel dépasserait, et de très loin, les possibilités du présent opuscule. Mais, aussi souvent que possible, nous ferons directement référence aux ouvrages susceptibles d’éclairer telle ou telle facette de sa réflexion.
L’HOMME, MIROIR ET RÉCEPTACLE DE L’ŒUVRE
Dire qu’une œuvre est toujours l’émanation directe d’une personnalité relève du lieu commun. Lorsque cette même personnalité reste dans l’ombre, en partie du fait d’une méconnaissance tenace, en partie du fait de la discrétion et de la pudeur de l’artiste, il n’est pas inutile d’en porter les axes principaux à la connaissance du lecteur et du mélomane curieux, ne serait-ce que pour tordre le cou à quelques idées reçues solidement ancrées.
Jean Françaix est (et cela n’a pas peu contribué à asseoir une image fausse de facilité jamais dépassée) un enfant assez exceptionnellement doué pour la musique, qui bénéficie, de surcroît, du climat favorable d’une famille largement ouverte au fait artistique (son père, Alfred Françaix, dirige pendant seize ans le conservatoire du Mans, dans lequel sa mère dispense des cours de chant). Peu à peu convaincu des dons manifestes du jeune garçon, son père n’hésite pas à adresser ses premiers essais compositionnels à Maurice Ravel qui, contre toute attente, répond à l’envoi, encourage et conseille le jeune Françaix. Après des études au conservatoire de sa ville natale, c’est à Paris que s’achève la formation du musicien avec un premier prix de piano obtenu à dix-huit ans et surtout le contact avec Nadia Boulanger. Celle-ci, professeur, entre autres, de Aaron Copland ou Walter Piston, se révèle une férule redoutable mais tout à fait profitable pour Jean Françaix, qui confiera bien plus tard, âgé de quatre-vingt ans : « Je crois, en fait, que toute mon œuvre lui est dédiée ». Rigueur architecturale, culte de la mélodie, goût pour une orchestration claire et pour le raffinement harmonique (qui doit justement beaucoup au Ravel du Concerto en sol et du Tombeau de Couperin) sont les lignes directrices que Nadia Boulanger saura exalter chez le jeune compositeur, pressentant que son talent s’épanouira pleinement dans ces directions. La création, en 1932, du Concertino pour piano et orchestre, sous sa direction avec le compositeur au clavier, signe le début d’un succès qui ne se démentira pas.
Dans cette courte page (une dizaine de minutes), Françaix se livre tel qu’en lui-même. L’ironie reste (et demeurera) un trait récurrent de son caractère. Mais il convient d’affiner ici notre propos : par ironie, il ne faut pas entendre une froideur glacée ou un rire grinçant. Toute sa vie, le compositeur fera référence à l’esprit de Molière et, de même que le dramaturge était capable, en créant les figures d’Harpagon ou de Tartuffe, de faire montre d’une profonde et sincère humanité, Jean Françaix ne dissociera jamais ironie et indulgence. Il en faut sans doute beaucoup pour aimer ce que l’on stigmatise et pour stigmatiser ce que l’on aime. Aussi, le sourire est-il omniprésent dans l’œuvre du musicien, même et surtout lorsqu’il vient se greffer sur la gravité. De là à conclure que la palette expressive et émotionnelle de Françaix se limite à ce sourire, il n’y a qu’un pas que nombre de musicographes ont allègrement franchi. Ne retenir que cette optique revient à ignorer délibérément que la vraie profondeur paraît toujours s’ignorer elle-même. Le sourire de Françaix lui permet souvent de rendre acceptables des messages assez durs (Offenbach n’a pas fait autre chose dans sa Vie Parisienne). Loin d’être la clef d’une superficialité qu’elle dément à chaque mesure, son ironie renvoie à celle de Voltaire : elle nie l’hypocrisie. C’est dire l’erreur que l’on fait en la taxant de complaisance. En effet, elle est la voie d’accès vers une dimension introspective, même si une écoute superficielle peut nous la laisser totalement ignorée. Les figures évoquées dans les Anecdotes de Chamfort (1949) ou Juvenalia (1947), la situation de vaudeville évoquée dans L’Apostrophe (1940) ne sont que des miroirs que nous tend le compositeur, et dont le reflet brut nous serait insupportable. L’ironie n’est pas une arme, elle est le regard plein d’indulgence et de clairvoyance d’un homme sur son temps, indulgence qui s’exprime d’autant mieux par ce biais qu’elle est le corollaire de l’autre versant de la personnalité du musicien, à savoir la pudeur.
Jean Françaix se tient toujours à distance de l’emphase et de l’auto-complaisance qui consisterait à se projeter dans son œuvre avec trop d’évidence. S’il y a chez lui référence à la pensée ou la forme classique, c’est dans cette démarche de mise à distance qu’il nous faut la chercher. Françaix ne considère pas que l’art se doive d’être impersonnel ou insincère, et justement la condition lui semble en être le maintien de l’ouvrage en dehors du champ de la seule subjectivité. Faire de l’artiste sa propre œuvre, selon l’idéal hérité de la pensée romantique, peut revenir à la priver du pouvoir de communication qui doit être son élan vital premier. Pour être pleinement sincère, elle doit suggérer un sentiment plus que l’imposer de manière trop démonstrative, de telle façon qu’il ne soit pas uniquement celui du créateur, mais puisse être ressenti par tout un chacun. Là se situe le paradoxe de la musique de Jean Françaix, en partie à l’origine de sa méconnaissance. C’est précisément parce qu’elle se veut sincère et honnête (en ce sens qu’elle refuse toujours d’appuyer le trait, et s’adresse donc tout autant au cœur qu’à l’intellect) qu’elle est taxée d’indifférence par des auditeurs et des critiques peu attentifs. Dans Ma Mère l’Oye, Ravel se livre, sous couvert d’une musique enfantine, à une confession que sa pudeur ne rend que plus profonde et plus touchante, et c’est ce modèle que Françaix adopte dès ses premiers essais pour le conserver tout au long de sa vie créatrice. L’œuvre n’est pas et ne doit pas être l’artiste, elle doit en être le reflet, de telle façon qu’il y soit présent sans prendre le pas sur elle, et que l’auditeur puisse, à son tour, se projeter dans ce qu’il entend, pour peu que son écoute soit sincère et dénuée d’a priori. Aussi, fut-elle grave, sa musique ne sera jamais pesante de signification soulignée. Si elle fait appel au sourire, elle se garde de la bouffonnerie débridée pour se replier sur un humour dont la finesse n’a d’égale que l’acuité. A l’épanchement, il préférera le registre de la tendresse, dans laquelle son maître Ravel s’est souvent illustré avec tant de bonheur.
En dehors de ces traits de caractère, dont toute l’œuvre de Jean Françaix apparaît comme la résonance intime, il est un point particulier sur lequel il est nécessaire d’apporter la lumière, bien qu’il relève plus de la démarche biographique pure que de l’approche proprement musicale, nécessité commandée avant tout par le dénigrement systématique et injustifié dont le musicien continue de faire l’objet en France. Ses deux premiers grands succès sont attachés à deux ballets, à savoir Beach (1933) et Scuola di Ballo (1933), le second composé dans un délai de dix jours, qui lui valent immédiatement d’intégrer le groupe des musiciens défendus par les éditions Schott (qui détiennent et gravent toujours une majorité de ses œuvres). Le renom du jeune compositeur croît suffisamment vite pour que son nom figure parmi les plus représentatifs de la jeune musique française du moment. Aussi, lorsqu’au cœur des années sombres de l’Occupation, est envisagée la création de la section musicale du Groupe Collaboration (1941), Françaix commet l’erreur, qu’il a reconnue, d’avoir cédé aux propositions insistantes d’un de ses anciens professeurs, Max d’Ollonne, d’adhérer à ce comité au moment de sa constitution (aux côtés de plusieurs compositeurs de renom de l’époque, dont Alfred Bachelet ou Florent Schmitt qui, à la différence de Françaix, avait adhéré dès 1935 au Comité France-Allemagne). Cette adhésion ne venait donc aucunement d’une initiative de sa part. Pour être exact, et il le faut lorsqu’on fait référence à ces années lourdes d’implications, le compositeur n’a pas été un membre actif du groupe, ni jamais été présent à aucune réunion. Son nom n’est associé à aucun des actes de réunion du groupe. Cette « adhésion », reste strictement limitée à une signature lors de la constitution du groupe, mais Françaix n’a jamais participé, ni de cœur ni de fait, à aucune de ses activités, ainsi que l’attestent toutes les pièces du dossier conservé aux Archives Nationales. Le compositeur n’a, jusque-là et par la suite, manifesté aucune sympathie particulière pour les idéaux de l’Allemagne hitlérienne et, réalisant, avant même les premières réunions, qu’il ne partage pas les idées qui en font l’objet, il reprend ses distances et se retire au Mans. Aucun acte de collaboration n’a pu être reproché à Françaix, et s’il a fait l’objet de la publication d’un disque sous l’égide de la Direction des Beaux-Arts en 1941, notons que, parmi les compositeurs qui ont également fait l’objet de ce type d’édition discographique se détachent les noms de Claude Delvincourt, Olivier Messiaen, Maurice Duruflé, Jehan Alain ou Henry Barraud, ce qui signifie bien qu’elle pouvait concerner tous les compositeurs en activité, et non des sympathisants du mouvement collaborationniste. Tout au plus peut-on faire à Jean Françaix le reproche de ne pas avoir officiellement fait savoir qu’il se détachait officiellement du groupe, mais combien de ceux qui lui en ont fait le reproche par la suite en auraient eux-mêmes eu le courage ? Françaix n’a pas été un résistant éminent, c’est là un fait sur lequel il n’a jamais cherché à entretenir le mensonge. Mais, en dehors de personnalités comme Elsa Barraine, Louis Durey, Henry Barraud, Claude Delvincourt ou Jacques Ibert (qui, à défaut de résister, se démet officiellement dès 1940 de toute fonction officielle), peu de musiciens (comme peu de français) l’ont finalement été, et Françaix ne s’est pas plus avéré collaborateur actif qu’Henri Sauguet ou Georges Hugon. Les récits qui ont trait à son adhésion aux idées du troisième Reich relèvent purement de l’affabulation ou de la jalousie. De l’examen, à sa demande, de son dossier après la Libération, Jean Françaix est sorti complètement innocenté, notamment parce qu’il avait refusé de diriger, à l’usage de l’armée allemande, les concerts organisés pour les étudiants et ouvriers de la région du Mans, ce dont ses détracteurs ne se font jamais l’écho. Ce refus pourrait d’ailleurs être retenu comme un acte de résistance alors que certains ont été considérés comme résistants pour des faits moins convaincants. Continuer, comme c’est encore le cas, de l’accuser de collaboration pour un fait dont il a été innocenté par Le Comité d’épuration, relève donc de la diffamation. L’attitude de Francis Poulenc, membre à la fois du Comité Cortot et du Front National des Musiciens, ne lui vaudra, en revanche, pas d’inquiétudes (en partie du fait de la composition de la cantate Figure Humaine, en 1943, sur des poèmes de Paul Éluard, dont le compositeur a notablement enjolivé les circonstances de composition). Françaix a simplement été un homme en ces années sombres, avec ce que cela suppose de cœur mais aussi d’erreur. Faire de lui un pseudo-emblème de la collaboration est un argument dont la facilité (le compositeur n’étant plus là pour se défendre) le dispute à la mauvaise foi : la bonne conscience de la France d’aujourd’hui ne saurait, en toute probité, s’acheter sur le compte de celle de 1940. Notons en complément, qu’avant même le début des hostilités, Jean Françaix et son éditeur Schott , pressentant le conflit à venir, décidèrent de cesser toute relation, Schott l’ayant alors adressé à son correspondant français, à savoir les éditions Max Eschig. Une fois la vague de barbarie passée, avec son tragique cortège d’existences brisées et de destins sacrifiés, Françaix considère comme un devoir de réintégrer son éditeur d’origine (plusieurs années après la Libération d’ailleurs). Cette fidélité sera vivement critiquée, alors même qu’elle n’est que l’expression de la rectitude du musicien, et qu’elle ne représente en rien l’expression d’un quelconque opportunisme (redisons que Françaix aurait très bien pu continuer à se voir publié chez Max Eschig, ou même par les Editions Boosey and Hawkes, qui l’avaient discrètement approché pendant le conflit!). D’où vient donc que Jean Françaix se voit toujours, fut-ce entre les lignes, accusé d’avoir accepté et défendu les idées les plus inavouables, quand la plupart de ses contemporains, pas plus ni moins impliqués que lui, ne se sont jamais retrouvés en butte aux mêmes affirmations ? Sans doute faut-il y voir un peu de jalousie de la part de collègues froissés du prompt succès du compositeur du Concertino pour piano et orchestre, et un peu de rapidité de la part de certains musicographes, les deux justifiant la digression que nous venons de nous permettre pour clarifier au préalable un point sans lequel l’appréciation de l’œuvre se trouve faussée.
Avant de pousser plus avant notre exploration des différentes facettes du talent de Françaix au travers des pages dans lesquelles il s’exprime, il nous faut nous pencher sur les fondements de son langage musical.
LES OUTILS D’UNE EXPRESSION
Nous l’avons dit, l’art de Jean Françaix n’est pas compatible avec une logique expérimentale qui l’éloignerait, tant soit peu, de sa vocation expressive. Aussi, s’il ne s’écarte pas de la logique tonale, ce n’est ni par dédain des autres possibilités qui s’offrent en son temps, ni par incapacité à comprendre ce qui peut motiver des voies et des modes de pensée éloignés du sien, mais tout simplement parce que, en toute lucidité, ces voies ne lui sont pas nécessaires. Le compositeur n’a jamais nié écrire une musique tonale, mais il faut nous entendre sur ce qu’est cette tonalité.
Il est certain que l’attachement à la conduite mélodique du discours, avec ce que cela suppose de souffle dans l’imagination, sous-entend et implique une pensée thématique, donc une échelle hiérarchique entre les sons. Mais, contrairement à ce qui pourra advenir sous la plume d’un Alexandre Tansman ou d’un Marcel Mihalovici, Françaix ne se replie pas vers une tonalité réduite à la survivance d’un unique pôle sonore, il conserve de la grammaire tonale l’expression privilégiée des degrés forts.
En choisissant de ne pas remettre en question les fondements d’un système en vigueur depuis plusieurs siècles dans la musique occidentale, le compositeur prend le risque de s’enfermer dans un langage impersonnel et épigonal. S’il n’en est rien, c’est qu’il se révèle novateur et reconnaissable dans l’usage qu’il fait du matériau bien plus que dans le choix du matériau lui-même. L’empreinte de Françaix peut être identifiée dès les premières mesures, au travers du sens harmonique très particulier qui est le sien. La franchise tonale de la conduite mélodique permet au compositeur d’introduire dans chaque accord quantité de notes étrangères qui viennent en enrichir la sonorité, sans pour autant en abolir la signification en terme de degré. La situation est exactement comparable à l’emploi de couleurs éloignées de la dominante perçue, lesquelles contribuent à la fois à l’affirmation et à l’irisation de cette même dominante dans une toile de Seurat1]. Ainsi, pour l’harmoniste curieux, la musique de Françaix peut supporter le chiffrage de degré, en aucun cas celui d’intervalle, la septième ou la neuvième d’espèce ne revêtant pas de fonction modale ou modulante. Le compositeur anticipe ce que sera notre perception auditive, allant parfois même jusqu’à ne pas faire figurer dans l’accord la note de basse fondamentale, que notre écoute va rétablir sans que nous en ayons conscience. Aussi la musique de Jean Françaix distille-t-elle constamment, y compris dans des pages de durée ou d’ambition modeste, une sensation de plénitude harmonique et de chatoiement qui la rend inimitable. La prééminence des pôles harmoniques forts n’y est pas, comme on pourrait s’y attendre, le corollaire d’une pauvreté lassante, bien au contraire, elle permet au musicien, que le mouvement soit rapide ou lent, d’intercaler entre ces chevilles des accords très éloignés du ton initial sans que ceux-ci prennent valeur de modulation. L’harmonie, telle que le compositeur la conçoit, peut donc être résumée par cette omniprésence de tournures cadentielles, quasi-naturelles pour notre oreille formée à la dynamique classique, mariée à une totale liberté dans l’agencement des complexes sonores et à la diversité de couleur qui en est la conséquence.
L’un des traits les plus saillants du langage de Jean Françaix, dérivant directement de cette facilité à varier la couleur de son propos, est son aptitude à la volubilité. Aucun compositeur français de son temps n’a, comme lui, possédé le génie de la construction de mouvements rapides (voire même souvent échevelés) dans lesquels la jonction du kaléidoscope harmonique et d’un fil mélodique en permanent renouvellement ne laisse pratiquement jamais à l’auditeur (et a fortiori aux interprètes !) le temps de reprendre haleine. Qu’il manie une formation de chambre (dans l’Allegrissimo du Trio pour violon, violoncelle et piano de 1986), un orchestre de chambre (dans la section Allegro assai du premier mouvement de la Symphonie d’Archets de 1948) ou un grand chœur mixte marié à une ample formation symphonique (dans le Ballet des Cauchemars d’Eustache au second acte de La Main de Gloire en 1945), la virtuosité de Françaix reste la même, traitant chaque pupitre en soliste potentiel et conjuguant toujours opulence harmonique et clarté totale du discours. Les pupitres de cordes sont, en particulier, l’objet de tous ses soins, avec une sollicitation constante de tous les modes de jeu possibles, y compris dans les lignes de contrebasses (auxquelles il confie souvent des séries de pizzicati ou des volées de doubles croches particulièrement virtuoses). Mais loin des canons de l’orchestration post-straussienne, les cordes ne sont pas utilisées alla fresco, chaque trait reste aussi bien réalisable en solo qu’en formation de pupitre, ce qui le situe bien dans une perspective française (que Chabrier, puis Ravel ont déjà illustrée avant lui). Et ce qui pourrait n’apparaître que comme une propension au bavardage est, au contraire, chez Françaix une capacité (fort rare, au demeurant chez les créateurs de sa génération) à bâtir un discours en perpétuel jaillissement.
Pour autant, en bon disciple de Nadia Boulanger, Françaix n’est pas l’homme de l’improvisation ; il garde le goût de la forme classique, y compris dans ce qu’elle peut sembler avoir de contraignant. À cela, il est possible de trouver une raison plus profonde (et plus conforme à la richesse de la personnalité en question) que la simple adhésion aux postulats d’un professeur, si brillant soit-il. Si l’imagination libérée se met, à travers le contexte harmonique, au service de l’expression, le recours à la forme joue le rôle de garde-fou, assumant cette nécessaire mise à distance dont nous avons parlé. Elle est en somme le garant de non-emphase, comme si l’expression ne pouvait prendre sa pleine valeur que passée au crible de cette catharsis (notons que, dans une optique éloignée, Schoenberg n’agit pas autrement dans sa Suite op. 25). Toutefois, le musicien reste extrêmement vigilant pour ce qui concerne le maintien de la forme dans ce rôle fermement dessiné et limité. Le risque, en effet, reste toujours grand de laisser le dessin formel se substituer à la motivation poétique. Aussi Françaix récuse-t-il la forme sonate, telle que la pratiquent encore les descendants de l’école franckiste et de l’enseignement de Vincent d’Indy. Elle peut donner lieu à des exercices de rhétorique pure qui le rebutent. Le moule de la suite, tel que pouvait le penser Couperin, convient mieux à la recherche de naturel qu’il conjugue avec la rigueur, et c’est ce moule qui a le plus souvent ses faveurs, même lorsque l’œuvre en question porte le titre de sonate (comme dans la Sonate pour piano de 1960).
Qu’elle soit vocale ou instrumentale, chambriste ou destinée aux plus larges effectifs (L’Apocalypse de saint Jean ne mobilise pas moins de quatre solistes vocaux, un grand chœur mixte, de grandes orgues et deux orchestres distincts), la musique de Jean Françaix refuse catégoriquement l’esthétique du minimum mise en œuvre par Erik Satie (dans son Socrate, entre autres), et après lui par Georges Auric dans la première tranche de son œuvre. La clarté est une chose, la simplicité n’en est pas forcément le complément logique. Nous l’avons dit, l’art du compositeur implique une richesse harmonique et mélodique qui n’est pas compatible avec l’idéal de renoncement drastique prôné par Cocteau dans Le Coq et l’Arlequin. En optant pour une opulence et une exigence technique clairement affichées, Françaix prend, dès ses premières œuvres, ses distances avec les tendances du Groupe des Six auquel on tend, trop souvent, à l’assimiler. La virtuosité n’est pas un simple défi posé à des techniciens, même lorsque l’œuvre s’inscrit dans une dynamique concertante et, contrairement à une idée couramment reçue, elle n’est ni gratuite ni le masque séduisant d’une confortable indifférence. Elle constitue simplement la réponse logique à l’abondance mélodico-harmonique sur laquelle repose le langage du compositeur, usant délibérément d’une palette d’autant plus large qu’elle s’inscrit beaucoup plus dans la nuance que dans la couleur trop franchement assénée.
Au-delà de cette virtuosité et de cette aptitude à la volubilité qui pourraient le faire passer pour un simple bavard, Françaix est l’homme des adagios de large amplitude dans lesquels se déploient de splendides cantilènes accompagnées. L’exemple du mouvement lent du Concerto pour deux harpes et orchestre à cordes (1978) est, en ce sens, tout à fait probant, dans le sillage du second mouvement du Concerto en sol de Maurice Ravel. Suspendant le temps, laissant de côté le rythme obstiné qui anime le Moderato initial, la rêverie mélancolique prend le dessus, et le voile de pudeur qui masque la confidence ne la rend que plus précieuse et plus parlante. C’est dans ces mouvements que s’épanche avec le plus de liberté l’élan mélodique du compositeur, d’autant plus qu’il opte souvent pour un accompagnement discret, basé sur des accords égrainés ou en nappes de tenues aux cordes. Le naturel n’est jamais, en art, synonyme de facilité, et tout compositeur connaît, pour l’avoir éprouvé, l’effort à fournir lorsqu’il cherche à construire une mélodie qui doit se suffire à elle-même, porter ses propres respirations et ses propres modulations. De fait, il faudra chercher dans l’amplitude de ces courbes mélodiques somptueuses la plus pure expression de la personnalité du compositeur, et l’un de ses aspects les plus attachants.
Le moment est venu, une fois brossé le cadre dans lequel elle prend place, de partir à la découverte d’une œuvre dont la variété comme l’abondance méritent bien plus que la méconnaissance, déjà préjudiciable, ou l’indifférence ignorante, toujours condamnable.
DU SOURIRE À LA DÉRISION
La sensibilité de Jean Françaix opère un phénomène permanent d’aller-retour entre un humour apparent et une gravité qui ne se montre presque jamais à visage découvert, mais n’en est pas moins présente et profonde. C’est dire que cet humour se déploie dans un registre qui va du sourire simple, sans arrière-pensée, avec un goût de « bonheur dans le pré » et d’indulgence pour les « frères humains » du compositeur, jusqu’à la dérision sarcastique, chère à Prokofiev et Chostakovitch, que le musicien pratique couramment.
Françaix n’aime pas pratiquer un comique débridé qui pourrait, d’une part, nuire à la distance qui doit rester établie entre ses sentiments propres et son œuvre et qui, d’autre part, viendrait en oblitérer le sens profond. C’est bien d’humour dont il nous faut parler, avec tout ce que cela sous-entend d’implications et de clins d’œil que le public doit saisir sans qu’ils soient appuyés ni même clairement exprimés. Ainsi en va-t-il des Cinq Portraits de jeunes filles (1936) pour piano, dans lesquels le jeune compositeur croque cinq archétypes de l’Éternel Féminin. S’en détachent, en particulier, La Capricieuse, qui ouvre le cycle sur une fantaisie en mi majeur, caractérisée par un dessin rythmique heurté (qui témoigne de l’exigence technique et de la précision de l’écriture pianistique du compositeur), La Pensive (quatrième pièce), tout en arpèges mystérieux sur fond d’accords régulièrement égrainés et La Moderne (dernière pièce), véritable feu d’artifice d’invention, bourré d’allusions au jazz et aux rythmes de danses venus d’outre-Atlantique. Loin d’être une simple œuvre de jeunesse, les Cinq Portraits de jeunes filles présentent un résumé complet de cette pratique du sourire qui restera celle de Jean Françaix, de cette capacité à garder une confiance qui ne soit pas simple naïveté.
La Dame dans la Lune (1957-1958), ballet en treize épisodes composé pour la compagnie dirigée par Roland Petit, se situe dans la même optique. Le compositeur y réutilise partiellement le matériau musical mis en œuvre dans la musique du film Si Paris nous était conté, réalisé par Sacha Guitry2. Dès la première section, le ton est donné : s’y trouvent juxtaposées une rapide toccata (basée sur une oscillation de la ligne de basse entre second, cinquième puis premier et cinquième degré, en alternance régulière par groupe de deux mesures, selon un procédé que le compositeur affectionne particulièrement) et une marche humoristique, servie par un bel élan mélodique (mais dont la ligne de basse se présente comme une augmentation rythmique de celle de la toccata qui précède). Il s’agit bien de divertir, de « faire rire les honnêtes gens » selon le mot de Molière3, mais sans sacrifier jamais le raffinement ni la sophistication des moyens mis en œuvre. Ainsi, malgré le choix de se restreindre à des oscillations de basse fondamentale sur des degrés forts (l’emploi du second degré doit être lu et compris comme une alternative du quatrième), le jeu constant des appoggiatures (souvent non résolues), des notes étrangères, du chatoiement harmonique place bien cette Dame dans la Lune dans la tradition (qu’il faut faire remonter à Chabrier) d’une musique française, dans laquelle la relation entre légèreté et profondeur, entre aisance apparente et complexité des moyens se nourrit d’échanges constants, l’une se trouvant toujours au service de l’autre.
Ceci dit, l’assimilation de la musique de Jean Françaix à la simple réalisation d’un divertissement, fut-il raffiné à l’extrême, et qui se priverait par-là de toute volonté de prétendre à une autre dimension que celle d’un plaisir immédiat et limité dans le temps, ne nous engagerait pas à un examen plus approfondi de son œuvre et de son langage. L’humour du compositeur n’est, le plus souvent, que le paravent d’une mise face à face du public avec ses propres travers. Selon un mode de pensée qu’avant lui Offenbach, Chabrier ou Terrasse ont adopté et expérimenté, la critique gagne à se voiler de sourire, perdant en acidité ce qu’elle gagne en intemporalité. Lorsqu’il compose Les Zigues de Mars (1950), petit ballet militaire en hommage à Courteline, conçu pour Paul Bonneau et son orchestre radiophonique, Françaix se livre à une caricature du monde des armes que son humour ne prive pas d’efficacité. Citons, en particulier, le savoureux pas redoublé qui ouvre l’œuvre avec Monsieur le Général de Cavalerie Machin (servi par une magistrale et virtuose utilisation des cuivres), Pitou et la Nourrice aux champs, véritable musique de kiosque, séduisante et enlevée, en forme de fausse déclaration d’amour (et plus encore, si l’imagination de l’auditeur veut bien, comme dans certains tableaux de Boucher, imaginer le pire sous des voiles anodins…) et surtout l’échevelé Retour des Réservistes, dans lequel le musicien épingle les petites lâchetés dont chacun de nous peut se rendre coupable.
C’est dans le registre de l’étude de caractère que le compositeur déploie le plus de virtuosité. Moderne La Bruyère, Françaix aime à croquer la société de son temps en stigmatisant tel ou tel archétype. L’une de ses plus attachantes réussites en ce domaine reste le cycle des Huit Anecdotes de Chamfort (1949), recueil de mélodies dédié à Roland-Manuel et créé par le baryton Pierre Bernac avec Francis Poulenc au piano. Avec une justesse de touche lapidaire (ce que renforce encore la brièveté des textes et des pièces), le musicien pointe du doigt quelques figures éternelles. L’Évêque d’Autun, énorme et plein d’une onction toute prélatique, est campé par une juxtaposition régulière d’accords charnus faussement solennels. Les Coups de pied généreusement distribués par l’Abbé Dubois au régent Philippe d’Orléans (à sa demande, et pour parfaire un déguisement) le sont sur un croisement entre menuet et valse sarcastique, cependant que Le Chanoine Recupero, perspicace et indulgent, devance la confession un peu osée qui lui est faite, en suivant une déclamation qui épouse au plus près les inflexions (un peu indignées !) de la voix parlée que le piano souligne d’un rire discret. En moins de dix minutes, le compositeur enlève huit tableaux de mœurs, dont chacun possède sa propre couleur, son propre agencement et sa propre individualité. Ce cycle reste l’une des pages les plus achevées et les plus représentatives du compositeur, et l’on peut déplorer qu’elle ne figure pas au répertoire de plus de chanteurs français.
Juvenalia, scènes de la Rome antique d’après les Satires de Juvénal, pour quatre solistes vocaux et piano à quatre mains (1947), se pare, dans le même registre, des séductions de la polyphonie. Le texte se présente comme une galerie de portraits urbains, mais enchâssée au sein d’une forme continue4 (incluant une savoureuse évocation des embarras d’une Rome qui semble beaucoup devoir à Paris, et qui se présente comme un trait d’union avec l’art d’un Janequin mettant en scène Les Cris de Paris). Françaix fait œuvre de metteur en scène, parvenant malgré l’absence d’instruments autres que le piano, à varier à l’infini les couleurs, passant sans rupture d’un climat à l’autre (la musique venant apporter au texte l’unité qui, sans elle, lui ferait défaut), avant que le thème initial (conçu dans un ton de sol majeur incluant plusieurs degrés altérés) ne vienne refermer l’œuvre. L’effectif inhabituel, les exigences techniques imposées tant aux chanteurs (le langage du musicien requérant toujours la capacité à projeter le texte, y compris dans un tempo rapide, alors même que les différents protagonistes expriment des sentiments opposés) qu’aux pianistes, dont la partie reste chargée, donnent à cette page un relief tout particulier dans le catalogue du compositeur.
Dans un sentiment très proche sera conçu Paris à nous deux ou le nouveau Rastignac, opéra-comique en 1 acte pour trois personnages, chœur et quatre saxophones (1954). Françaix y traite, sur le mode du sourire, la rupture qui sera celle des années cinquante entre référence tonale et sérialisme intégral (en même temps qu’il se livre à une caricature au vitriol de l’ambiance des salons parisiens). Si le débat peut, aujourd’hui, sembler quelque peu dépassé, tant l’expérience a prouvé, s’il en était besoin, que toutes les tendances étaient à même de susciter des chefs-d’œuvre, il n’en allait pas ainsi dans les années d’immédiate après-guerre. Souvent pris pour cible, étendard brandi malgré lui dans une querelle à laquelle il se sentait foncièrement étranger (ayant très tôt forgé un langage personnel, un idiome reconnaissable, et ne sentant nullement le besoin de le remettre en question), Jean Françaix préfère, encore une fois, le recours à une ironie mordante et spirituelle plutôt qu’à un article de presse agressif. Le héros de ce nouveau Rastignac déclare, dès le début de l’ouvrage, sa ferme volonté de conquérir Paris, ce à quoi il est d’autant plus prédisposé qu’il n’est doué d’aucun talent particulier. Ses interlocuteurs vont donc, avec lui, s’enquérir du domaine dans lequel il est le plus susceptible de s’illustrer et, après réflexion, la musique s’impose. Voici donc notre apprenti compositeur à succès reçu dans le salon d’une hôtesse babillarde, enthousiaste et stupide à souhait (au point de confondre le moment où les instrumentistes s’accordent avec le cours du morceau !). Le propos reste léger, mais la charge sérieuse contre l’attitude qui consiste à approuver ou condamner une œuvre sans l’entendre, ou pire, sans l’écouter. En restreignant l’instrumentarium à la famille des quatre saxophones, le compositeur se prive du chatoiement propre à l’orchestre, mais il opère, du même coup, un recentrage autour du texte et un choix précis de conditions de représentation. Il reste difficile d’imaginer l’ouvrage sur une vaste scène ou dans une grande salle dont les dimensions la submergeraient. Le musicien veut réellement faire « adresse au public », et il est clair que Paris à nous deux n’est pas, à proprement parler, une œuvre scénique (peu importe la représentation qui en est faite), c’est dans l’accord texte/musique que cet opéra bouffe se réalise pleinement. Vivacité du ton, extrême virtuosité du discours, capacité de varier à l’infini les climats sans que l’unité d’ensemble (plus stylistique que thématique) ne soit jamais sacrifiée, en sont les traits les plus saillants. Notons que la savoureuse marche finale « Vive le fameux Dupont, l’apôtre du rayonnement français ! » emprunte exactement le matériau musical de la scène associée à Benjamin Franklin (sans association d’idée du musicien !) dans Si Versailles m’était conté.
Avant même ce pamphlet plein d’esprit, Françaix était déjà venu à l’opéra de chambre, mais avec un effectif plus conséquent (cordes, harpe, percussions, bois et cuivres par un, à l’exception du tuba) dans Le Diable boiteux (1937). Le livret en est tiré par le compositeur du roman de Le Sage et mobilise deux protagonistes, en l’occurrence le narrateur et hidalgo Don Cléophas Zambullo et un démon prisonnier d’une bouteille que l’imprudent délivre au début de l’œuvre. En récompense du service rendu, Zambullo se voit convié à une promenade nocturne au-dessus des toits de la ville, lesquels, à l’instigation du démon, se soulèvent pour révéler les secrets des habitants. C’est donc à une galerie de caractères que nous convie le musicien, l’élément fantastique n’étant pas, contrairement à ce qui sera le cas dans La Main de Gloire, un moteur principal de l’ouvrage. Ici encore, pour qu’aucune parcelle du texte ne soit perdue, Françaix fait montre d’une extrême précision de l’écriture, exigeant de ses interprètes vocaux la plus grande ductilité et une diction sans faille, en même temps qu’il s’attache à concevoir son orchestre comme une mosaïque sans cesse changeante de textures chambristes finement ouvragées. L’évocation du mystère de la nuit et des opportunités galantes qu’elle offre en filigrane, au début de l’œuvre, est une magistrale réussite, pleine de raffinement harmonique, et à laquelle Françaix parvient, sans jamais lui faire perdre son caractère, à lui faire jouer le rôle d’une véritable ouverture, puisqu’elle présente, enchâssés brièvement dans la polyphonie, plusieurs des thèmes qui fonderont la texture musicale de l’ouvrage. Son handicap physique n’a pas empêché Le Diable boiteux de faire le tour du monde et d’être plusieurs fois enregistré. Hugues Cuénod reste le plus grand interprète du rôle du démon, qu’il a chanté de nombreuses fois, souvent en compagnie de la basse Doda Conrad, avec une fantaisie et une justesse de ton difficiles à égaler. Cet opéra, dont la durée totale n’excède pas une demi-heure, reste un miracle de cohérence musicale et esthétique, et l’une des plus pures réussites du musicien. Comme en écho à cette page, toujours pour Hugues Cuénod et Doda Conrad, Françaix compose, en 1978, la Cantate des Vieillards, pour deux solistes vocaux et orchestre à cordes, d’après Guy de Maupassant. Plus de démon révélateur, mais toujours beaucoup d’ironie et de subtilité dans cet ouvrage (dont les dimensions sont tout à fait comparables au Diable boiteux, et qui en formerait le complément de programme idéal). Le compositeur ne craint pas d’y prendre ses distances avec l’auteur des Contes de la Bécasse, en particulier lorsqu’il conclut la cantate par l’irrésistible évocation d’un congrès féministe. Moins connue que son diabolique devancier, la Cantate des Vieillards mérite beaucoup mieux que l’ignorance persistante dont elle est l’objet.
Toujours dans le registre de l’étude de caractère, la Cantate de Méphisto (1952), pour basse et orchestre à cordes, est composée d’après Mon Faust de Paul Valéry. Le choix de l’auteur de Monsieur Teste dans le cadre d’une cantate dont le ton dominant reste celui de l’humour peut surprendre, mais Françaix s’avère un parfait connaisseur de la pensée du poète (il mettra en musique en 1982 trois poèmes du même auteur pour chœur a capella, avec une profondeur et une densité de propos qui hissent sans conteste cet opus très peu connu, et sur lequel nous reviendrons, au rang des productions d’un Poulenc dans le même domaine). Notre Méphisto, pas plus que le diable de 1937, ne se révèle terrifiant. Il est bien plutôt, comme celui d’Hervé au siècle précédent dans Le Petit Faust, le témoin goguenard des travers humains, plus que le pourfendeur de toute bonté, ainsi que l’atteste la façon désinvolte dont il se présente au public. C’est encore Doda Conrad qui sera le créateur et l’interprète d’élection de cette page brillante, véritable vif-argent en musique dont l’alacrité même masque l’élaboration perceptible, en particulier, dans l’incroyable richesse des complexes sonores que le compositeur agence avec une patience d’orfèvre.
En 1952, le compositeur signe l’un de ses principaux chefs-d’œuvre, et sa première incursion dans le difficile univers du chœur a capella, avec l’Ode à la gastronomie pour seize voix mixtes. Inspiré de Brillat-Savarin5, le texte est une promenade à travers les méandres d’un appétit aiguisé et, conformément à ce que la « carte » annonce, le contenu musical est émaillé de citations (dont le Prélude en mi bémol majeur de Chopin), toujours en situation, et qui font de cette page un régal de gourmet. L’écriture fait montre d’un souci pointilliste du détail, n’utilisant que rarement l’éventail des seize voix, et se repliant le plus souvent sur des textures chambristes. La très haute qualité de facture de cette Ode à la gastronomie rend inexplicable son absence du programme des chœurs de chambre français qui s’honoreraient en la faisant entendre.
Toutefois, en dehors de ces œuvres souriantes, nous avons déjà exposé que la gravité sous-jacente du propos de Jean Françaix, qui préfère presque toujours le sourire à l’amertume, prend assez souvent (et contrairement à une idée reçue obstinément enracinée) le pas sur la vocation purement humoristique. Dès lors, il peut arriver que le sourire se fasse sarcastique, tant il est vrai que rire de tout est ce que l’on se force à faire lorsqu’on est près des larmes. Jean Françaix n’avait rien d’un optimiste béat, et ni la souffrance ni la barbarie ne l’ont trouvé indifférent. Il a simplement choisi d’y réagir avec une pudeur et un tact qui, bien malheureusement, n’étaient plus de son temps. De fait, c’est bien dans des ouvrages dont la vocation reste, en apparence, tout à fait légère qu’il nous faudra chercher l’expression de cette facette moins connue et pourtant révélatrice de sa personnalité.
Tel est le cas dans la comédie musicale en un acte L’Apostrophe (1940), d’après Honoré de Balzac. Cette œuvre atypique reste très peu connue, et sans doute la proximité du rire et du drame a-t-elle contribué à surprendre le public, plus habitué à des classifications tranchées. Si la dynamique de départ reste celle d’un vaudeville classique avec mari trompé et femme coquette et rouée, elle ne tarde pas à s’infléchir. La berceuse que l’héroïne, la Tâcherette, chante à son petit garçon endormi est un moment d’ineffable tendresse (dont la mélodie sera en partie réutilisée comme en filigrane dans le treizième des Quinze Portraits d’enfants de 1971) qui vient déjà indiquer clairement que la comédie n’exclut pas l’étendue de la gamme des sentiments. Mais la farce bascule peu à peu dans un drame dont les ficelles théâtrales, pour grosses qu’elles soient, ne doivent pas occulter le côté non comique. La grande force de la musique de Jean Françaix est précisément de ne pas avoir à changer de ton pour changer de registre, et c’est en cela qu’elle est susceptible de toucher chacun de nous. L’âme humaine est ainsi faite que la joie et la douleur, la profondeur et la légèreté s’y côtoient et s’y mélangent sans cesse, et la musique de Françaix constitue une passerelle entre ces deux pôles. Elle n’a pas besoin de s’appesantir sur le sort tragi-comique du fourbe Carandas, ni de forcer le trait, c’est dans son naturel qu’elle puise son pouvoir expressif. En ce sens, L’Apostrophe est un jalon essentiel dans l’œuvre de Jean Françaix6, qui montre combien l’humour est pour lui bien autre chose que l’aspiration à tout percevoir sous l’angle du divertissement.
Toutefois, dans son opéra La Main de Gloire (1945), cette perception tragique de la dérision s’exprime avec plus d’évidence encore. Tiré d’une nouvelle de Gérard de Nerval, le livret prend place dans le Paris de la Renaissance et fait une part importante à l’élément fantastique. Honnête artisan drapier, ayant épousé la très jolie fille de son ancien maître, Eustache se voit en butte au sans-gêne du neveu de celle-ci, Joseph, sorte de capitaine matamore, arquebusier de son état, dont le premier défaut consiste à confondre l’échoppe d’Eustache avec une hôtellerie. Peu aventureux de sa nature, notre artisan fait appel à la science magique de Maître Gonin qui jette un sort sur l’une de ses deux mains. Voilà notre Eustache vainqueur (presque malgré lui) en duel de l’indiscret Joseph. Mais les prouesses de la main ne s’arrêtent pas là : elle s’en prend au juge chargé d’examiner le cas du pauvre Eustache, puis au bourreau, entraînant la condamnation puis l’exécution du malheureux. Son rôle accompli, la main de gloire retourne à son propriétaire et rejoint, sous les yeux de la foule médusée, l’antre de Maître Gonin. Cet argument, entre ombre et lumière, offre un terrain propice à l’inspiration de Jean Françaix. Nous retrouvons, en effet, son humour virtuose dans le court prélude orchestral et la scène initiale entre le chœur et Maître Gonin (le passage dans lequel la foule se précipite pour savoir l’avenir est un exemple achevé d’écriture totalement maîtrisée), dans le trio entre le couple Eustache et l’importun cousin (« Vite, vite, allons dîner ») ainsi que dans le troisième tableau. Celui-ci, titré Les Cauchemars d’Eustache, est une scène qui ne s’inscrit pas dans la continuité dramatique, mais qui réserve un feu d’artifice imaginatif. Le chœur incarne des bouteilles qui se bousculent, puis des instruments qui finissent par interpeller directement le chef d’orchestre. Jamais Françaix n’a montré avec autant d’éclat et d’aisance, qu’au cours de ce quart d’heure enlevé dans un tempo endiablé sa capacité à concevoir de vastes édifices polyphoniques dont la densité n’égale que la clarté. Mais la tendresse est aussi largement présente, en particulier au début du deuxième acte, dans le duo Eustache/Javotte, et dans la scène de la prison où Eustache s’adresse à sa femme absente (l’un des plus beaux airs de ténor du répertoire). Et peu à peu, ainsi que dans une architecture romane, les grimaces de figures terrifiantes avoisinent la symbolique sacrée la plus haute, la farce devient tragédie. Lorsque, dans la scène finale, Eustache est mis à mort, le sourire se fige, et c’est à une danse infernale que nous convie un orchestre déchaîné que domine à peine le cri de Maître Gonin « Le mal triomphe, je suis vainqueur ». Au-delà de la référence au Méphistophélès (encore lui !) de La Damnation de Faust de Berlioz, il est impossible de ne pas voir dans ce tableau la métaphore de la consternation de Françaix face à l’effroyable carnage qui s’opère en Europe alors même qu’il compose l’œuvre, de ne pas comprendre la déception qui pouvait être celle de tout homme en face de la tragique capacité qu’il a à détruire l’autre. La Main de Gloire est tout sauf un simple fabliau dans la lignée du Roi d’Yvetôt (1927) de Jacques Ibert, car si elle est riche de résonances présentes, elle n’est pas non plus la fantaisie que se serait permis pour rire un créateur, entre deux œuvres à la gloire de la liberté (comme c’est le cas des Mamelles de Tirésias de Poulenc, entre Figure Humaine et Un Soir de neige), mais bel et bien l’un de ces précieux et rares moments où l’artiste exprime directement son inquiétude à travers ses personnages. Il est incompréhensible qu’une œuvre de cette richesse ne se soit pas durablement imposée au répertoire, tant elle représente un résumé de tout ce que peut véhiculer, en terme de sentiment, le genre lyrique. Voici plus de cinquante ans qu’aucun théâtre ne s’est penché sur le sort de cet ouvrage, et il est plus que regrettable que le public actuel n’ait pas de contact avec cette œuvre unique, à la fois séduisante et effrayante comme une gargouille médiévale.
Pour autant, et fut-elle dramatique, cette dimension de la dérision tragique n’est jamais antithétique de la notion de plaisir musical, ce plaisir dont le moment est venu de cerner mieux les modalités.
MUSIQUE POUR FAIRE PLAISIR
Il est un fait certain que l’évolution de l’art et de sa finalité, en regard du mouvement de l’histoire, pose clairement la question : peut-il et surtout doit-il chercher à se situer, même fugacement, même sous une dimension accessoire, dans une dynamique de plaisir ? Au regard du destin de l’Europe à la fin des années trente, la démarche d’inscription dans le pur plaisir de l’instant, qui demeure celle de tout un pan de la création artistique des années vingt, peut être lue non seulement comme une erreur, mais comme une provocation. En se situant dans la direction de l’axiome debussyste « La musique doit humblement chercher à faire plaisir », Jean Françaix assumait un choix qui prêtait et prête encore au malentendu, tant il devient dès lors facile de l’enfermer, sans l’entendre, dans le tiroir où se trouvent commodément rangés et classés tous les compositeurs ayant osé sacrifier aux délices d’un art hédoniste.
Si l’on prend la peine d’examiner plus attentivement les motivations du musicien et leur voie de réalisation, le problème apparaît sous un jour beaucoup plus nuancé. Permettre à l’art de faire humblement plaisir n’a jamais consisté, pas plus sous la plume de Debussy que sous celle de Françaix, à reconnaître son incapacité à s’exprimer dans des sphères plus élevées, et encore moins à autoriser implicitement qu’il puisse, en quelque manière que ce soit, s’avilir pour chercher à plaire. Faire plaisir n’est pas forcément synonyme d’attirance vers le bas, mais bien d’un souci de toucher l’auditeur, et la main tendue en ce sens ne déprécie ni l’œuvre, ni son créateur. En dynamitant les bases de la grammaire tonale, telle que le siècle la lui léguait, dans son Prélude à l’après-midi d’un faune, Debussy ne renonçait pas, bien au contraire, à exercer sur le public une séduction qui lui ouvre toutes grandes les portes de cet univers si personnel. En se faisant l’avocat de ce plaisir en musique, sans jamais accepter de déchoir sur le plan de la qualité d’écriture ou de l’architecture, Jean Françaix affiche, et ce dès le Concertino pour piano et orchestre (1933), une ligne de conduite esthétique dont il ne déviera pas et dont la probité (tenter de séduire le public en l’élevant, faire plaisir tout en développant sans cesse l’exigence) est on ne peut plus éloignée de cette insouciance dont on lui fait si souvent le reproche injustifié.
Dans Les Bosquets de Cythère (1946), suite de sept valses pour orchestre, le compositeur joue ouvertement la carte d’une référence à un plaisir immédiat et à un rythme connu. Et pourtant, ce petit cycle se hisse bien au-dessus de l’œuvre de circonstance. Françaix y prend lui-même un plaisir manifeste à décaler ce rythme, à le travestir, à le varier sans cesse, à le parer d’harmonies toujours changeantes et d’une incroyable richesse. Et si la sixième, La belle Damnée de chez Maxim’s, adopte résolument une courbe charmeuse qui, à défaut d’être noble, ne craint pas d’être sentimentale, le compositeur y démontre avec brio que, sans se renier jamais, une œuvre d’art peut trouver, en ce plaisir qu’elle suscite, sa propre justification.
Quoiqu’un certain nombre d’années les sépare, la cantate La Promenade à Versailles (1976) pour quatre voix d’hommes et onze instruments à cordes se rattache au même courant de pensée. Ni musique « à la manière de », ni acte de démonstration (Françaix y restera toujours réfractaire), l’auditeur se trouve convié à une profonde et souriante rêverie, sertie dans le somptueux écrin que constitue un orchestre à cordes ouvragé jusque dans ses moindres détails. En fait de parc de Versailles, c’est dans son propre imaginaire que chacun de nous peut se promener à l’écoute de ce quart d’heure comme dérobé à la réalité ; et cette forme de plaisir, lorsqu’elle est dispensée avec autant de sincérité, ne peut que contribuer à élever l’auditeur à la rencontre de lui-même. Méconnaître cette dimension première et essentielle de l’art de Françaix revient effectivement, pour qui l’entend mais ne l’écoute pas, à ne voir en lui qu’un musicien agréable ou, ce qui est pire, ravissant, mais en tout cas sans profondeur. L’évocation des grandes eaux est un moment d’intense poésie, superposant des batteries d’accords et des gammes chromatiques par mouvements contraires, cependant que les quatre voix, dans l’aigu de leur tessiture, viennent donner corps à un mystère d’air et d’eau.
Lorsque le jeu se fait défi d’esprit, se présente le cas de figure de la Sérénade BEA (1955), sous-titrée Jeu de cordes sur trois notes. Sous couvert d’une sérénade, le compositeur réalise le délicat équilibre entre affect et intellect. Le second, servi par une architecture sans faille et un jeu constant de variations autour d’un thème on ne peut plus économe (si bémol, mi, la), donne constamment la main au premier, témoin d’une mosaïque d’émotions contrastées qui se succèdent au cours des différents mouvements. Dix minutes sont suffisantes à Françaix pour brosser un univers complet, sans que jamais plaisir et facilité ne soient mis en parallèle. S’il y a plaisir chez Françaix, il s’agit d’une joie élevée, dont on ne saurait faire grief à l’artiste ni de l’éprouver ni de la partager avec le plus large public.
Toujours pour orchestre à cordes (l’un des champs d’investigation privilégiés du compositeur tout au long de sa vie créatrice), les Sei Preludi de 1963 sonnent comme un défi tranquille aux lames de fond qui balayaient alors le landernau musical français. Chacun porte un titre et l’ensemble se présente davantage comme une suite soigneusement agencée que comme un simple recueil. L’Apertura se déploie sans effort, allègre et sereine comme une promenade cycliste (à bon mouvement !) dans une verdure accueillante par un matin frais, aussitôt suivie par une Elegia pour violoncelle solo. D’une remarquable amplitude mélodique, cette dernière est l’une des pages les plus directement émouvantes du compositeur, et l’on pourrait s’étonner de la voir incluse dans ces préludes qui ne visent pas ouvertement à la profondeur. Ce serait ignorer la sincérité omniprésente du musicien qui revendique le droit aux mouvements du cœur et au passage d’un sentiment à l’autre. Notons que l’œuvre se conclut sur un Finale débordant d’alacrité à deux thèmes dont le second, en pizzicati, est particulièrement bienvenu.
C’est de pur plaisir qu’il sera également question dans les Danses exotiques (1957) pour deux pianos7, dont le compositeur s’est souvent fait lui-même l’interprète, avec sa fille Claude. Le dialogue entre les deux pianos est le prétexte à un éblouissant jeu de couleurs, une abondance de rythmes et de mélodies telle que plusieurs auditions sont nécessaires pour en apprécier l’agencement. S’en détachent, après un Pambiche on ne peut plus déhanché, un Baiao langoureux, une Samba lente toute alanguie et un savoureux Rock’n Roll (qui tient curieusement plus du ragtime que du rock). L’orchestration ultérieure, si elle se prive de l’euphonie des deux pianos, se pare en revanche de saveurs fruitées qui achèvent de faire de ces pages bien plus qu’une œuvre de circonstance. Par exotique, il faut entendre une richesse rythmique encore accrue par la vigueur générale des tempi et les constants décalages que le compositeur fait subir à l’alternance habituelle temps fort/temps faible plus qu’une référence pittoresque. L’univers de Françaix est suffisamment cohérent pour n’avoir pas à requérir à la banale couleur locale lorsqu’il veut élargir son horizon. Aussi, ces Danses exotiques n’ont rien d’une carte postale, et si elles ont effectivement pour but premier d’occasionner de la joie aux auditeurs comme aux interprètes (lorsque ces derniers ont triomphé des multiples embûches techniques dont sont parsemées les deux versions), elles n’en sont pas moins une invitation au voyage, à la découverte, non de contrées éloignées, mais de la face intime de l’univers de Jean Françaix.
L’ampleur du catalogue de Jean Françaix inclut un nombre important de pages concertantes qui le place, en ce domaine, parmi les musiciens les plus prolifiques de son temps. Si la coupe formelle reste fidèle à deux modèles établis, en l’occurrence celui des trois mouvements contrastés (vif, lent, vif) et celui de la suite (directement dérivée des ordres de Couperin), c’est dans l’esprit qui anime ces œuvres que le compositeur se montre pleinement personnel. Remontant à l’origine du concerto, et même à la signification du mot, il replace à sa place première ce qui, au fil de l’idéal romantique, s’était peu à peu assimilé à un duel entre un soliste et un vaste ensemble symphonique, duel dont la dialectique reposait avant tout sur la confrontation et ses implications dramatiques. Le concerto, à la source, reste un dialogue entre deux groupes, puis entre un soliste et un orchestre de dimensions modestes. Aussi, en lieu et place d’une mise en scène entrelaçant le physique et le musical, le compositeur choisit délibérément de renouer avec l’art de la conversation. Car il s’agit bien d’un échange, tour à tour primesautier ou vibrant de confidences avouées à mi-voix, mais toujours de type conversatoire, dans lequel aucun protagoniste ne se soucie de prendre le pas sur l’autre. Si la virtuosité solistique se déploie (et Françaix lui donne toute occasion de le faire), c’est toujours dans le feu de cet échange nourri, mais loin de tout épanchement trop libre qui viendrait entraver la pudeur dont jamais l’artiste ni l’homme ne peuvent se départir.
Ainsi, L’Horloge de Flore pour hautbois et orchestre (1959) est-elle une réussite unique en son genre. Construit comme une suite, enchaînant des mouvements consacrés à des végétaux en fonction de leur heure de floraison, ce concerto atypique débute sur les accords charnus et réguliers qui soutiennent la cantilène dévolue au Galant de jour, en un nocturne méditatif et plein de poésie. L’inspiration est particulièrement soutenue, en particulier dans la Nyctanthe du Malabar, que son rythme de danse associé à sa pulsation impaire et fluctuante rend très délicat. Le Géranium triste est un de ces moments dans lesquels le compositeur prend véritablement la parole, tout doucement, sans avoir l’air de quitter son sujet, et pourtant avec une intensité qui ne peut laisser indifférent. Entrée durablement au répertoire des hautboïstes, cette Horloge de Flore reste, aux côtés de la Symphonie concertante de Jacques Ibert (1951) ou du Garden Concerto d’Henri Sauguet (1971), l’une des plus belles pages consacrées à l’instrument dans la musique française de son temps.
Le Concerto pour deux pianos et orchestre (1965), conçu et créé par le compositeur et sa fille Claude qui en ont souvent porté les couleurs, est un véritable bain de jouvence dont la fraîcheur semble inépuisable. Conçu pour un large effectif, mais refusant la surenchère sonore (les tutti restent strictement subordonnés aux climax affectifs), il libère une invention mélodique intarissable qui fait des redoutables parties solistes un jaillissement perpétuel, et ce dès les premières mesures de l’Allegro giocoso initial (qui exposent le premier élément thématique sans introduction préalable). Véritable cœur de l’œuvre, le Scherzando central semble se déployer dans une mosaïque d’humeurs que la discrétion et le sourire n’empêchent pas de s’embuer de mélancolie, avant qu’un Allegro fieramente, clin d’œil aux athlètes du clavier (et il en faut pour triompher d’une partition hérissée de difficultés techniques !) ne vienne conclure dans une apothéose de joie.
Le répertoire concertant pour guitare reste un domaine assez peu fréquenté, particulièrement par les compositeurs français, tant les ombres tutélaires de Rodrigo et Villa-Lobos continuent d’intimider les musiciens. A l’instar de Tansman, Françaix n’a pas craint de s’attaquer à l’exploration de ce continent quasi-vierge, sur la demande du guitariste Narciso Yepes8, avec son Concerto pour guitare et orchestre à cordes (1982-1983). Le tour de force du musicien est d’y avoir ouvertement renoncé à l’hispanisme de carte postale qui demeure trop souvent associé à l’instrument, et d’en avoir exploité toutes les ressources techniques et sonores. Poussant jusqu’au bout son postulat du dialogue, il n’hésite pas (dans la première section du premier Larghetto, par exemple) à confier la ligne de chant aux cordes aiguës (avec une remarquable utilisation des résonances harmoniques), cependant que les arpèges graves, lentement énoncés par le soliste, en constituent l’accompagnement. Le second Larghetto, avec ses accords parallèles de sixtes et sa couleur mineure, est une ballade mélancolique aux saveurs agrestes. Choisissant de ne jamais s’appesantir sur ses moments d’abandon, c’est dans le tourbillon d’un Allegrissimo étourdissant que Françaix met un point final à l’ouvrage. Salué comme une exceptionnelle réussite dès sa création au Festival de Schwetzingen, en 1984, ce concerto a connu plusieurs exécutions et déjà fait l’objet de plusieurs enregistrements, fait assez exceptionnel pour une œuvre contemporaine.
Le rédacteur de ces lignes se souvient d’une entrevue accordée par le compositeur aux ondes de France Musique, dans laquelle il annonçait, non sans malice, s’être attelé à un concerto pour accordéon, « si Dieu me prête vie » ajoutait-il. Il avait quatre-vingts ans, et le défi l’amusait suffisamment pour mener le projet à son terme. Alors même que les concertos de Richard Galliano9 (dont un, Opale Concerto, sert de générique à la série PJ diffusée sur France 2) n’avaient pas vu le jour, le Concerto pour accordéon (1994) est le dernier que le compositeur ait achevé. Le virtuose Pascal Contet en a assuré la brillante création, elle aussi retransmise par la radio. Pas une ride, pas même le soupçon de l’essoufflement ou de l’amertume qui sont parfois associés aux œuvres de l’âge mûr, dans lequel un créateur peut se sentir isolé, ne sont discernables dans ce pur chef-d’œuvre. Sans s’abaisser à n’aligner que des clins d’œil au répertoire musette, Jean Françaix se montre encore original, plein de métier et de fraîcheur, riche surtout de cette joie de créer et de partager une part de lui-même qu’il ne cesse de faire passer à chaque mesure.
Mais s’il fallait opérer un choix dans ce buisson concertant (et ardent !), votre serviteur emporterait sans hésiter le Concerto pour clavecin et orchestre de 1959. Jamais Françaix ne s’y est montré si confondant de naturel, jamais il n’a allié avec autant de délicate finesse, de spontanéité, vivacité et densité de pensée, jamais l’équilibre du dialogue n’a été aussi parfait que dans ce quart d’heure dérobé à la réalité. En ut majeur, le premier mouvement, Toccata I face à face un clavecin tout en arpèges rapides et batteries d’accords et un orchestre (la flûte, seul compagnon des cordes, s’y fait discrète) tout en pizzicati. Lorsque l’auditeur croit reprendre son souffle, débute la Toccata II qui, en conservant le même dispositif instrumental, instaure un dialogue de type responsorial entre les deux mains du soliste (l’une achevant la phrase commencée par l’autre sans s’y superposer jamais vraiment), dans un climat de mélancolie pudique rendu par le ton de la mineur. L’Andantino en ré majeur qui suit laisse une place plus importante au chant de la flûte, dans une sorte de courbe de valse qui ne dit pas son nom, marquée au clavecin par l’emploi d’octaves brisées. Ce mouvement occupe la place médiane que Françaix donne presque toujours au scherzo, dont il adopte d’ailleurs la coupe. Le trio, qui s’enchaîne donc à la première section, est un Allegro marqué par l’adoption d’un joyeux staccato et d’une métrique binaire, en opposition avec le thème précédent. Il se trouve répété avant le retour de l’Andantino, auquel le compositeur entrelace, avec ingéniosité et naturel, le thème du trio à la flûte. Si, dans ce troisième mouvement, le clavecin s’est comporté en instrument obligé, il n’en va pas de même dans le Menuet qui suit. Lent et nimbé d’une intense mélancolie, c’est dans le ton de sol qu’il se déploie, avec de constantes hésitations majeur/mineur, comme si au moment de trop se livrer, Françaix retenait sa plume. Le jeu concertant reste celui de questions du soliste auxquelles l’orchestre répond avec douceur. Enfin, le Finale présente, comme souvent chez Françaix, une récapitulation (en ut majeur) de l’ensemble du matériel thématique exposé avant de s’élancer dans un Allegro de belle humeur qui semble se terminer, sans fracas, sur un ultime clin d’œil. Tel quel, avec sa variété et le naturel avec lequel il passe d’un climat à l’autre, ce concerto est un pur bijou qui résume à lui seul l’attrait que Françaix ressentait pour un genre qu’il a constamment renouvelé.
De même que le compositeur se situe, avec le concerto, dans un art consommé de la conversation, il voit dans la musique de chambre la mise en valeur réciproque des possibilités des protagonistes. Son catalogue est, en ce domaine, particulièrement fourni, avec une notable constance dans la qualité. Jusqu’aux moins usités d’entre eux, y sont représentés tous les effectifs et toutes les combinaisons. Les Variations sur un thème plaisant pour piano et dixtuor à vents (1976), en sont un exemple. La variation, en ce qu’elle suppose de recours à l’intellect et de spontanéité dans l’enchaînement des séquences, exerce sur Françaix une séduction logique. Nul temps mort, nul ennui et aucune rhétorique dans ces pages qui, tout en attestant une imparable maîtrise technique, semblent nées au fil de la plume. Il en va de même dans les Onze Variations sur un thème de Haydn pour contrebasse et 9 instruments à vent (1982), révérence affectueuse à une figure musicale et humaine que le compositeur révérait et dont il avouait qu’il se sentait le petit-fils spirituel.
L’Octuor pour clarinette en si bémol, hautbois, cor en fa, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse (1972) est, quant à lui, tourné vers l’esprit de Schubert. Françaix y réalise des prodiges d’équilibre sonore. Chaque texture y est étudiée et chaque plan sonore ouvragé. Commencé dans le calme, avec une introduction méditative (qui se métamorphose vite en un brillant Allegrissimo), l’Octuor se poursuit sans que le fil mélodique ne soit jamais rompu, jusqu’à la Valse ensorceleuse qui clôt l’ouvrage.
Si nous voulions lui rendre pleinement justice, il nous faudrait détailler tout le catalogue de la musique de chambre de Jean Françaix, tant il présente d’unité et de diversité. Mentionnons au moins pour mémoire les deux Quintettes à vent (1948 et 1987) dont l’éloignement dans le temps ne rend que plus perceptible l’unité, ainsi que le primesautier Quatuor à cordes (1938), qui porte témoignage de la défiance du musicien envers la forme sonate telle que d’Indy a pu l’illustrer, et plus généralement envers tout recours à la formalisation du discours. Si conversation il y a, elle doit épouser les méandres de la pensée des différents locuteurs, en aucun cas un plan préconçu.
Plus que ses contemporains, et dans une époque qui a tendu à les dissocier de plus en plus, Françaix a continué tout au long de sa vie créatrice à associer musique et plaisir avec humilité et exigence, affirmant haut et clair que l’art ne saurait se retrancher derrière des postulats intellectuels dont il doit dépendre toujours en les dépassant constamment.
TENDRESSE ET INTÉRIORITÉ
La palette de Jean Françaix, n’en déplaise aux idées reçues, est beaucoup plus large que celle d’un habile dispensateur de plaisirs sonores raffinés. Mais s’il accoste souvent aux rives d’une confession plus directe, il le fait toujours avec la plus extrême discrétion, sans avoir l’air de se livrer trop. Rien de plus insupportable pour lui que les œuvres dans lesquelles le compositeur joue trop ouvertement la carte des sentiments ou celle du pathos, la sincérité, seule valeur étalon que Françaix reconnaisse, s’en trouverait sérieusement compromise. Aussi, tendresse et franc sourire sont-ils souvent étroitement imbriqués au sein de la même œuvre, de sorte qu’il est beaucoup plus facile de ne relever que la drôlerie et de passer à côté de ce non-dit, de ce suggéré qui fait le prix de sa musique.
Le cycle des Trois Épigrammes pour quatre solistes vocaux et quatuor à cordes (1938)10 présente bien une alternance voulue entre une gaîté qui n’a rien d’apprêté et une intériorité qui n’a pas à se forcer pour percer, en particulier dans la deuxième, Levez ces couvre-chefs plus haut (sur un poème de Charles d’Orléans). Par ailleurs, l’attirance du musicien pour la poésie de la Renaissance se manifeste dès ces années et ne se démentira pas. Plus qu’une affinité élective, c’est de correspondance dont il faut parler entre l’art du compositeur et celui d’un Marot ou d’un Charles d’Orléans, chez qui la fantaisie et la sensibilité élégiaque sont intimement entrecroisées.
Dans son premier grand cycle de mélodies, L’Adolescence clémentine (sur des poèmes de Clément Marot), les deux dimensions se rencontrent. La seconde pièce, Mon Cœur est tout endormy, le temps se suspend, entre berceuse et langueur mélancolique, comme si le masque comique, un instant tombé, laissait entrevoir, sans le dévoiler abruptement, un visage pensif. Après une page alerte et ironique, la Complainte s’ouvre comme un éventail agité calmement et dont les couleurs se mélangent en une nuance indéfinissable. Délaissant volontairement tout recours aux arpèges, aux sortilèges qu’il peut susciter (et que le compositeur, pianiste virtuose, connaissait et était à même de pratiquer), le piano se replie sur des accords profonds qui distillent une buée mélancolique. L’équilibre sera rétabli avec la dernière mélodie, Avant Naissance, pleine d’esprit, mais c’est dans les deux pages apaisées que bat le cœur de cette Adolescence clémentine.
Les Cinq Poèmes de Charles d’Orléans (1946), toujours pour voix et piano, peuvent présenter les mêmes axes de lecture. Ainsi, le second, Laissez-moi penser à mon aise, adopte une forme strophique (épousant au plus près les inflexions du texte) qui se prive de toute séduction extérieure pour ne laisser parler que la profonde mélancolie du poète, avant que le chant ne se perde sur une longue tenue sur le mot « Hélas », pendant que le piano reprend en boucle un court élément thématique. Il en va de ce cycle comme du précédent : sa délicatesse donne plus de poids à la confession, à plus forte raison dans le cadre intime de la mélodie française, et le lyrisme n’accède à son sens véritable que lorsqu’il se situe au bord du silence. Presque en même temps, le compositeur signe une très émouvante Prière du soir (1947) pour voix et guitare (ou voix et piano, mais la première possibilité est plus proche de l’intériorité souhaitable). Le texte d’Agrippa d’Aubigné est bien représentatif de la noblesse de l’auteur des Tragiques, et la ligne vocale en restitue toute la sobriété. C’est une prière toute cistercienne qui s’élève, simple et grave. Françaix y parle sans apprêt, sans songer, même un instant, à travestir son sentiment. L’homme parle à travers le musicien, mais toujours mezza voce, et il faut sans doute y voir la raison pour laquelle cette courte page se pare d’une résonance particulière dans son catalogue.
La tendresse est, chez Françaix, indissociable de la globalité de son attitude esthétique. Ainsi lorsqu’il signe, en 1971, Les inestimables chroniques du bon géant Gargantua pour récitant et orchestre à cordes (Pierre Bernac assura la création du rôle de récitant avec l’ensemble Andrée Colson). Le pari d’un tissu musical continu pensé comme le prolongement naturel de la parole (et quelle parole, lorsqu’il s’agit du verbe de Rabelais !) était déjà osé en soi, mais Françaix le transcende aisément par l’intensité qu’il prend le parti de conférer à son propos. Là où la tentation aurait été grande, pour un artiste moins probe, de céder aux sirènes d’un comique gaulois, sans chercher à s’inscrire dans la nuance, le compositeur ne cesse de retenir sa plume pour laisser apparaître en filigrane l’humanisme derrière le sourire. Loin d’être anecdotique, cette œuvre d’importante dimension (quarante-cinq minutes) est une oasis à laquelle il est bon de venir se rafraîchir régulièrement, tant Françaix a compris et servi comme la sienne propre la pensée de l’écrivain, au-delà de la plaisanterie, et tant la tendresse n’est jamais, ni chez l’un ni chez l’autre, synonyme d’affadissement.
Joyaux des dernières décennies, les Trois Poèmes de Paul Valéry pour chœur a capella (1982) peuvent être compris comme un testament en matière de musique vocale. Jamais peut-être le compositeur n’a parlé un langage harmonique aussi extraordinairement riche, et jamais cette opulence maîtrisée ne s’est trouvée au service d’une telle hauteur poétique. La seconde pièce, le Cantique des Colonnes, s’ouvre sur une section homophonique dans un sol majeur lumineux et doux. Les voix d’hommes s’élancent alors dans une magnifique phrase ascendante entre ut majeur et la mineur, toute irisée de frottements de septièmes, s’adressant aux colonnes, qui aussitôt répondent par la voix des soprani et alti jusque dans la lumière nacrée de mi majeur. Sur la phrase magnifique « Vois quels hymnes candides, quelles sonorités, nos éléments limpides tirent de la clarté », le chœur se retrouve mobilisé dans son entier pour l’une des plus belles phrases nées sous la plume du compositeur (magnifique modulation en mi bémol majeur). Il nous faudrait analyser chaque mesure pour en révéler toutes les beautés. Aucune virtuosité extérieure ici, comme si le moindre élément ajouté pouvait suffire à rompre un équilibre qui ne tient qu’à la dimension presque oratoire de la musique, car c’est bien un cantique qu’a conçu le musicien, une incantation pleine de ferveur et de confiance, comme seule la maturité jointe à une jeunesse d’esprit inaltérable pouvait en inspirer.
Comme celle d’Henri Sauguet, la musique de Françaix tend, par la courbe naturelle qui est la sienne, à se résoudre en images chorégraphiques. Rien de surprenant à ce qu’il ait souvent été sollicité pour composer de la musique de ballet (rappelons que ce sont ses premiers succès en ce domaine qui lui vaudront d’intégrer les éditions Schott). Ce ne sont pas moins de seize partitions qui seront consacrées à ce genre si particulier. Plus qu’à de grands spectacles aux couleurs chatoyantes, Françaix s’est attaché à des ballets d’atmosphère, qui permettent plus directement au visage tendre de sa muse de se montrer. Ainsi en va-t-il des Malheurs de Sophie (1935). Cette superbe partition attendra pourtant 1948 pour être créée sur la scène de l’Opéra de Paris. Le compositeur se refuse à renvoyer au public cette image affadie et pas toujours exempte de niaiserie qui se trouve souvent associée aux ouvrages de la Comtesse de Ségur. La tendresse indulgente qu’il manifeste pour ses héros ne doit rien à un réflexe de salon. Il suffit d’écouter la Variation de Paul ou le Pas de deux entre Sophie et Paul pour comprendre sa démarche. De même que Ravel dans Ma Mère l’Oye, Françaix n’a pas besoin de recourir au décor d’une nursery pour retrouver le rythme d’un cœur d’enfant. Il en a conservé la gravité, la capacité à s’émerveiller et la proximité entre rire et larmes, que relie le mouvement perpétuel de balancier du cœur humain. C’est bien cela, et non un agréable exercice de style, qu’il nous est donné d’entendre dans cette œuvre au relief si particulier.
Les Demoiselles de la Nuit (1948), sur un argument de Jean Anouilh, est la première collaboration du compositeur avec Roland Petit. Il y établit un climat très particulier (Ballet de chats, mentionne la partition), nimbé d’une prenante mélancolie qui ne craint pas de chanter sans artifice. La musique peut d’ailleurs en être écoutée sans le support de la chorégraphie, elle n’y perd aucune de ses qualités. Jamais le trait ne devient appuyé, et chaque mesure y démontre la parfaite maîtrise des moyens et de l’expression. On peut déplorer que, comme tant d’autres ballets de Sauguet, Milhaud ou Jean Françaix lui-même, Les Demoiselles de la Nuit n’ait pas survécu à la scène, car le public continue d’ignorer cette œuvre profondément attachante.
L’orgue n’était pas l’instrument favori ou naturel du compositeur. Cependant, il lui a consacré une série de pages dont il nous faut détacher, dans le registre qui nous préoccupe ici, la Suite Carmélite de 1960. Le titre en cache une référence directe aux Dialogues des Carmélites de Georges Bernanos, dont Francis Poulenc venait, en 1958, de faire l’un des chefs-d’œuvre de l’art lyrique. Françaix brosse une galerie de portraits correspondant explicitement aux personnages principaux et, bien que de dimension restreinte, chacune des pièces est un univers à part entière. Nous signalerons, en particulier, la première, Sœur Blanche, toute de ferveur contenue et de résignation, et la quatrième, Sœur Constance, qui restitue si bien la fraîcheur et la jeunesse du personnage. Dans un mode d’expression très différent de celui de l’école française d’orgue (qu’il s’agisse des descendants spirituels de Louis Vierne ou de l’esthétique d’un Maurice Duruflé), la Suite Carmélite est un cycle réellement original, exempt de toute velléité décorative, tant Françaix s’est attaché à peindre de l’intérieur les caractères plutôt qu’à résumer la pièce de Bernanos, et tant l’intériorité de l’ensemble est plus proche d’oraisons simples et sincères que de pièces descriptives.
Mais la tendresse et le côté secret du compositeur n’ont pas expressément besoin, pour s’exprimer, du cadre chorégraphique ou du support poétique ; c’est même dans des œuvres de « musique pure » qu’il nous livrera ses plus troublantes confidences, comme sous le sceau du secret. En 1948, Françaix achève une Symphonie d’archets pour orchestre à cordes. Toujours peu sensible à l’ampleur de geste chère aux post-romantiques allemands, il respecte néanmoins la coupe en 4 mouvements, avec la succession attendue Allegro — Lent — Scherzo — Allegro conclusif. Telle qu’elle est présentée, cette symphonie n’est pas une œuvre à programme, et s’apparente au renouveau symphonique français de l’entre-deux-guerres. Le second mouvement, Andante molto, adopte une coupe de forme Lied ABA. Mais le musicien ne peut se contenter de la simple application d’un schéma formel éprouvé, celui-ci n’a de raison d’être que s’il est le cadre naturel de l’expression d’un sentiment. Sous le visage paisible d’un second mouvement très traditionnel, Françaix montre une facette peu connue de sa personnalité, celle de l’inquiétude (et nous aurons l’occasion d’y revenir à propos de l’oratorio L’Apocalypse de saint Jean). Un accord pizzicato d’ut majeur ouvre le mouvement qui, par glissements et modulations successives, arrive sur un cinquième degré de mi. Cette brève introduction suffit à mettre en place le climat général : la ligne des violons I, sinueuse, comme peinant à passer d’un son à l’autre et incapable de s’élever malgré plusieurs tentatives, préfigure le thème principal. Celui-ci apparaît immédiatement, en mi mineur, conçu comme une série d’oscillations entre cinquième (si), troisième (sol) et quatrième degré augmenté (la dièse), le tout englobé dans une métrique strictement binaire, avant retour sur la tonique (mi). La proximité du la dièse et du si vient prolonger cette difficulté à l’ascension déjà en germe dans l’introduction, et ce thème, en apparence anodin, qui peut sembler simplement une détente entre deux mouvements allègres, prend le sens d’une angoisse résignée, d’une peur lancinante et inavouée. La section A se poursuit par une courte incursion dans le ton d’ut majeur, sans parvenir à l’imposer vraiment, d’où le rapide retour du thème entièrement réexposé. La section B joue le rôle d’un développement sur la tête du thème, preuve, s’il en était besoin, que Françaix maîtrise parfaitement la technique compositionnelle, et qu’il la subordonne simplement à l’intention, en lui refusant une autonomie excluant l’affect du geste artistique qui lui retirerait simplement sa raison d’être. Par paliers successifs, il amène un climax qui sonne comme une exclamation désespérée, vite réprimée et comme plombée par le retour de A concluant sur un accord de mi mineur joué pianissimo. La gravité, chez Françaix, n’est jamais annoncée à grand fracas, mais elle n’en prend que plus de poids, et ce mouvement, dans sa tendresse inquiète, en porte clairement témoignage. Le Scherzo qui suit est une ironique valse, que Prokofiev n’aurait pas désavouée, tant le sourire s’y fait sarcastique. Le compositeur y renforce les hésitations constantes entre majeur et mineur, multiplie les décalages rythmiques et ne s’autorise de résolution (majeure, en l’occurrence) qu’à l’extrême fin de la première section. Comme un rire narquois, le Trio qui s’enchaîne reprend des éléments de la valse, mais en les replaçant dans le contexte d’une prolation binaire11, ce qui en change considérablement le caractère. De décalage en décalage, le rythme de valse se réinstalle et amène logiquement la reprise de la première section. « Mieux vaut en sourire, si cela est possible, puisque le monde va ainsi, de ce mouvement d’horloge détraquée » semble nous dire le compositeur. Bien entendu, notre ambition ne peut être de produire ici une analyse détaillée des multiples niveaux de lecture que propose cette œuvre, l’une des plus accomplies de tout le catalogue du compositeur, mais à défaut de lui rendre pleine justice, de donner un aperçu des richesses de cette Symphonie d’archets, qui rivalise de beauté avec la Symphonie pour cordes et trompette d’Honegger.
Nous avons déjà dit quelques mots des Quinze Portraits d’enfants de 1971. La tendresse y est omniprésente, nimbée de ce sourire que seul l’art d’être grand-père peut conférer. La Fillette au chapeau bleu, sublime berceuse dont l’envolée mélodique semble ne jamais trouver de fin, est une page toute d’une rêverie couleur de ciel, et la Fillette au chapeau à plume rose, un moment de grâce avant que n’éclate la joie espiègle du Petit collégien. La brièveté des pièces, presque des vignettes musicales, n’enlève rien (bien au contraire) à leur fraîcheur, elle permet au musicien de baisser sa garde et de donner libre cours à une tendresse qui ne demande que cela, sans crainte aucune de se voir menacé d’avoir manqué à sa pudeur naturelle dans ce cadre volontairement restreint.
L’âge venant, Françaix tend à laisser plus facilement s’épancher le côté intime de cette humanité aux bras ouverts, marquée au coin d’un humour et d’une retenue toute classique (laquelle restera sienne jusqu’au bout), qui l’ont tenue assez secrète. Ainsi, en 1978, achève-t-il l’Ouverture anacréontique, qui est créée en 1981 par l’orchestre symphonique de Westphalie. Derrière ce titre énigmatique, se cache une pièce d’importantes dimensions (un quart d’heure de musique) qui est, en réalité, beaucoup plus qu’une ouverture de concert. En se référant au poète grec Anacréon et au climat de ses odes, Françaix a avoué s’être attaché à imaginer un univers momentanément exempt de laideur et de guerre, à brosser une vision édenique qui, pourtant, ne pèche pas par excès de naïveté. Deux grandes parties la composent, dont les matériaux musicaux se trouveront combinés à la toute fin. La première se présente comme une section principalement harmonique d’écriture verticale. Calme et intensément mélancolique, elle se déroule dans ce qui semble être la lumière mordorée d’un soir d’été. Un sourire plein d’indulgence aux lèvres, le compositeur se retourne vers le passé d’une vie déjà remplie, en choisissant non pas d’ignorer mais de pardonner à son temps ce qu’il a pu véhiculer d’atrocités. Il se trouvera toujours des musicographes expéditifs pour parler d’inconscience ou de liberté excessive, alors que c’est simplement du côté de la tendresse de Françaix qu’il faut rechercher la meilleure piste de lecture de cette page. Le temps du sarcasme est passé, il n’en reste qu’un fin sourire. La deuxième partie, beaucoup plus alerte, nous donne rendez-vous avec le Françaix de La Dame dans la lune, fin, spirituel et toujours espiègle. Les dernières mesures verront se superposer les deux éléments thématiques, réunissant les deux versants de la personnalité du musicien en une de ses plus touchantes confessions.
L’une des dernières œuvres du compositeur est la Pavane pour un génie vivant de 1987. Créée sous la direction de Michel Béroff par l’orchestre du Festival de Montpellier Radio France, elle est un hommage discret et sincère à Maurice Ravel, le conseiller des premières années, pour l’œuvre et la personnalité duquel Françaix a nourri toute sa vie une admiration et une affection profondes. De structure très simple, cette courte page est une cantilène du cor anglais, instrument par excellence de la mélancolie, accompagnée comme sur la pointe des pieds par un orchestre sans cuivres. Le climat est évidemment proche de la Pavane de la Belle au Bois dormant (elle se déroule dans le même mode de la) et utilise pour base la cellule initiale du Prélude du Tombeau de Couperin, présentée en valeurs longues. Ce qui, sous la plume de Ravel, semblait évoquer un envol rapide d’oiseaux au-dessus d’un marais, prend ici l’allure calme d’un albatros en vol. Sur cette pièce aux couleurs crépusculaires, toute vibrante de son attachement au compositeur de la Sonatine, Françaix prend congé de la musique symphonique.
Nous n’avons choisi que quelques exemples – que nous aurions pu multiplier à l’envi – de cette intériorité de la musique de Jean Françaix, qui reste la facette la moins connue du grand public, et ceci d’autant plus que beaucoup de commentateurs l’ignorent délibérément.
IMAGE ET POUVOIR ÉVOCATEUR
Nous avons déjà parlé de l’attrait de Jean Françaix pour la scène, en évoquant plusieurs de ses œuvres lyriques. La musique étant d’abord, et même uniquement, un vecteur d’émotion, elle s’unit naturellement à la poésie (que ce soit par la mise en musique d’un texte ou par l’évocation d’un climat) et à l’image. Nier le pouvoir évocateur de la musique revient à en nier la raison d’être, avec ce que cela implique de diversité dans les domaines d’application.
Pour beaucoup de musiciens de la génération de Françaix, et non des moindres, la musique de film est restée une démarche annexe ou alimentaire (à l’exception notable des contributions de Maurice Jaubert, Georges Auric, Arthur Honegger, Jean Wiener ou Georges Delerue). Dans le cas de Françaix, la donne est sensiblement différente. La rencontre avec Sacha Guitry sera décisive. En effet, ce dernier nourrit une idée précise de la façon de conduire une narration cinématographique. Françaix sera au rendez-vous de plusieurs des films à caractère historique du réalisateur, en l’occurrence Si Versailles m’était conté (1954), Napoléon (1955) ou Si Paris nous était conté (1956). Sa participation aux films en question dépasse de beaucoup la simple contribution d’un compositeur recruté en dernière minute et n’ayant à travailler que sur un film déjà monté. Guitry pose en principe que le scénario doit être centré, surtout lorsque l’ensemble brasse plusieurs siècles d’histoire, sur des moments bien précis, durant lesquels son regard devient celui d’un entomologiste, et que le temps doit s’accélérer entre ces moments, de telle sorte que le temps subisse constamment des phénomènes de dilatation et de contraction. Les moments forts correspondent généralement à des étincelles de la « petite histoire » cependant que la grande poursuit son chemin en reliant les épisodes les uns aux autres. Seul lien direct existant entre les deux dimensions : la voix du narrateur, Guitry soi-même, qui résume ce qui n’est pas montré (la technique, directement issue du théâtre classique, n’est pas neuve, si ce n’est dans son application ; Racine n’agit pas autrement dans le récit de Théramène). La musique est omniprésente dans chacun des trois films cités, et elle est un partenaire dramatique à part entière. Sans mot, et parfois sans image appropriée puisqu’elle donne à voir ce qui n’est pas explicitement visible, la musique de Françaix raconte l’histoire avec un pouvoir d’évocation unique en son genre. La scène qui montre la machination à l’origine de l’affaire du collier de la Reine est entièrement muette à l’exception de quelques mots du réalisateur. C’est la musique et elle seule qui se fait narrateur de ce jeu de dupes. Les comédiens se déplacent dans un décor unique, celui du hameau de Marie-Antoinette, et seule la musique nous suggère avec exactitude le déroulement de l’action. La rumeur de la cour de Louis XIV est également matérialisée par un numéro entièrement en pizzicati de cordes qui donne littéralement à entendre ce que les personnages se disent tout bas. Et il est impossible de passer sous silence la dernière scène du même film, la descente de l’escalier des cent marches, l’un des plus beaux instants de toute l’histoire du cinéma français ; là, pour la première et unique fois, Françaix ne recule pas devant l’emphase. Dans une orchestration étincelante, un contrepoint virtuose superpose plusieurs thèmes de marche, la Madelon et la Marseillaise, le tout sur un ostinato de basse immuable12. Contrairement à ce que demandait Cocteau à Georges Auric dans Le sang du poète, Guitry pensait la musique comme partie intégrante d’une scène, et non comme un ajout a posteriori. La musique est donc conçue par le compositeur en fonction d’un script et d’un chronométrage précis, à l’instar de ce que font, à la même époque, les compositeurs américains de musique de film tels Korngold, Waxman, Newman, Steiner ou Salter. La réussite indiscutable de Jean Françaix (et dont Guitry était tout à fait conscient) tient à ce que, regardées sans sa musique, les scènes se trouvent amputées d’une grande partie de ce qui fait leur caractère. Il est rare qu’un tel rapport symbiotique soit instauré entre musique et image (en dehors des travaux d’Alfred Hitchcock et Bernard Herrman). Il est donc plus que regrettable que ces partitions pour grand orchestre, qui restent souvent propriété des studios, n’aient pas été mieux conservées et gravées, car leur survie demeure très problématique.
Il est une œuvre importante de Jean Françaix qui, sans ressortir de la musique de film, se rattache au pouvoir évocateur de la musique et au même postulat narratif : l’opéra La Princesse de Clèves (1961-1965), dont le compositeur et Marc Lanjean ont conçu le livret à partir du roman de Mme de La Fayette. On pourra s’étonner de ce qu’après l’ironie du Diable boiteux et de La Main de Gloire, le musicien à l’esprit mordant se soit tourné vers une pure histoire d’amour. C’est compter sans le goût des lettres qui était le sien. Françaix connaissait le roman dont il appréciait la perfection toute classique, mais la lecture d’un texte de Denis de Rougemont le décide à passer au projet d’un opéra. Ce dernier, traitant de la permanence du mythe de Tristan et Iseult, expose la filiation directe et intemporelle qui relie différents textes autour d’une thématique commune : celle de l’amour qui ne se réalise que dans la mort des protagonistes. Fort de son expérience de la scène lyrique, Françaix élabore son livret en jouant, comme Guitry, sur des accélérations narratives. De cette façon, seuls les épisodes clés, centrés autour de l’évolution des sentiments, sont représentés par les personnages en costume Renaissance, cependant que la trame intermédiaire est résumée par un rôle parlé, Mme de La Fayette, placée à l’avant-scène en costume versaillais et coiffure Fontange. En se basant sur une double dimension temporelle, mettant en avant la non datation du ressort de l’intrigue, Françaix évite en conscience l’écueil de la musique illustrative et du pastiche. De fait, La Princesse de Clèves est l’une des plus belles réussites du répertoire lyrique français. La musique y obéit à un flux continu puisque, comme dans les réalisations de Guitry, elle continue à se développer à l’orchestre pendant les interventions de la narratrice.
La délicatesse de touche dont Françaix use dans son orchestration est remarquable de bout en bout, depuis son début plus que discret (une simple phrase monodique à découvert avant l’entrée de la récitante) jusqu’à l’opulence de la marche qui ouvre le rassemblement de la cour pour le bal13. Mais l’ensemble baigne dans cette mélancolie qui prend peu à peu une place dominante dans l’œuvre du compositeur. Ainsi, le premier air de la Princesse, « Le sentiment que j’ai pour lui », est empli d’une lancinante tristesse (rythmée par les arpèges des deux harpes), comme si l’héroïne avait déjà largement compris ce que sera le devenir des protagonistes. La mort de Madame de Chartres est un moment d’une suprême intensité, tout en pudeur et en dépouillement. Lorsqu’il s’agit d’illustrer le registre amoureux, la pudeur reste le guide le plus sûr du compositeur, comme dans l’air du Duc de Nemours au deuxième acte, « La plus aimable personne de la cour ». Mais l’un des sommets de l’ouvrage se situe dans l’air dramatique du Prince de Clèves : « Quelle honte pour un mari et, pour un amant, quel déplaisir ». Nul déferlement de colère, mais une douleur contenue, sensible dans le long crescendo de la ligne vocale et dans la figure rythmique obstinée de l’accompagnement, évoquant un cœur qui ne battrait plus qu’irrégulièrement. Enfin, la déploration que chante la Princesse après la mort de son époux, à laquelle s’enchaîne un ultime duo, est une pure merveille d’intensité et d’économie de moyens. L’élément bouffe n’est pas absent, en particulier dans l’ensemble du second acte, « Ah, le méchant vil importun », dont le débit rapide, l’alacrité et les interruptions par des valets ridicules sont de la meilleure veine de Françaix.
Les danses d’époque classique, telles le menuet ou la forlane (rappelons que sous couvert du règne de Henri II, c’est bien Versailles que peint la romancière) sont évoquées par leur carrure rythmique, mais Françaix évite soigneusement le recours au pastiche qui annulerait l’ancrage de l’œuvre dans un mythe amoureux, donc sans référence temporelle trop appuyée.
La puissance suggestive de la musique jointe à son raffinement fait de La Princesse de Clèves l’ouvrage lyrique majeur du compositeur et, en même temps, un défi que peu de théâtres et de metteurs en scène ont osé relever jusqu’à aujourd’hui. Il est pourtant nécessaire de lui redonner vie, pour que le public de notre temps puisse découvrir et aimer comme elle le mérite cette œuvre exigeante et généreuse, qui demeure un jalon incontournable de l’art lyrique.
DE L’INQUIÉTUDE À LA SÉRÉNITÉ : L’APOCALYPSE SELON SAINT JEAN
De l’aveu même du compositeur, l’oratorio L’Apocalypse selon saint Jean (1939) est l’œuvre qu’il préférait au sein de son vaste catalogue. Cette préférence peut surprendre, surtout si l’on considère la faible proportion de pages à caractère sacré qu’il a laissée ou laissées au regard du nombre considérable de celles profanes. C’est dès 1937 que Françaix conçoit le projet, lors d’une tempête au retour de concerts donnés aux U. S. A.14. La vision d’une nature en furie, face à la petitesse de la condition d’homme, l’amène à penser au texte de saint Jean. Dès lors, il s’attache au découpage du texte, puis à la détermination de l’effectif. Celui-ci est le plus vaste jamais mobilisé par le musicien : quatre solistes vocaux (soprano, alto, ténor et basse), un grand chœur mixte (divisible à huit voix), un orgue et deux orchestres. Le premier, placé avec le chef et les chanteurs devant le chœur, sur le proscenium, comprend 2 flûtes, 2 hautbois, 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones, 1 tuba, 2 harpes, 4 timbales et quintette à cordes ; le second, dans la fosse (qui nécessite, si l’on adopte le dispositif préconisé par le compositeur, un second chef), se compose d’une petite flûte, 2 clarinettes, 1 clarinette basse, 2 bassons, 2 contrebassons, 3 saxophones, 1 cornet à piston, 1 trombone à piston, 1 sarrusophone, 1 harmonium, 1 guitare, 1 mandoline, 1 accordéon, une batterie, 2 violons et 2 contrebasses. Cette division n’est pas le fait d’un caprice d’artiste, mais bien de la démarche dans laquelle il entreprend sa composition.
Françaix, en effet, se place dans la position d’un artiste de l’âge médiéval, illustrant le texte sacré pour lui donner plus de poids encore. Souligner sans déformer, frapper l’esprit sans sombrer dans le spectaculaire gratuit, voilà la gageure que se fixe le jeune compositeur (il a vingt-cinq ans lorsqu’il entreprend l’ouvrage). L’Apocalypse selon saint Jean est l’œuvre d’un jeune homme inquiet, d’une conscience que préoccupe la marche de l’Europe vers une guerre dont chacun, sans oser le dire, sent bien qu’elle est devenue inéluctable. Et avec la vision de saint Jean, c’est du cheminement de sa conscience dont Françaix nous rend témoins, de cette marche du doute profond vers la certitude apaisée de la Jérusalem céleste. La menace n’a pas spontanément reculé ou disparu, mais l’Homme porte en lui et malgré lui la possibilité de la dépasser, et d’entrevoir sur terre la réalité immanente qui le dépasse.
L’oratorio est divisé en trois parties et un prologue. Ce dernier, assez bref, est constitué d’une pédale d’ut majeur (longue tenue des cordes et cellule obstinée présente aux harpes) soutenant la répétition (en unisson) de la calme affirmation « Il est, Il était, Il vient » par les soprani et alti, dont le thème refermera l’œuvre. La première partie s’articule autour de quatre sections contrastées. La Lettre aux Sept Eglises est un solo de basse (le Christ) accompagné, au début, par les timbales de l’orchestre céleste. Calme, simplement syllabique et diatonique, la ligne de chant adopte une découpe strophique, comme une antienne grégorienne à laquelle sa nudité l’apparente. La Vision du Trône de Dieu mobilise tout l’orchestre céleste et les chœurs. Le ton d’ut majeur (abordé par sa dominante) brille des mille feux d’une orchestration somptueuse et de notes ajoutées (sixième degré omniprésent). De l’homophonie en valeurs longues du début, dont l’écriture se rapproche de celle d’un choral, le compositeur passe peu à peu à des valeurs plus brèves, pour aboutir à une marche triomphale que vient couronner le thème du prologue. L’Apparition du Lion et l’Agneau recevant le Livre aux Sept Sceaux sera plus contrastée. L’ensemble des basses et ténors du chœur, en octaves parallèles, ponctués d’accords de cuivres sur les fins de phrase (dispositif et thème qui se verront repris dans le cours de l’ouvrage) solennise l’apparition du Lion. La figure de l’Agneau est, en revanche, associée à la polyphonie. Les quatre solistes (en une superbe cantilène du soprano contrepointée par les trois autres voix), quasiment a capella, commentent l’entrée des Anges. C’est au chœur que sera dévolu le cantique appelant à l’ouverture du livre. Françaix signe là quelques mesures de la plus belle eau, qui devraient suffire à elles seules à décourager toute remise en question de son génie. Somptueux effet de sfumato à l’orchestre, mode de la transposé sur ut, choral d’adoration qui s’éclaire peu à peu pour finir dans la lumière adoucie du mode majeur, ce cantique (chiffre 17 de la partition) est un pur joyau. Les quatre solistes concluent par une ultime modulation vers ré majeur. Suit alors l’Ouverture du Livre au Sept Sceaux, qui résume l’histoire de l’humanité. Après une introduction en octaves parallèles des soprani et alti, l’orchestre préfigure l’affrontement des forces de la lumière et des ténèbres en une marche polytonale et hallucinée. Les quatre cavaliers (le Christ, la guerre, la famine et la peste) sont figurés sobrement par un chœur presque traité en unisson. Un second interlude orchestral, moins tourmenté, amène alors la rupture du cinquième sceau (la prière des martyrs) que déclame (toujours en scansion syllabique, comme un lent récitatif) saint Jean sur un accompagnement du chœur en unisson. Enfin, la rupture du sixième sceau (renversement des impies et rédemption des fidèles) débute dans l’angoisse d’un chœur bégayant sa peur, avant que les solistes n’annoncent le salut des âmes élues. L’ensemble des voix s’engage dans une marche (en ut majeur, ton de l’apaisement et de la justice divine) qui s’élève, confiante et sereine, jusqu’à un magnifique climax, point culminant de cette première partie, avant que les quatre solistes ne concluent dans une paix radieuse. Jean n’a plus qu’à terminer, en quelques mesures, par l’ouverture du septième sceau, a capella, dans le grave de sa tessiture.
La deuxième partie détaille la Vision des Sept Trompettes. Jamais la palette de Françaix ne s’est parée d’une aussi grande force évocatrice. Les quatre premières trompettes sont évoquées par le chœur sur un tempo soutenu. Mais les trois dernières se voient traitées de manière indépendante : l’Ouverture du Puits de l’Abîme, marche sombre mobilisant l’extrême grave de l’orchestre, lourde de menace et l’Invasion des Sauterelles, utilisant les cordes pincées de l’orchestre infernal et le chœur en croches piquées (la précision de l’image évoquée se passe de la projection précise et de l’intelligibilité du texte). L’Invasion des 200.000.000 de cavaliers reprend la forme d’une marche angoissée qui culmine en un passage choral extrêmement tendu sur le plan chromatique. L’épisode des Deux Témoins rompt brutalement cette spirale d’angoisse, avec un retour au style récité. Après leur mise à mort par la bête de l’abîme (accords arrachés de l’orchestre infernal), leur résurrection amène une conclusion sereine en ré majeur.
La Vision de la Femme et du Dragon, qui ouvre la troisième partie, est confiée à deux solistes (soprano et basse), sur fond d’affrontement des deux orchestres. Elle est immédiatement suivie du Combat de Michel et du Dragon, dans lequel Françaix se hisse sans effort au rang des maîtres enlumineurs. La Bête de la Mer, sinistre et implacable, voit ses méfaits contés par les quatre solistes (alternance d’unisson et de polyphonie dissonante) sur fond d’arpèges de guitare. En revanche, La Bête de la Terre, encore plus monstrueuse, se déploie sur un rythme de jazz, comme un insecte aux pattes terrifiantes. Encore plus caractéristique sera Babylone la Courtisane. L’alto solo se fait tout à coup chanteuse de cabaret douteux, ironiquement accompagnée de la mandoline, de la clarinette et de l’accordéon (Françaix manie les couleurs avec une maestria sans partage), avant que la ville et la bête ne soient détruites et Satan incarcéré. Le discours s’apaise dans Le Millenium, qui repose sur des soli soutenus par un orchestre discret et le chœur en bouches fermées. Après l’ultime épisode de Gog et Magog, Françaix évoque à nouveau La Jérusalem Céleste. Un choral magnifique d’ampleur se déploie du piano au double forte en deux arches symétriques (toutes deux dans le ton d’ut majeur), comme un vitrail somptueux que le soleil illumine peu à peu, et dont les couleurs se mélangent en une seule brillance.
Il ne reste plus à l’Épilogue qu’à conclure, exactement comme le Prologue avait ouvert, avec la même pédale d’ut majeur, dans la même sérénité intemporelle. Issue du silence, l’œuvre retourne au silence. L’angoisse n’est pas morte, mais la confiance est la plus forte, et c’est cet axe de pensée qui fait tout le prix de cette œuvre unique en son genre, hautement personnelle et dont l’opulence se trouve équilibrée par la sincère ferveur.
JEAN FRANÇAIX : UN CÉLÈBRE INCONNU
Il est un fait certain que l’œuvre de Jean Françaix se voit en partie épargné le purgatoire qui suit habituellement le départ d’un compositeur. En quatre ans, L’Apocalypse selon saint Jean a connu deux enregistrements disponibles le commerce. Il n’en demeure pas moins que si ses œuvres continuent de figurer assez régulièrement aux programmes des concerts, particulièrement de musique de chambre, le compositeur demeure, en quelque sorte, un inconnu célèbre. Une seule de ses facettes, pas toujours la plus représentative de la réalité et de la diversité de la personnalité, est familière du grand public.
Il est impossible d’enfermer une œuvre aussi abondante dans les cloisons d’un néo-classicisme souriant. Or, précisément, la réputation de légèreté ou même le déni de profondeur entretenus par nombre de musicographes contribuent à laisser ignorer la richesse du tempérament musical et esthétique de Françaix. Juger, en quelques pages, de la valeur d’une œuvre (si l’on admet qu’elle puisse si facilement être étalonnée), en tirer sur le champ des réflexions et des conclusions sur le caractère profond du compositeur, reste déjà un exercice risqué, mais choisir pour cela justement une page de quelques minutes, que le musicien lui-même qualifie de plaisanterie musicale, ne peut être qualifié d’étude sérieuse. L’art de Jean Françaix peut emprunter les voies du sourire, il n’en est pas moins susceptible de s’élever sans effort jusqu’aux sommets de l’expression. Sa vraie grandeur reste cette capacité d’être simultanément proche de l’auditeur et de l’entraîner au-delà de cette proximité. Françaix est lui-même, qu’il s’implique dans l’espièglerie des Portraits de Jeunes Filles ou dans la symbolique de l’Apocalypse selon saint Jean, et il n’a pas besoin de contraindre son langage pour cela, tant celui-ci est fort et cohérent. Car c’est bien de cohésion qu’il faut parler, derrière la facilité et le naturel apparent. Les artistes savent que le naturel ne peut être le simple fruit d’un don, il n’est que celui d’un travail acharné, d’une constante surveillance exercée sur la plume, mais en tout cas le contraire d’une désinvolte aisance.
Jean Françaix reste donc un musicien à découvrir et à réévaluer, ne serait-ce que parce que des œuvres comme La Princesse de Clèves ou les Trois Poèmes de Paul Valéry sont à même, par leur hauteur de vue et la densité qui préside à leur élaboration, d’assurer la plus haute mission et la plus noble ambition de l’art, c’est-à-dire de faire de chacun de nous un acteur conscient, engagé et indulgent de l’humanité.
________________________
JEAN FRANÇAIX ET L’APOCALYPSE
Parmi les compositeurs qui approchent aujourd’hui de la maturité de l’âge et du talent, Jean Françaix est peut-être le seul que l’on sente à l’aise dans son temps, dans son œuvre et, pour ainsi parler dans sa peau. En lui le don, la science et la conscience font aussi naturellement bon ménage qu’en Joseph Haydn, modèle si grandement enviable et si rarement envié du génie disponible et du bonheur quotidien. Combien de musiciens de ce temps (je pense, en particulier, à nos jeunes Prix de Rome) ont acquis les moyens de cette heureuse disponibilité et ne savent qu’en faire dans un monde qui achève de perdre son unité de conscience : que de paroles perdues, que de temps gâché à poursuivre l’impossible à travers l’inutile, à s’interroger sur ce qu’il faut faire quand l’art vit de « comment » et meurt de ses « pourquoi » !
La critique, participant du même désarroi, adopte le même langage : pourquoi, demande-t-elle, pourquoi Jean Françaix, qu’une allègre fraîcheur destine à la musique de demi-caractère, s’attaque-t-il aux mystères terribles de l’Apocalypse ? Pourquoi ce compositeur de ballets veut-il se hausser sur les cimes de la spiritualité ? Au fait, pourquoi Mozart a-t-il écrit, à quelques jours de distance, un Rondo pour orgue mécanique et le sublime Ave verum corpus ?
La vérité est que Jean Françaix est suffisamment maître de ses moyens pour se sentir disponible à toute invention. Quant aux raisons qui l’ont décidé à sacrifier à l’oratorio et à choisir le texte de l’Apocalypse, nous n’avons à les juger qu’en fonction du résultat. Et le résultat emporte l’adhésion par les moyens les plus simples et les plus nobles du monde. L’Apocalypse est un grand ouvrage pour soli, chœur et deux orchestres qui vaut d’abord et surtout par l’unité sereine de la composition : sobriété du langage et du ton, retenue de l’expression qui rejoignent l’esprit de la liturgie sans emprunt apparent à la lettre.
L’auditeur des grands concerts se fait une idée bien différente de l’Apocalypse. Le mot seul, avec ses résonances de catastrophes, évoque la grande ferblanterie tétralogique et cette touffeur érotico-mystique dont le remugle empoisonne presque toute la musique contemporaine qui se dit religieuse.
La partition de Jean Françaix ne fait pas beaucoup de bruit. Elle s’installe, dès le début, dans un climat de tendresse et de simplicité hiératique. Elle ne le quittera que pour donner audience aux puissances infernales, par le truchement d’un second orchestre, lui-même discret, où saxophones, mandoline et accordéon composent une musique de cauchemar, et j’avoue que cet enfer interlope et familier me paraît plus terrifiant que les grandes machines d’opéra.
On a tellement tiré sur les ficelles à propos des sujets bibliques qu’on en est venu à oublier que l’émotion religieuse se traduit mieux par le recueillement que par l’exaltation, et qu’elle vaut moins par l’extase que par le sacrifice.
Cette musique calme et blanche en son lyrisme dépouillé, où chaque note semble déduite d’une nécessité, ne nous fait pas l’injure de se substituer à nous pour prier à notre place. La magie n’est pas de son fait. Elle mène son auditeur au seuil de la prière et l’y laisse en suspens. Là s’arrête son rôle qu’elle a le rare mérite de ne jamais outrepasser. C’est ici que la moitié vaut mieux que le tout.
Je ne vois qu’un ouvrage, dans la musique de notre temps, qui rende, par des moyens fort différents, un son aussi purement, aussi humblement spirituel que celui-ci, c’est la Symphoniede Psaumes d’Igor Stravinsky. Et cette comparaison qui s’impose, sans éveiller par ailleurs l’idée d’une influence, fait le plus bel éloge de Jean Françaix.
L’Apocalypse, composée au cours des quatre années d’occupation, n’est pas une œuvre nouvelle, mais sa parfaite interprétation par Manuel Rosenthal, l’Orchestre National, Claudine Verneuil, Joseph Peyron, Yvon Le Marc’Hadour et les chœurs d’Yvonne Gouverné nous ont persuadés que nous l’entendions pour la première fois. ◊
CATALOGUE DES ŒUVRES
BIBLIOGRAPHIE
- BELLIER, Muriel. Caractéristiques des ballets de Jean Françaix, mémoire de D.E.A., Université de Lyon, 1991.
- BELLIER, Muriel. Actes du Colloque international « Connaître ou reconnaître l’œuvre de Jean Françaix » tenu à Paris (Fondation Singer-Polignac) et au Mans (Palais de Congrès) en Novembre 1999, Paris, Cercle des Amis de Jean Françaix, 2001.
- GOUBAUD, Christian. Juvenalia, La Cantate de Méphisto, Le Diable boiteux, L’Apocalypse de Saint Jean, La Main de Gloire, La Princesse de Clèves, Ode à la Gastronomie, in Dictionnaire des Œuvres de l’Art Vocal, sous la direction de Marc Honegger et Paul Prévost, Paris, Bordas, 1991.
- LANJEAN, Marc. Jean Françaix, musicien français, Paris, Editions Contact, collection « Élites de notre temps », 1961.
- De la musique et des musiciens, ouvrage publié par la Fondation Singer-Polignac et rassemblant une biographie du compositeur ainsi que des allocutions prononcées par Jean Françaix lors de concerts à la Fondation, 1999.
DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE
La présente discographie regroupe des références récentes disponibles en CD. Le but de la présente démarche n’est pas de dresser un catalogue exhaustif de toutes les références discographiques incluant des œuvres de Jean Françaix, mais de proposer un parcours de découverte à l’auditeur curieux.
Œuvres vocales
- L’Apocalypse de Saint Jean. Marie-Noëlle Cros (Soprano), Sophie Rebindher (mezzo), Patrick Garayt (ténor), Pierre-Yves Pruvot (basse), Chœur Français d’Oratorio, Chœur de garçons « Dudaryk » de Lviv (Ukraine), Chœur Elisabeth Brasseur, Ensemble vocal de Saint Quentin en Yvelines, Orchestre « Leopolis » de Lviv (Ukraine), Orchestre Français d’Oratorio, Jean-Pierre Loré. CD Erol.
- Une autre version, tout aussi recommandable du même ouvrage est disponible sous étiquette Wergo.
Œuvres symphoniques
- Sérénade BEA, Symphonie d’archets, Portraits d’enfants, Six Préludes pour orchestre à cordes. Orchestre de chambre National de Toulouse, Alain Moglia. CD Pierre Verany.
- Scuola di Ballo (version symphonique), Ouverture anacréontique, Pavane pour un génie vivant, Sérénade, Symphonie en sol majeur. Ulster Orchestra, Thierry Fischer. CD Hypérion.
- Les malheurs de Sophie, Les Bosquets de Cythère, Concertino pour piano et orchestre. Philippe Cassard (piano), Ulster Orchestra, Thierry Fischer. CD Hypérion.
- Le roi nu, Les Demoiselles de la nuit. Ulster Orchestra, Thierry Fischer. CD Hypérion.
Œuvres concertantes
- Concertino pour piano et orchestre, Concerto pour piano et orchestre. Ian Hobson (piano), Sinfonia da Camera of Illinois. CD Arabesque.
- Concerto pour guitare et orchestre, Concerto pour 2 harpes et orchestre à cordes, Symphonie d’archets. Alain Prevost (guitare), Huguette Geliot et Sabine Chefson (harpes), Orchestre Stringendo, Jean Thorel. CD Cybélia.
- Concerto pour 2 pianos et orchestre, Variations sur un thème plaisant, 5 Portraits de jeunes filles. Claude et Jean Françaix (pianos), Sinfonieorchester des Südwestfunks Baden-Baden, Pierre Stoll. CD Wergo.
- Concerto pour guitare et orchestre, Concerto pour clavecin et ensemble instrumental, Trio pour violon, violoncelle et piano. Emanuele Segre (guitare), Jean Françaix (clavecin et piano), Saschko Gawriloff (violon), Johanes Goritzki (violoncelle), Rundfunk Sinfonie-Orchester Saarbrücken, Emile Naoumoff. CD Wergo.
- Fantaisie pour violoncelle et orchestre, Variations de concert pour violoncelle et cordes, 6 Pièces pour violoncelle et piano, Scuola di celli. Henri Demarquette (violoncelle), Orchestre de Bretagne, Jean Françaix (piano et direction). CD Pierre Verany.
- Concerto pour flûte et orchestre (couplé avec des œuvres de Cécile Chaminade, Jules Mouquet et Jacques Ibert). Manuela Wiesler (flûte), Helsinborg Symphony Orchestra, Philippe Auguin. CD Bis.
- Concerto pour violon et orchestre, Les Malheurs de Sophie (extraits), Symphonie en sol majeur. Yioriko Naganuma (violon), Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Jean Françaix. CD Erol.
- La Princesse de Clèves, suite pour hautbois et orchestre (couplée avec des œuvres de Gabriel Grovlez, Georges Hugon, Gabriel Fauré, Charles Kœchlin, Gabriel Pierné et Eugène Bozza). Lajos Lencsès (hautbois), Orchestre de chambre National de Toulouse, Alain Moglia. CD Capriccio.
Musique de chambre
- Octuor pour clarinette en si bémol, cor en fa, basson, 2 violons, alto, violoncelle et contrebasse, Quintette pour clarinette en si bémol et quatuor à cordes, Divertissement pour basson et quintette à cordes. Ensemble Carl Stamitz. CD Pierre Verany.
- 11 Variations sur un thème de Haydn, Mozart new-look, Musique pour faire plaisir, Hommage à l’ami Papageno, Quasi improvisando, Danses exotiques. Jean Françaix (piano), Bläser Ensemble Mainz, Klaus Rainer-Schöll. CD Wergo.
- Scuola di Ballo (version 2 pianos, couplé avec des œuvres de Frantz Schubert et Emmanuel Chabrier). Claude et Jean Françaix (pianos). CD Erol.
- Quatuor à cordes, Sonatine pour violon et piano, Thème et variations pour clarinette et piano, Divertissement pour trio à cordes et piano, Dixtuor pour quintette à vents et quintette à cordes, 8 Bagatelles pour quatuor à cordes et piano, Nonette d’après le Quintette K. 452 de Mozart. Octuor de France. CD Erol.
- La Promenade d’un musicologue éclectique, 5 Portraits de jeunes filles, De la Musique avant toute chose, Sonate pour piano, Scherzo, 5 Bis. Alfonso Gómez (piano). CD Erol.
Portfolio
 |
 |
|
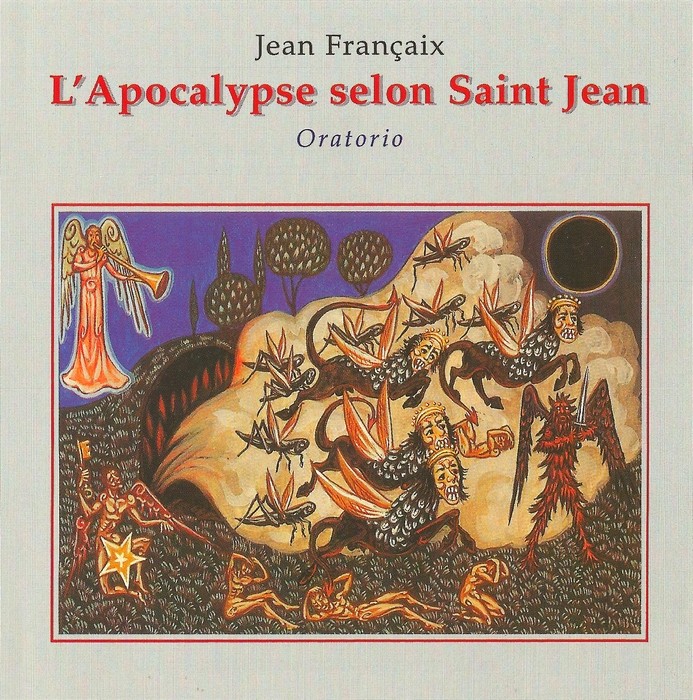 |
 |
|
 |
 |
|
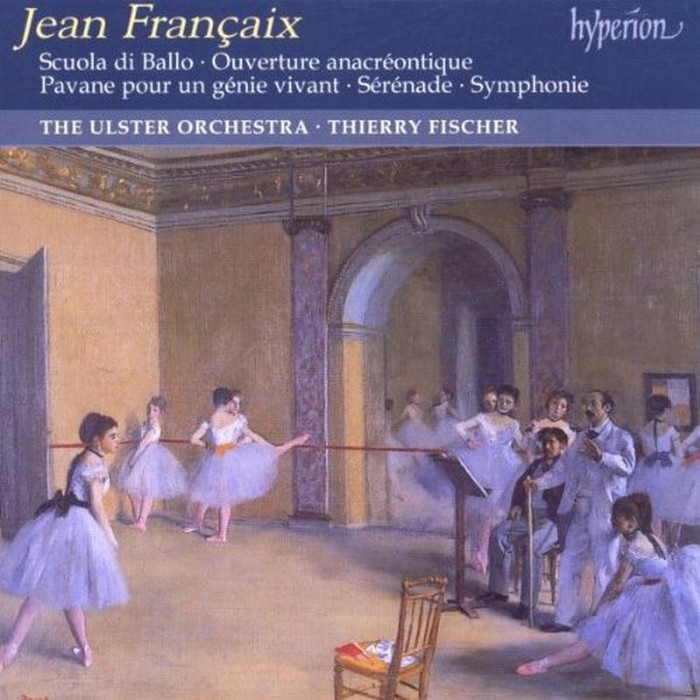 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
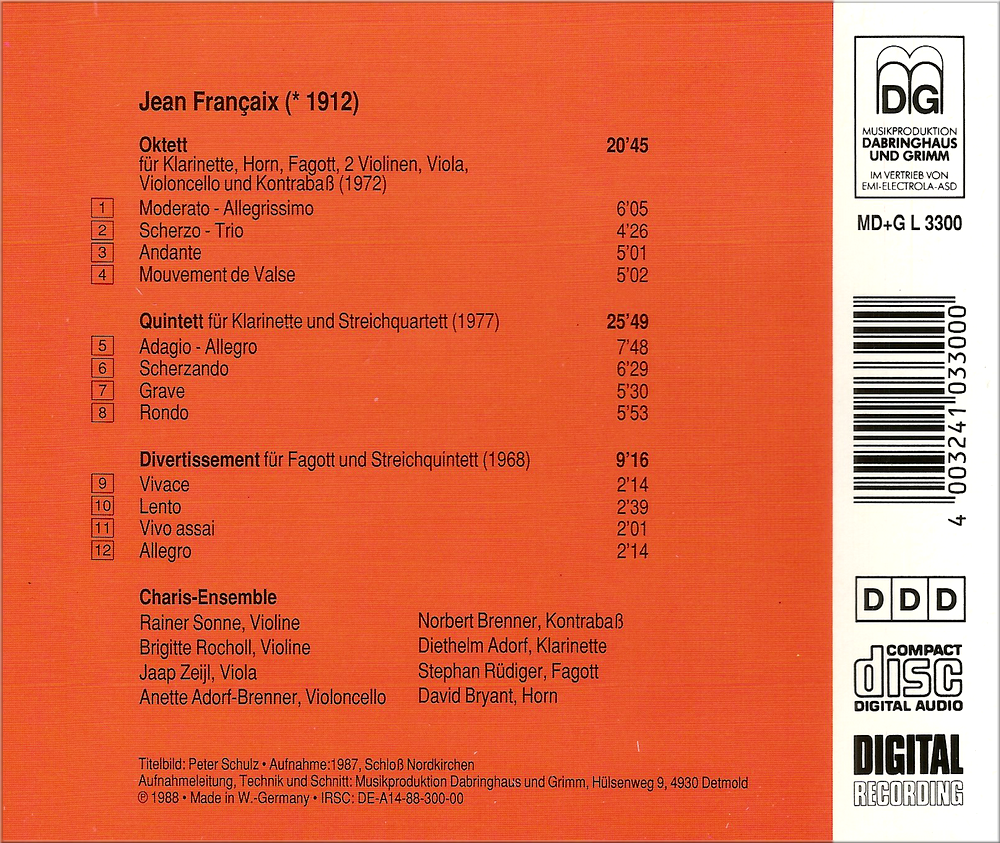 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
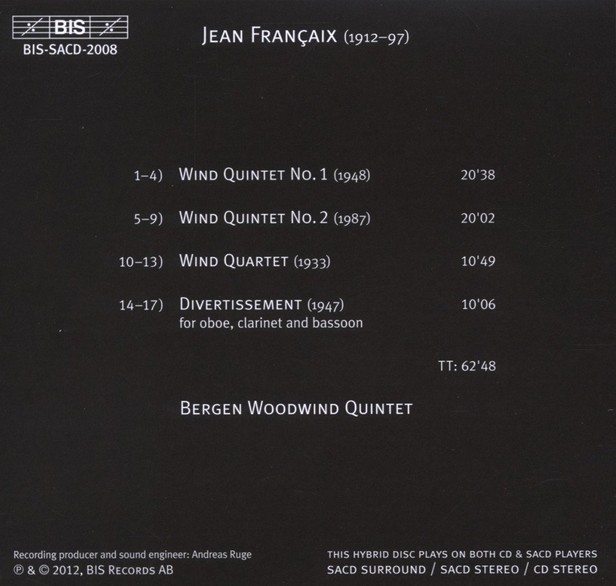 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
Partager sur :

