SAGAN Françoise

Françoise SAGAN (1935-2004)
« […] J’aime beaucoup Le garde du cœur, le seul roman policier qu’elle ait écrit, que je trouve cocasse et audacieux ; Des bleus à l’âme parce que c’est un livre où elle se regarde en train d’écrire et où je la retrouve, trait pour trait, dans certaines des ses attitudes, de ses réflexes de vie… J’aime aussi Avec mon meilleur souvenir parce que je retrouve les amis et les moments que j’ai connus, également cette amitié et cette tendresse totalement indéfectible qu’elle avait pour certains personnages qu’elle a croisés au cours de sa vie.
[…] Il est difficile d’attribuer aujourd’hui une place précise à l’œuvre de Sagan dans le patrimoine littéraire francophone. Je pense qu’il y a des gens qui l’aiment vraiment et ces gens sont nombreux, je l’espère, et pour ces gens là elle est un trésor, c’est vrai ; et un trésor c’est un patrimoine, non ?»
Dossiers
Pourquoi Sagan ?
Lionel Pons
Marseille, dimanche 3 septembre 2017
La question posée pourrait relever – et tel est en partie le cas – de ce que Goethe appelle le mystère des affinités électives, et dès lors tenter d’y répondre relèverait de la gageure d’avance perdue. Que tel auteur nous touche à tel moment de notre vie n’est pas toujours explicable, et plus encore tenter une compréhension du phénomène reviendrait à dissiper un mystère qui doit demeurer entier, celui qui nous lie à une œuvre d’art par un mouvement du cœur.
Mais qu’un texte consacré à une romancière apparaisse sur le site d’une association dont le but premier est la défense de compositeurs méconnus ou peu étudiés peut légitimement poser question. Force m’est donc de tenter d’y répondre. Non que la passion que nous pouvons ressentir pour des auteurs, des œuvres littéraires ou poétiques, ait à se justifier en quoi que ce soit, mais la démarche me vaudra au moins le bonheur de retracer ce qui est autant une rencontre musicale que littéraire.
Comme pour beaucoup d’enfants de ma génération, Françoise Sagan avait été lue par mes parents, et le souvenir de Bonjour tristesse et Aimez-vous Brahms sur l’étagère, toujours tentante, des livres « que tu pourras lire plus tard », ne s’est pas effacé de la mémoire du lecteur en devenir que j’étais alors. La lecture du premier, venue à l’adolescence, m’avait laissé le goût d’un fruit à la fois doux et amer, une promenade au bord de l’océan d’une tristesse dont l’auteur donnait par instant à voir le fond, sans tomber dans un propos expressionniste.
Sur les ondes de France Culture, bien plus tard, ce furent des pages des Faux-fuyants lues dont l’humour masquant la gravité du propos me frappait.
La « légende Sagan », dont les journaux se faisaient l’écho, occultait alors souvent l’auteur, dont le retrait de la vie publique n’allait pas tarder à m’éloigner. Il aura fallu la rencontre estivale avec des romans redécouvert, et surtout la maturité venue pour que je plonge dans un univers dont je n’avais que superficiellement envisagé la richesse.
Le ton Sagan, c’est d’abord une langue fluide, à l’élégance indéniable. Les phrases se déploient en courbes successives, mais la tentation proustienne est toujours équilibrée par un sens de l’équilibre, de la mesure. L’auteur a, dans l’épitaphe qu’elle avait conçue pour elle-même bien à l’avance, qualifié son œuvre d’ « aimablement bâclée ». Combien de critiques se sont laissés prendre à cette assertion ! Il y a bien une apparente nonchalance dans la gestion du rythme à la fois de la phrase et du récit, mais elle est le fruit d’une technique éprouvée, d’un espace voulu qui laisse, en lieu et place d’un long monologue ou d’une plongée psychanalytique, s’épanouir le non-dit. Il y a une atmosphère Sagan comme il existe une atmosphère Simenon. Mais peut-on taxer de nonchalance la gestion classique et rigoureuse de la dynamique romanesque ? Peut-on parler de « bâclé » à propos d’un théâtre incisif, précis, exigeant, dans lequel les échanges comme lancés sans y penser par les personnages en disent plus long que tel becquet classique ? Sagan est une néo-classique du roman, jamais elle ne se préoccupe du genre en tant que dogme. En artisan des lettres, elle considère qu’il y a un large mérite à savoir utiliser un outil (le roman, la nouvelle, la pièce de théâtre de conception classique), et que cette maîtrise technique pose autant sinon plus de problèmes que de se poser en déconstructeur ou en dynamiteur.
La construction du récit a la beauté classique, l’élégance parfaite, la pudeur, le sens de la description économe qui signent les chefs-d’œuvre. De plus, lire un roman de Sagan ne livre qu’un aspect d’une réflexion que l’auteur, sans le théoriser jamais, en véritable pudique qu’elle était, n’a cessé de creuser d’œuvre en œuvre. Impossibilité de vivre à visage découvert, fugacité de l’amour, mélancolie plus résignée que désabusée en sont les axes de force. Là où nombre de lecteurs ont vu l’expression d’un cynisme désabusé, j’ai cru lire les « bleux à l’âme », une capacité d’indulgence pour le genre humain qui n’a rien d’une indifférence glacée ou d’un blanc-seing hâtivement signé. De roman en pièce, de nouvelles en chroniques, l’envie m’a peu à peu saisi de prendre la plume, non pas en prétendant livrer sur Sagan quelque vérité dont je serais devenu dépositaire, mais simplement en explicitant ce qui peut toucher un lecteur naïf qui veut bien entreprendre un voyage dans cette prose dont la langue ne vieillit pas, ne peut vieillir, tant elle est hors du temps.
Dans le demi-jour, dans le clair-obscur qu’elle entretient, dans cette douceur qui peut accompagner l’effritement des sentiments ou les déchirements de l’absence, Sagan nous attend, et l’œuvre vaut bien une visite ou un témoignage, dont je ne peux qu’espérer qu’il donnera envie aux lecteurs occasionnels de partir, eux aussi, à la poursuite des Merveilleux Nuages. □
LE STYLE DE FRANÇOISE SAGAN OU L’IMPOSSIBLE DÉVOILEMENT
Plus de dix ans après sa disparition, le 24 septembre 2004, l’œuvre de Françoise Sagan tend peu à peu à prendre sa place véritable dans la littérature française. La célébrité tôt venue – et avec quel éclat ! –, le parfum de scandale qui a accompagné la publication de Bonjour tristesse le 15 mars 1954, les feux parfois trop brûlants de l’actualité, la légende qui s’en est trouvée forgée autour d’un auteur qui, tout en s’accommodant tant bien que mal, n’en demandait pas tant, tout cela à quelque peu occulté l’œuvre en elle-même.
De surcroît, dans ces années 1950-1960 marquées, dans chaque discipline créatrice, par une réflexion de fond, une remise en question radicale des formes et des cadres, Sagan est restée fidèle à des choix opérés précocement, simplement parce qu’elle les opérait en conscience : le roman de construction classique, l’étude des personnages, un art de l’étude presque entomologique du sentiment amoureux et de son délitement, un théâtre du dialogue. L’époque aime les classifications qui simplifient tellement le regard porté qu’elles finissent par le remplacer purement et simplement : roman néoclassique, théâtre élégant et boulevardier, matière romanesque indigente, complaisance à mettre en scène un milieu social refermé sur lui-même, dont les personnages ne seraient que de pâles et fragiles fleurs de serre, vivotant dans une atmosphère méphitique. La célébrité du mythe Sagan n’a pas dissipé ce malentendu quant à l’œuvre de Sagan, et si de récents travaux universitaires tendent à mettre en lumière les spécificités et l’intérêt d’un legs littéraire conséquent, la pleine reconnaissance tarde à venir, et tels sanctuaires pléiadiens qui ont accueilli – et à juste titre – plusieurs contemporains de Sagan, français ou étrangers, n’envisagent purement et simplement pas de faire à l’auteur de La Femme fardée un accueil comparable. La « petite musique », qui refuse le clinquant et le bruit gratuit ne tonitrue pas, ne se réclame d’aucun dogme religieux ou littéraire – elle les fuirait bien plutôt avec constance ! –, ne théorise pas ce qu’elle expose, et cette liberté vécue autant que créée par le verbe se paie cher. Certes, le nom de Sagan n’a jamais disparu, les lycéens ont parfois la chance de se voir proposer la lecture de Bonjour tristesse, de récentes rééditions permettent de découvrir quasiment l’ensemble de l’œuvre1, mais ce que la célébrité rend persistant semble entraîner un dédain condescendant de la critique littéraire. Le propre des petites musiques, c’est naturellement d’être couvertes par les fanfares, les grandes orgues et les voix déployées, qu’elles existent, on le leur concède, mais doucement, en ayant presque l’air de s’en excuser !
Or, précisément, les années qui passent rendent plus lointaines les secousses de la légende de Sagan, du « charmant petit monstre » salué – avec acuité – par François Mauriac dès 1954, s’éloignent dans le temps, et le cœur de l’œuvre peut commencer à battre indépendamment des apparences, des idées reçues, de l’écran que la pudique Sagan avait laissé s’échafauder, quitte à fausser la réception de l’œuvre.
Le masque de verre
Il est un fait certain que le sentiment amoureux demeure au centre de la création saganienne, et d’aucuns ne se sont pas privés de le dénoncer : encore un roman d’amour qui se défait, l’idée n’est pas neuve. Voire, en premier lieu, la chose serait à démontrer, en second, la vraie question serait de définir autant que possible quel sentiment amoureux mobilise, de façon récurrente, l’inspiration de l’auteur.
Dès Bonjour tristesse, cette définition est brossée, sans aucune théorisation, mais avec une clarté, et plus encore une lucidité, une maturité qui forcent l’admiration. Cécile n’aime pas Cyril, qui n’est qu’un accident de parcours. Ce qui a choqué une partie du public de l’époque est bien le détachement avec lequel Cécile envisage sa relation avec Cyril : un moment agréable, un prolongement de la langueur torpide de l’été, un substitut à ce qu’elle ne vit pas avec son père. Mais que manque-t-il à cette relation pour qu’elle soit complète, réelle, puisque ne lui fait même pas défaut l’accomplissement dans la chair ? L’amour chez Sagan est, dans son essence la plus intime, la plus secrète, la plus nécessaire, un dévoilement. Tant que cette phase du dévoilement n’est pas atteinte, complète et consentie, la relation demeure incomplète. Le problème central du sentiment amoureux saganien est que ce dévoilement est pour les êtres d’abord une douleur. Chaque personnage de Sagan, des plus secrets (Cécile dans Bonjour tristesse, Dominique dans Un certain sourire, Fanny dans Dans un mois dans un an) aux plus extravertis (Constantin dans Un sang d’aquarelle, Bruno dans Les Faux-fuyants), n’avance dans la vie que pourvu d’un masque de verre. Si la romancière a principalement mis en scène un milieu social aisé, comme exempté d’histoire car à l’abri des convulsions du siècle, c’est parce que cette situation rend le masque nécessaire. Chacun est condamné à appartenir à une catégorie avant d’exister en tant qu’être : comédien, mondaine, gigolo, mari indifférent et poliment tolérant. Que le masque soit conduit à tomber, et le personnage perd d’abord sa place dans l’échafaudage complexe de la société, en plus de perdre le repère qu’il s’est lui-même forcé. L’Andréas de La Femme fardée ne se suicide pas tant sous le coup d’un désespoir amoureux que face à l’incapacité de vivre sans ce masque du gigolo, qu’il vient précisément d’ôter par amour. Fussent-ils des mondains épris d’image, extravertis jusqu’à en paraître parfois insupportables, les personnages de Sagan sont d’abord et avant tout des pudiques, le masque de verre qu’ils portent n’est pas un accessoire, il est l’équivalent d’une armure fragile.
Devoir avancer démasqué est pour eux insurmontable, le masque de verre est leur ultime protection face à ce que leur fragilité intime ne peut parer. Sans nous lancer dans un raccourci téméraire, l’admiration de Sagan pour Jean-Paul Sartre2 n’est pas qu’un mouvement du cœur d’être à être ; la timidité, la pudeur, la crainte du dévoilement qui hantent la totalité des personnages saganiens les rend tiraillés entre deux aspirations contraires : d’une part, exister à travers le regard des autres et la conformité à l’étiquette qui vous est ainsi attribuée, d’autre part ne pas pouvoir vivre sans cette étiquette-masque, quitte à étouffer, ce qui fait d’autrui une contrainte redoutable, dans le prolongement de ce que décrit Sartre dans Huis-clos. S’il y a coïncidence entre les débuts de Sagan et la fin de la mode de l’existentialisme des caves de Saint-Germain-des-prés, c’est certes une simple rencontre chronologique, et la « condamnation à être libre » sartrienne relève de ces contraintes que Sagan sait rejeter toujours avec l’énergique entêtement des timides. Sans être d’obédience existentialiste, l’œuvre de Sagan ne cesse de vivre « l’autre » comme celui devant qui l’on ne peut vivre que masqué, conforme à une image. Les amis dont elle a toujours cherché à être entourée, n’avaient rien à voir avec la cour de flatteurs que la presse à parfois fabriquée, mais tout avec un cercle restreint3 devant qui, temporairement, le masque pouvait tomber.
Les exemples de cette thématique du masque son extrêmement nombreux dans l’œuvre :
-
dans Bonjour tristesse, si Cécile n’aime pas Cyril, c’est qu’elle ne peut devant lui être réellement elle-même, mais seulement une adolescente blasée, un peu cynique, mais ne se reconnaît pas la possibilité d’avancer dévoilée.
-
dans De guerre lasse, Charles Sambrat, se trouve démuni face à au sentiment qu’Alice lui inspire. Pour le vivre, il lui faut accepter désormais de n’être plus l’artisan d’une vie facile, soigneusement tenue à l’écart des vicissitudes du temps4, et c’est « de guerre lasse » qu’il y consent. Mais l’accepte-t-il vraiment ? Son entrée dans la Résistance, dans l’ultime phrase du roman, fait suite à l’impossibilité de vivre son histoire d’amour avec Alice. Ayant renoncé au masque de verre du cynique indifférent, il en emprunte immédiatement un autre, celui du Résistant indépendant, comme si vivre sans ce secours était aussi difficile que de respirer sans oxygène.
-
plus drôle, le groupe de parisiens mis en scène dans Les Faux-fuyants provoque le rire précisément parce que, ballotés par la guerre, condamnés temporairement à vivre en dehors de tout repère lié à leur masque de verre dans une ferme de la Beauce, ils n’évoluent plus que maladroitement, pris dans un lacis de pulsions et d’aspirations qu’il leur faudrait accepter sans les discipliner. Le coup de théâtre final, qui peut apparaître comme parfaitement gratuit à une lecture superficielle, traduit en fait ce qui est une réalité profonde : sans leur masque de verre de femme du monde, d’épouse volage sentimentale, de gigolo, de diplomate blasé homosexuel, aucun ne peut survivre, il ne leur reste qu’à disparaître, ce que la guerre et le mensonge permettent.
-
Le thème se généralise dans La Femme fardée. Le titre primitif devait être Narcissus, du nom du navire sur lequel se déroule la croisière en forme de huis clos, et l’une des raisons du changement du titre est peut-être la nécessité de matérialiser l’essence des personnages, qui dicte d’ailleurs leurs rapports. Chacun avance masqué, et Clarisse plus que tout autre, la couche de fard en étant la traduction visuelle. Se démasque-t-elle, elle se révèle alors fondamentalement différente, et physiquement et mentalement de ce qu’elle paraissait. La conséquence de ce dévoilement est le dérèglement, voire l’inversion des rapports entre tous les passagers de la croisière, chacun se retrouve renvoyé à sa propre essence, et la confrontation n’est pas des plus facile. Le dévoilement est difficile pour soi, mais par ce qu’il remet en question d’édifice social, il l’est paradoxalement pour autrui.
-
dans Château en Suède, le jeu imposé par Agathe à tous les habitants du château, soit de vivre en habit XVIIIe, peut apparaître comme un caprice prétexte à un artifice de mise en scène. Mais il n’est, en réalité, que la traduction visuelle du jeu dans lequel les personnages, hors Frédéric, s’enferrent. Dès que l’amour entre Frédéric et Eléonore en passe les bornes, dès qu’il cesse d’être un élégant marivaudage strictement limité par des échanges de mots d’esprit, il n’est plus tolérable, car il forcerait dès lors tous les Falsen à faire tomber leur masque. Frédéric doit disparaître non pas comme « celui par qui le scandale arrive », mais bel et bien comme celui « par qui le réel advient », pour que les masques puissent rester en l’état, portés autant que rassurants.
-
dans Les violons parfois, l’amour de Charlotte pour Léopold se heurte au fait que, pour le vivre pleinement, Charlotte doit cesser d’être une basse intrigante, la « chose » d’Antoine, passive et cruelle. De toute évidence, le masque n’est pas conforme à la réalité de l’âme – et c’est bien là le drame des figures saganiennes – mais il ne saurait être question de vivre sans, encore moins sans un masque de substitution, et ce qui explique in fine le renoncement en apparence incompréhensible de Charlotte.
La seule exception notable à cette configuration est la Valentine de la Robe mauve de Valentine. Son amour pour Jean-Lou est cet espace privilégié dans lequel aucun masque n’est porté, mais pour privilégié qu’il soit, il n’en demeure pas moins exempt de sécurité. La robe mauve qu’elle endosse lorsqu’elle devient, à l’acte I, la tante pleine de charme évanescent de Serge, la sœur égarée de Marie matérialise le masque dont elle ressent périodiquement le besoin de se couvrir à nouveau. Si elle ne peut, ne fût-ce que par intermittence, jouer à nouveau masquée au jeu social, quitte à briser un cœur au passage, elle se sent amputée d’une notable part d’elle-même. Le masque n’est pas une contrainte, il est un besoin, c’est vivre démasqué qui expose l’être à une vie insoutenable dans la fragilité à laquelle elle condamne. En somme, il est impossible de vivre sans masque, autant qu’il est impossible de vivre constamment masqué, dilemme que vivent les personnages d’Un piano dans l’herbe et dont ils ne peuvent ni sortir ni trouver la solution.
Cette pudeur fondamentale, essentielle, incompressible des personnages va jouer un grand rôle dans la figuration du sentiment amoureux chez Sagan. S’il demeure au centre de la mécanique romanesque, il n’en est pas moins directement subordonné à cette dynamique pudique du masque.
Une certaine vision de l’amour
Le rapport des personnages saganiens au sentiment amoureux semble, et la critique s’y est souvent trompée, fondé sur un alliage entre nécessité et détachement. Les liens complexes qui se tissent entre les personnages de Dans un mois dans un an, et dont Sagan parvient à restituer l’entrelacement avec une concision qui force l’admiration, semblent toujours se doubler de l’acceptation de la fugacité du sentiment en question. Dans Le Miroir égaré, cette conscience de la caducité agit comme un frein, un facteur limitant à tout développement amoureux.
De là à taxer l’univers saganien de cynisme généralisé, il n’y a qu’un pas, la romancière se ferait le témoin d’une société en perte de repères, et la famille autant que l’amour ne peuvent que s’y déliter. Or, si elle se garde toujours avec le plus grand soin d’être moralisatrice, Sagan n’en est pas moins un moraliste, dans le prolongement de ceux des XVIIe et XVIIIe siècles, qui ne porte aucun jugement sur les mœurs qu’elle peint. Mais l’accusation de cynisme ne tient pas une seconde en face de la réalité des personnages. Tous sont, en quelque sorte, des athées de l’amour. Non qu’ils n’y croient pas, puisque tous sans exception en confessent le besoin presque désespéré, ce dont témoigne avec finesse le lacis de Dans un mois dans un an, mais tous sont conscients intimement que l’amour est synonyme de dévoilement obligé autant que total. Or, le dévoilement est par essence insupportable, comme nous l’avons souligné.
Tout personnage amoureux ou en quête d’amour se trouve donc pris entre deux nécessités antithétiques : se dévoiler, en faisant de l’amour ce don total de soi, et conserver comme une ultime protection contre cette capacité de blesser qu’autrui conserve sur la fragilité des personnages. L’amour ne peut donc, et c’est bien là tout le tragique saganien, s’inscrire dans la durée. À défaut d’un « pour toujours », il lui faut admettre dès son émergence le « pour le plus longtemps possible » montherlantien5, et cette acceptation ne se fait pas sans douleur.
L’acceptation de la fugacité fait mal, et cette seule dimension suffit à récuser l’accusation de cynisme généralisé dont la critique a trop souvent affublé le « charmant petit monstre ».
Julius A. Cram, dans Un profil perdu, conçoit l’amour comme un don, et par conséquent comme une possession. Cette dernière n’étant possible ni totalement ni durablement, il ne peut survivre à son propre besoin, et sa mort s’impose non comme un coup de théâtre – ce pour quoi son intervention dans les dernières lignes du roman pourrait le faire passer – mais comme le prolongement logique et tragique de la vision proposée du sentiment amoureux.
L’amour existe, il est nécessaire et pourtant le masque de verre nous en sépare, même si sa pseudo-transparence laisse parfois planer le doute. Constantin Von Meck – et le choix d’un nom qui renvoie à la mécène de Tchaïkovski n’est en rien innocent ici6 –, dans Un sang d’aquarelle, sent confusément puis de plus en plus nettement que sa relation avec Romano ne peut ni être exclusive, ni durable, sauf à lui imposer ce caractère, pas plus que ne peut l’être l’amour vécu et revécu avec Wanda. La difficulté d’accepter le dévoilement se double d’une difficulté à comprendre la limitation dans le temps non pas du sentiment amoureux lui-même, mais de la capacité des êtres à le vivre. Si ce cap est surmonté, et c’est en somme ce à quoi parviennent Frédéric et Hanaé dans L’Excès contraire, alors la tendresse peut s’installer, mais elle est l’équivalent de la porte étroite gidienne, et bien peu y auront accès.
Il n’existe ni mépris, ni rejet, ni dévaluation de l’amour chez Sagan, bien au contraire. Dans Aimez-vous Brahms …, Paule ne cesse de confesser, ou tout du moins de prendre conscience de son besoin de l’amour de Roger, même si sa durée dans le temps se révèlera forcément limitée. Néanmoins, l’acceptation du besoin qu’elle en peut développer ne débouchera pas pour autant sur la certitude de la durée de ce sentiment.
La Chamade présente une synthèse de la vision saganienne de l’amour. Lucile et Charles présentent une acceptation de l’amour « pour le plus longtemps possible », en sachant que tous deux, ayant admis l’inéluctabilité du masque de verre, connaissent la réalité de l’autre, avec ses failles, ses passades, ce en quoi ils finissent par prolonger le couple Fanny-Alain de Dans un mois dans un an.
La mécanique du roman
Certains critiques n’ont pas manqué de souligner parfois la minceur de la matière romanesque chez Sagan. Il est un fait que, si l’on s’astreint à rechercher chez la romancière un équivalent de la construction romanesque issue du XIXe siècle, son point de vue apparaîtra comme sensiblement différent. Pour autant, les tenants du nouveau roman ont toujours vu en Sagan une néoclassique du roman, attaché à un fil narratif autant qu’à la construction de personnage. Entre les deux, où se situe la réalité de la construction romanesque saganienne ?
Bonjour tristesse pose en principe une construction romanesque très proche de l’acception de la tragédie classique, en l’occurrence la triade exposition-péripétie-catastrophe. La première partie du roman répond à une exposition dans les règles, l’arrivée d’Anne correspondant à la péripétie qui est à l’origine du déclenchement de la catastrophe. La construction en flash-back du roman (lorsque Cécile commence à narrer l’histoire, celle-ci est déjà parvenue à son terme) se superpose à une vision classique, que renforcent le style épuré, l’absence de personnages, intrigues ou descriptions secondaires et la quasi unité de lieu, de temps et d’action. Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître, car loin de se ressentir de ces contraintes, le roman y puise une forme d’exigence, de précision lapidaire, d’art de la litote qui l’exempte de tous les défauts inhérents aux premiers essais.
Par la suite, Sagan ne renonce jamais à une construction rigoureuse, à ceci-près que c’est l’équilibre de la triade qui va se trouver questionné. Nous avons déjà mentionné le côté soudain de la catastrophe, aussi bien dans De guerre lasse ou des Faux-fuyants. C’est que la romancière fait assez volontiers le sacrifice de ce coup de théâtre que le XIXe privilégie, elle agit comme un entomologiste observant au microscope une phase de la relation amoureuse. L’équilibre classique se trouve infléchi du côté de la péripétie. Le moment où le masque doit totalement ou partiellement être ôté, que ce soit dans une démarche amoureuse ou dans un autre contexte, compte infiniment plus que la catastrophe elle-même. Or, le roman évènementiel s’attache beaucoup plus à la gestion des coups de théâtre, sur lesquels repose l’envie du lecteur de poursuivre la découverte de l’œuvre.
Si donc nous nous en tenons à ce point de vue comparatif, la matière romanesque de Sagan tient à cette technique d’observation au ralenti de la péripétie dévoilante. L’ensemble de La Femme fardée est conçu comme un exercice d’observation qui refuse le raccourci, quand bien même le lecteur aurait capacité ou tentation d’anticiper sur le récit lui-même. Le navire retranche les personnages de toute référence extérieure, il les immobilise sous le regard de l’auteur, de même que la ferme dans Les Faux-fuyants, la maison de Charles dans De guerre lasse, les lieux de quasi-clostration dans Un profil perdu qui vont accompagner la mutation sentimentale des héros.
La mécanique romanesque va évoluer tout au long de la vie créatrice de Françoise Sagan, et ce serait une erreur de mettre de côté les derniers romans, conçus alors que déjà la romancière se retirait de la vie publique. En effet, Un chagrin de passage témoigne d’une volonté de pousser le postulat précédemment évoqué jusque dans ses derniers retranchements. L’exposition est déjà un coup de théâtre en elle-même : Matthieu apprend que ce qu’il prend pour une passagère et bénigne baisse de forme est en fait un carcinome malin qui limite en semaines sa survie. En conséquence, le regard que porte le héros sur lui-même et sur autrui change. La proximité de l’inéluctable ôte les confortables masques de verre ; les amis proches apparaissent comme lointain, extérieurs, telle ancienne liaison prend sa véritable signification, celle de la tendresse démasquée. Le corps du roman est dans cette découverte, qui, pas plus que s’il ne s’agissait d’un amour, ne peut s’inscrire dans la durée. Le coup de théâtre final, en l’occurrence la découverte de l’absence de cancer, renvoie Matthieu à la situation initiale et pose la question centrale : après une expérience forcée de dévoilement, le retour à la situation antérieure est-il possible ? Sera-t-il, comme par le passé, garant d’un équilibre, même factice ? Sagan n’apporte pas de réponse à cette question, pas de façon péremptoire, mais elle fait du roman l’observation attentive de ce qui est une phase transitoire. Le rapport au temps de Sagan se révèle, en conséquence, complexe. La narration est cursive, rapide, mais le temps apparaît comme immobilisé, freiné pour rendre analysable ce qui, plus qu’une péripétie, est une mutation transitoire.
De ce point de vue, l’originalité de la construction saganienne ne fait pas de doute. Il est cependant frappant de noter le rapprochement qui existe sur ce point entre elle et Louise de Vilmorin (1902-1969), dont l’œuvre romanesque7 est, elle aussi, une exploration d’un état amoureux que la nécessité de le vivre démasqué rend malheureusement caduc. Dans les deux cas, l’action proprement dite n’existe que pour permettre le regard sur la fugacité d’un sentiment, sur la nécessité au plus vite de se remasquer, faute de pouvoir vivre à visage découvert. Louise de Vilmorin comme Françoise Sagan ont choisi de camper des figures appartenant à un certain milieu social, non par attachement viscéral ou politique à ce dernier, mais par nécessité de peindre des personnages à l’abri de l’Histoire, centrés sur leur évolution intérieure. C’est dire d’ailleurs que, dans un cas comme dans l’autre, le roman historique ne pouvait pas les concerner directement.
De l’intertextualité
La littérature tenait dans la vie de Françoise Sagan une place de choix. Si elle se gardait, devant des tiers de passage ou des journalistes, de donner un avis tranché sur tel ou tel courant ou telle production – ce en quoi elle se montre, comme nous l’avons dit, moraliste, mais aucunement moralisatrice – les discussions avec Bernard Frank par exemple pouvaient s’étendre aux dimensions de toute une nuit. Pourtant, l’œuvre de Sagan n’est pas semée de citations ou de renvois intertextuels. Est-ce à dire que, pour autant, l’œuvre de Sagan est exempte de références, qu’une cloison étanche existe entre la lectrice et l’auteur ?
La question du génie des titres a déjà été posée à propos de Françoise Sagan, et il est un fait certain que la musicalité de ces derniers est l’une des marques de la personnalité de la romancière. Mais plus que des choix « commerciaux » ou simplement affectifs, les citations contenues dans les titres sont souvent révélatrices d’une intertextualité sous-jacente. Prenons-en deux exemples précis :
-
Bonjour tristesse renvoie à À peine défigurée de Paul Éluard, tiré de La Vie immédiate (1932). La lecture complète du poème, qui déclare tu es inscrite dans les yeux que j’aime, est déjà particulièrement éclairante. Ces yeux ne sauraient être ceux de Cyril, qui ne véhiculent pour Cécile que la langueur d’un moment agréable, mais bien ceux d’Anne et Raymond. Et lorsqu’Anne, se croyant supplantée par Elsa, s’achemine vers sa fin, elle ne se départit jamais de son élégance ni de son sourire, car les lèvres les plus pauvres te dénoncent par un sourire. Les dernières lignes du roman, qui laissent Cécile face à une cicatrisation d’autant plus difficile qu’elle ne peut confier ni sa tristesse ni le motif de cette dernière, enferment la jeune héroïne dans le souvenir d’un visage, celui d’Anne : Tristesse, beau visage.
-
Les merveilleux nuages sont tirés des Petits poèmes en prose (1869) de Charles Baudelaire. L’étranger dont il est question ne s’attache ni à sa famille, ni à ses amis, ni à la beauté, ni à l’or, ni même à Dieu, mais à l’insaisissable, c’est-à-dire aux nuages qui passent et à leur forme. Dans le roman, Josée réalise, une fois mariée à Alan, qu’elle n’accepte pas que son univers ne soit habité que par les faiblesses (jalousie, alcoolisme, névroses) de cet homme. Elle ne parvient pourtant pas à renoncer à lui, attachée qu’elle est à la poursuite d’une essence, d’une forme de réalité qui est peut-être celle d’Alan, mais trop intime, trop enfouie pour que le fameux masque de verre la laisse entrevoir. Les nuages sont ici l’essence d’Alan, que Josée espère alors même qu’elle sait ne pas pouvoir l’extraire.
Les choix de titres ou d’incipits ne sont donc pas uniquement des choix opportunistes, ils sont les indices d’un réseau intertextuel sous-jacent qui est l’un des axes du style de Sagan. Le début de La Femme fardée aurait, de l’aveu d’Annick Geille8, donné beaucoup de difficultés à romancière. Telle qu’elle existe dans la version définitive, l’exposition passe succinctement en revue les personnages principaux, sans développement psychologique ni exploration d’aucune sorte. Si l’on ajoute le cadre du navire, la concision lapidaire des portraits ainsi campés, qui limitent pour l’instant les personnages à leur signification extérieure et sociale, donc au masque porté, admet bel et bien un modèle proche, celui d’Agatha Christie (1890-1976) dans les romans mobilisant un assez grand nombre de personnages, et plus particulièrement dans Mort sur le Nil (Death on the Nile, 1937). Ce qui, chez la romancière anglaise, servira de tremplin à l’observation minutieuse par Hercule Poirot du comportement des passagers, conforme ou non à ce que leur apparence laisse attendre, devient chez Sagan peinture des masques que l’amour de Clarisse et Julien va faire bouger sensiblement.
L’intertextualité saganienne n’est pas un jeu de piste ou un code destiné à quelques happy few, elle se veut subtile, aérienne, présente tout en n’étant pas affirmée, litote plus que péroraison. Mais elle demeure un constituant non négligeable de la magie saganienne, partie inhérente d’un style.
De l’humour chez Françoise Sagan
Les touches d’humour sont nombreuses dans l’œuvre de Sagan, et sont particulièrement révélatrices dans deux œuvres, un roman, Les Faux-fuyants, et une pièce de théâtre, L’Excès contraire. Dans les deux cas, le ressort comique est issu d’un décalage relevant de ce que Bergson caractérise comme le comique de caractères.
Où la personne d’autrui cesse de nous émouvoir, là seulement peut commencer la comédie. Et elle commence avec ce qu’on pourrait appeler le raidissement contre la vie sociale. Est comique le personnage qui suit automatiquement son chemin sans se soucier de prendre contact avec les autres. Le rire est là pour le corriger de sa distraction et pour le tirer de son rêve9.
Une partie de la difficulté de réception du théâtre de Sagan10 réside dans ce qu’elle n’adhère pas au théâtre de l’absurde alla Ionesco, ni au théâtre « engagé » que pourra illustrer avec génie Jean Genet11. Le théâtre de Sagan est un théâtre du verbe, de l’ironie parfois mordante, ne remettant nullement en cause la construction chronologique et narrative de la pièce. Le résultat est qu’elle se voit, comme Jean Anouilh, assimilée au théâtre de boulevard. Telle qu’accolée par la critique, l’étiquette se voudrait désobligeante, comme si le voisinage d’Edouard Bourdet, André Roussin ou Marcel Achard pouvait déshonorer un littérateur quel qu’il soit. Pour être juste, le théâtre de Sagan est à la fois un théâtre de situation et une mécanique de caractère. C’est la situation qui met en évidence la péripétie centrale, exactement comme dans les romans, mais le comique vient moins de la situation elle-même que du déplacement d’un personnage, que son masque n’y prédispose pas, dans une situation ou il ou elle apparaît incongru ou déplacé. Ainsi, L’Excès contraire met en scène un jeune homme, Frédéric – que son physique avantageux, sa maîtrise de la langue, et son endurance amoureuse semblent prédestiner à être un héros idéal. Problème, le masque de verre occulte une lâcheté que le jeune homme assume – et une femme déjà mûre, Hanaé, sorte de vierge chasseresse bien propre à décourager toute entreprise de séduction. Il suffit à Sagan de faire du jeune étalon capon un époux (trop) comblé et de la Diane une assoiffée de plaisir physique, après une découverte tardive autant qu’inespérée, pour que la dynamique comique prenne son essor.
De même, dans Les Faux-fuyants, c’est la transplantation forcée de quelques figures bien parisiennes dans une campagne (dont la guerre fait une sorte de continent isolé du reste du monde), leur confrontation avec la nécessité de travailler, avec une réalité (les Béju du grand-père) qui leur est étrangère et rend leurs comportements aussi inappropriés que dénués de sens qui entraîne le rire du lecteur.
Sagan rit du même phénomène qui est à la base des péripéties tragiques, parfois dans les mêmes œuvres, en l’occurrence le masque séparant le personnage de la réalité. Lorsque, de façon frontale, la seconde rattrape le premier, il s’ensuit un décalage auquel seul l’impossible dévoilement mettrait fin.
C’est dire, puisqu’ils découlent du même état de fait, que comique et tragique, non seulement cohabitent chez Sagan, mais se complètent, comme deux facettes d’une même conformation sentimentale. Ainsi, la figure de Betty Bragance, dite Boubou, dans Un sang d’aquarelle, apparaît comme la personnification d’une mondanité que la guerre, puis les difficultés sentimentales de Constantin, Maud, Wanda et Romano rendent de plus en plus décalée. De sorte d’Anna de Noailles qu’elle est au début du roman, elle devient peu à peu figure comique.
Est-ce à dire que Sagan rit volontiers d’un personnage qu’elle déplace ? Rien n’est moins univoque, car Sagan la pudique ne pratique pas le rire sardonique, elle nourrit de toute évidence une tendresse pour ses personnages, un vrai regard de moraliste. Il y a bien du La Bruyère ou du Chamfort en Sagan, à ceci-près que l’humour y est toujours équilibré d’une tendresse qui exempte le verbe saganien de tout acidité ou, plus simplement, de la plus élémentaire méchanceté.
Sagan par Sagan
C’est sur l’insistance de Françoise Verny (1928-2004) que Françoise Sagan entreprend, non sans réticence, un premier livre de souvenirs qui devient Avec mon meilleur souvenir (1984). L’œuvre se présente comme un recueil de nouvelles, une succession de tableaux brefs et indépendants. La démarche pouvait surprendre de la part d’un écrivain qui avait, jusque-là, utilisé avec virtuosité les lumières de l’actualité pour garder plus secrète encore sa vie intérieure. Et de fait, Sagan la timide et la secrète n’abdique rien de sa nature profonde. Si elle confie, sur le mode poétique, son amour du théâtre, du jeu ou de la vitesse, elle se livre surtout à une succession de portraits marqués par la tendresse. Si la romancière se livre, c’est en creux, à travers le regard qu’elle porte sur des êtres aimés (encore ne sont-ils pas choisis dans ce fameux cercle rapproché qui ne devait supporter aucun dévoilement). Mémoires ? En aucun cas, car la romancière se plait, même à l’intérieur d’un portrait, à entretenir les blancs et les ellipses. Ou plutôt, mémoire fantasque, qui ne livre que ce qu’elle entend livrer.
Si nous devons sortir de la lecture d’Avec mon meilleur souvenir ou Et toute ma sympathie (1993) en mieux connaissant Françoise Sagan, ce sera indirectement, à travers ses rapports avec autrui. Masque, encore et toujours, mais porté ici avec un haut degré d’élégance et de raffinement, que l’on savoure d’autant plus que l’auteur aurait pu, nouveau Paul Léautaud, exercer une ironie acide et mordante, régler quelques comptes avec un milieu littéraire qui, s’il l’avait conduite jeune à la célébrité et à la gloire, ne l’avait nullement épargnée par la suite.
À travers les Chroniques rassemblées en un unique volume par Denis Westhoff12, Sagan ne se livre pas plus qu’elle ne l’entend, tout au plus entretient-elle vivace – et ce n’est pas un mince mérite – l’envie que nous avons de soulever un peu le masque de verre qu’elle continue de porter non pas avec hauteur, mais avec cette pudeur dont jamais elle ne se départira.
Sagan demain
Il est aussi inutile que difficile de conjecturer quant à l’avenir de l’œuvre d’un auteur, et plus encore lorsque l’auteur en question a marqué son époque. S’il ne semble en rien être question de purgatoire pour Sagan, on peut déplorer cependant qu’une édition complète, avec appareil de notes et notice détaillée, ne lui ait pas encore été consacrée, et plus encore que les reprises au théâtre se fassent rares. En dehors de Château en Suède, dont la popularité méritée ne se dément pas, il est dommage que Les violons parfois, La Robe mauve de Valentine, Un piano dans l’herbe, Le cheval évanoui ou L’Excès contraire ne jouissent pas plus souvent des honneurs de la scène.
La langue de Sagan se remarque par sa fluidité, son élégance dont la désinvolture n’est qu’apparente, sa précision et son sens de l’image. C’est dire qu’elle ne se pare d’aucune affèterie qui pourrait l’enfermer dans une époque. Elle reste actuelle, comme l’est la vision de la construction romanesque. Étrangère aux écoles comme l’a été un Jean Giono, observateur d’un pan de la société comme l’a été un Marcel Proust, élégante et incisive comme une Louise de Vilmorin, possédant un sens du dialogue et du théâtre qui en fait un Anouilh moins cruel, Françoise Sagan a tout pour continuer à parler aux lecteurs de demain. Mais le souhaiter n’est pas suffisant en soi, c’est à nous, lecteurs d’aujourd’hui, de susciter l’engouement de demain, celui qui, éloigné de la légende de Sagan vue par la presse, donnera à l’auteur sa véritable place, dont nous ne doutons pas un instant qu’elle sera essentielle, bien au-delà de la romancière des années 1950-1960, celle d’un jalon essentiel, dans sa modestie pudique, de notre littérature. □
___________________
Portfolio
 |
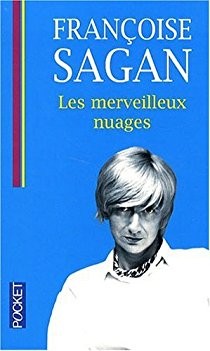 |
|
 |
 |
|
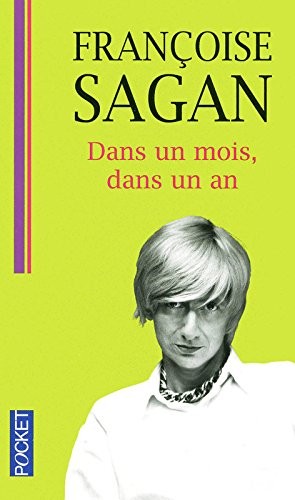 |
 |
|
 |
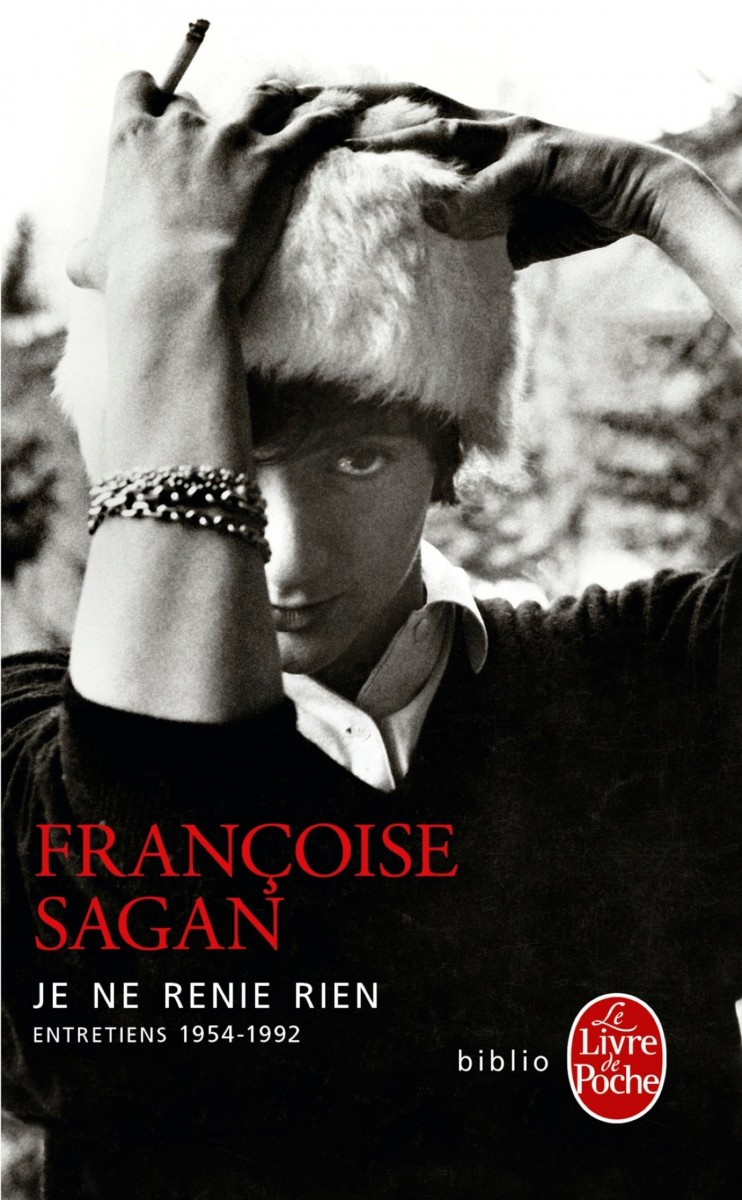 |
|
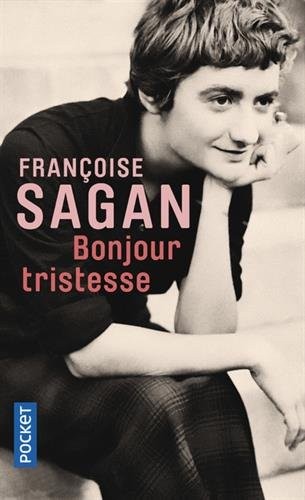 |
 |
|
Partager sur :

