OFFENBACH Jacques
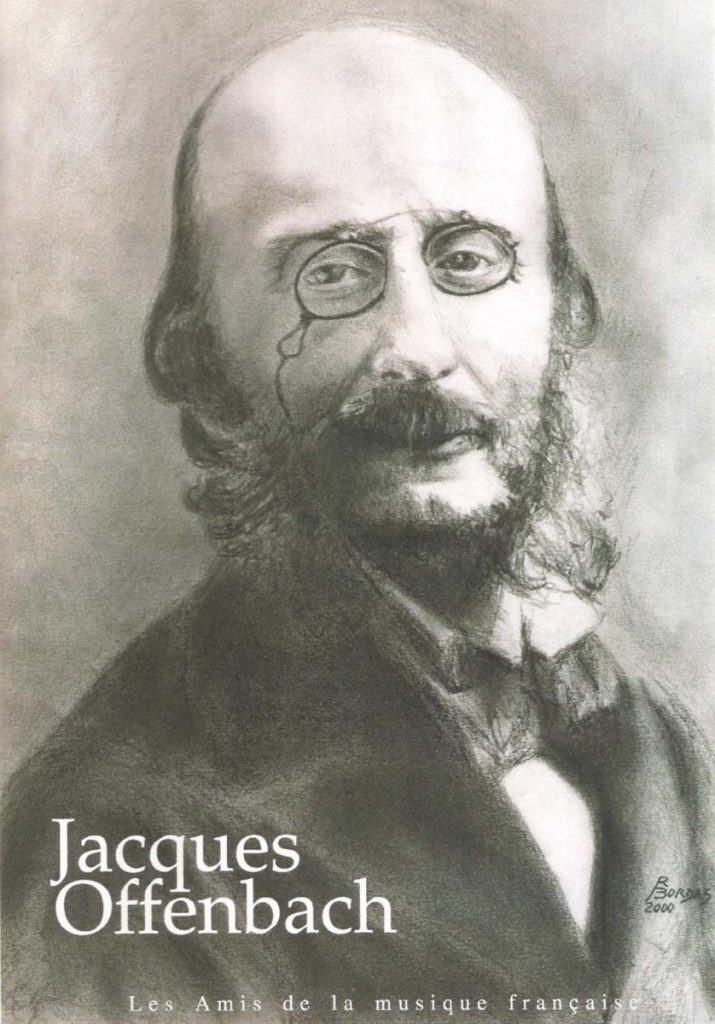
Jacques OFFENBACH [1819-1880]
|
« Non, amis dramaturges, vous n’avez pas compris Offenbach ! Offenbach ! Il vous dépasse tous. Lui a une philosophie, vous, vous n’avez pas une idée ; lui a une critique, vous, vous n’avez pas même une grammaire ! Qui, comme lui, a battu en brèche tous les préjugés de son temps ? Qui, comme lui, a discrédité pour toujours les vieilles institutions, avec quatre mesures et deux violons ? Vous, avec votre austérité, vous n’avez pas rendu un seul service au bon sens, à la justice, à la morale. Vous n’avez fait qu’endormir ! Et lui ? Le militarisme, le despotisme, l’intrigue, le sacerdoce vénal, la bassesse courtisane, la vanité bourgeoise, il a tout battu, tout retourné, tout ébranlé en un couplet fulgurant !
Non, haute bourgeoisie, tu n’as pas bien fait de l’applaudir et de le protéger. Tu as cru trouver en lui un passe-temps, c’est une condamnation qui t’attendait. Sa musique est ta caricature. Les théâtres sont-ils si mal éclairés, votre entendement est-il si étroit, que vous ne vous soyez pas reconnus chacun à votre tour dans cette éclatante galerie des médiocres de votre temps ? Le roi Bobèche n’est-il pas la fantasmagorie chantée de votre royauté ? Calchas de La Belle Hélène, n’est-il pas la mascarade païenne de votre clergé ? Le général Boum n’est-il pas la personnification éclatante de votre stratégie de salon ? Le baron Grog n’est-il pas la grotesque pochade de votre diplomatie ? Le trio de la conspiration n’est-il pas la photographie en couplets de vos intrigues ministérielles ? La Grande-Duchesse n’est-elle pas dans son entier la charge implacable de vos armées permanentes ? […] Offenbach est une philosophie chantée. »
José Maria Eça de Queirós (1845-1900)
|
Offenbach et l’opéra-comique
Les rapports de Jacques Offenbach (1819-1880) avec le genre opéra-comique relèvent, tout au long de la vie créatrice du compositeur, d’un paradoxe amoureux. La culture lyrique d’Offenbach, son expérience en tant que violoncelliste dans l’orchestre de l’Opéra-Comique, son goût personnel pour ce genre si français, qui ne dissimule pas sa dette envers le dernier tiers du XVIIIe siècle vont nécessairement le pousser à s’intéresser au genre. Le répertoire de François Adrien Boieldieu (1775-1834), de Ferdinand Hérold (1791-1833), de Nicolò Isouard (1773-1818) lui est tout à fait familier, et quoique d’un esprit particulièrement mordant, il en apprécie le caractère sentimental et la délicatesse de touche. Et presque naturellement, il développe pourtant une conscience claire de ce que réclame impérativement la survie du genre.
Offenbach sauveteur de l’opéra-comique ?
L’opéra-comique, tel qu’Offenbach le découvre en ce début de XIXe siècle, est l’héritier direct des ouvrages d’André-Ernest-Modeste Grétry (1741-1813), de Pierre-Alexandre Monsigny (1729-1817) ou de Nicolas Dalayrac (1753-1809). Le genre est le fruit d’une période transitionnelle (il occupe dans le répertoire français la place chronologique du classicisme viennois outre Rhin, entre le crépuscule baroque et l’affirmation du romantisme), et reflète assez logiquement le goût de l’époque pour une forme de sentimentalité, sensible en France dans toutes les disciplines artistiques entre 1760 et 1789. Les gravures de Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), l’architecture du Hameau de Marie-Antoinette (1783-1876), due à Richard Mique (1728-1794), l’orientation morale de L’autre Tartuffe ou la mère coupable (1792) de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799), La nouvelle Héloïse (1761) de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) ou Paul et Virginie (1787) d’Henri Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814) portent témoignage de cette tendance esthétique. Les mouvements de pensée de l’époque tendent vers une forme de sentimentalité adoucie, teintée de morale, qui annonce de façon claire le pré-romantisme, qui va teinter de tragique le cadre en question.
Sur le plan dramatique, l’opéra-comique se maintient dans ce que nous pourrions qualifier d’esthétique du juste milieu, avec une souplesse qui lui permettra, via Le Pré aux clercs (1832) de Hérold ou La Dame blanche (1825) de Boieldieu, d’intégrer les données esthétiques du romantisme naissant. Il s’ensuit de façon naturelle un recul de la dynamique théâtrale, un relatif appauvrissement du relief dramatique au profit de l’expression séduisante – et parfois complaisante – de cette sentimentalité de bon aloi. Or, Offenbach se signale d’abord par son instinct de la chose théâtrale, sa sensibilité sismographique au moment où une salle peut décrocher, et il sentira très tôt que l’art est arrivé à un tournant qu’il appartient à l’opéra-comique de prendre ou bien de disparaître.
Les années 1830 voient l’éclosion sans équivalent depuis la Renaissance d’une forme de culture de masse, en particulier dans le domaine littéraire, avec l’explosion du roman historique et de cette nouvelle forme de consommation littéraire que devient le roman feuilleton. Honoré de Balzac (1799-1850), George Sand (1804-1876) ou Alexandre Dumas père (1802-1870) illustrent avec virtuosité cet élan qui va créer, susciter de nouvelles couches de lectorat. Il est évident pour Offenbach que, malgré la suprématie bourgeoise induite par la monarchie de Juillet (1830-1848), le genre lyrique ne peut ni ne doit échapper à ces nécessités nouvelles, et en artiste qui recherche consciemment le succès, il se sent poussé à être l’artisan d’un renouvellement qui, sans renier les racines du genre, pourra le conduire lui aussi à toucher un public plus large. L’opéra-bouffe offenbachien n’apparaît nullement comme la négation, encore moins l’enterrement de l’opéra-comique, qui connaît encore de beaux soirs durant le XIXe siècle, sous les plumes de Daniel-François-Esprit Auber (1782-1871), François Bazin (1816-1878) ou Ferdinand Poise (1828-1892). La démarche d’Offenbach va connaître deux temps distincts, lesquels sont quelque peu superposés au long de sa carrière :
-
d’une part la mise en perspective du modèle via la parodie1,
-
d’autre part l’illustration du genre dans ce qu’il présente de pérenne.
Bien entendu, contexte sociologique oblige, c’est principalement après le conflit de 1870, lorsque la République induit d’une part le retour d’un certain ordre moral, d’autre part la remise au premier plan de la bourgeoisie en phase ascendante, que l’opéra-comique retrouve sous la plume du compositeur une forme de suprématie, mais il aura subi entretemps sinon une cure de rajeunissement, tout au moins un apport théâtral qui en assure désormais la pérennité, via Emmanuel Chabrier (1841-1894), André Messager (1853-1929) jusqu’à Darius Milhaud (1892-1974) ou Francis Poulenc (1899-1963). Mais les différentes tentatives d’opéra-comique antérieures à 1870 sont déjà révélatrices d’une démarche de fond, que le public n’est pas toujours à-même de recevoir.
Barkouf ou la tentative anticipée
Lorsqu’en fin 1859, Alfred Beaumont, directeur de l’Opéra-Comique jusqu’en 1862, s’adresse à Offenbach pour une partition créée sur la scène de son théâtre, le maestro accepte avec enthousiasme, pensant logiquement que le public qui a applaudi à Orphée aux enfers et à Geneviève de Brabant est mûr pour un nouveau visage du genre. Le choix du livret est, chose rare dans la trajectoire du compositeur, quasiment imposé par le directeur. Beaumont pense réaliser un coup de maître en associant le compositeur, alors en pleine ascension, et un librettiste au talent éprouvé, Eugène Scribe (1791-1861), collaborateur régulier d’Auber, dont le public apprécie les pièces. Il ne s’agit nullement d’un livret original, mais d’une pièce existante :
| Pour le livret, on s’adresse à Scribe, pas moins. Celui-ci propose le scénario du Sultan Barkouf , opéra-comique conçu l’année précédente pour le Théâtre-Lyrique avec son jeune collègue Henri Boisseaux. L’ouvrage devait être mis en musique par Clapisson2 et être chanté par Delphine Ugalde3. Mais cette dernière est rappelée par Beaumont à la salle Favart où elle fait sa rentrée le 7 Juillet 1860. Le sultan Barkouf, qui deviendra au fil des semaines Le roi Barkouf puis Barkouf passe ainsi de Clapisson à Offenbach4. |
Offenbach rencontre quelques problèmes avec ce livret imposé, en premier lieu au sujet des rôles féminins. Boisseau trouvant le rôle de Maïma trop lourd pour D. Ugalde, il fait renforcer celui d’un second personnage (Balkis) dévolu à Mme Lefebvre. Scribe renâcle d’abord, puis s’oppose à cette réécriture, dont Offenbach ne se fait l’avocat que pour des raisons de distribution, ne pouvant agir directement sur la structure dramatique. D.. Ugalde manifeste naturellement son opposition, et malgré la refonte opérée par Scribe (qui réunit en un seul acte les précédents III et IV), l’équilibre théâtral n’est pas idéal selon Offenbach, et les tensions dans la distribution handicaperont fort les répétitions. D. Ugalde fait courir le bruit que la pièce est scandaleuse, qu’elle met à mal la pudeur des artistes. La censure s’en mêle, interdit la pièce, que Boisseau maintient cependant en répétitions, pas moins de trois interprètes vont se succéder pour le rôle initialement pensé pour D. Ugalde. Offenbach se retrouve devant un parfum de scandale dont, contrairement à ce qui s’était passé pour Orphée, il n’est pas l’orchestrateur. Au lieu de devenir un argument publicitaire, il handicape l’œuvre et paralyse sa réception.
En effet, le livret de Scribe (alors membre de l’Institut) n’était nullement pensé pour susciter un scandale, qui devra surtout à l’efficacité de la cabale et à une problématique que la critique déplace subtilement : le petit maître des Bouffes-Parisiens est-il digne de figurer sur la scène de la Salle Favart. De toute évidence, la finesse parodique, qui suppose de la part de celui qui la pratique, une connaissance approfondie de l’objet parodié (et même un rapport quasi-amoureux) échappe au monde musical parisien, il est encore trop tôt pour que l’optique d’Offenbach soit acceptée.
Robinson Crusoé ou l’île inhabitable
La composition, en 1867, de Robinson Crusoé, opéra-comique en trois actes et cinq tableaux sur un livret d’Hector Crémieux (1828-1892) et Eugène Cormon (1810-1903), est contemporaine du triomphe aux Variétés de La Grande-Duchesse de Gerolstein, de l’Exposition Universelle et de l’apogée du Second-Empire. Une nouvelle fois, Offenbach pense que le temps est venu de proposer sur la scène de la Salle Favart une synthèse entre les racines de l’opéra-comique et la bouffonnerie parodique inhérente à l’opéra-bouffe qu’il a perfectionné depuis plus de quinze années. Pour ce faire, le choix s’est porté sur le héros du roman de Daniel Defoe (1660-1731), écartant les risques de cabale et de discussion sur la moralité du livret qui avaient handicapé Barkouf sept années plus tôt. Mais très vite, le compositeur prend conscience que la littérarité du sujet pèse lourd dans l’élaboration du livret. Le compositeur n’a pas comme projet de revenir à un cadre intimiste à deux ou trois personnages, et c’est pourtant ce que le roman pourrait appeler, centrant le propos autour de Robinson et de Vendredi. Deuxième obstacle de taille : l’absence théorique de personnage féminin de premier plan. Qu’à cela ne tienne, Vendredi deviendra un personnage travesti. Mais dès lors, que devient la composante sentimentale et amoureuse sans laquelle le genre ne peut exister ?
Il en résulte de nombreux remaniements du livret pendant l’été 1867, dont aucun ne résout définitivement le problème. Le spectacle est long, beaucoup trop (quatre heures lors de la création), l’entracte symphonique entre les actes I et II couvre une ellipse de six années (la traversée, le naufrage, l’adoption de Vendredi) qui n’est purement et simplement pas évoquée. La fiancée de Robinson, Edwige, doit pour des raisons d’équilibre de plateau rester présente, les librettistes imaginent son arrivée dans l’île, sa capture par la tribu des Pieds-Verts (antropophages). Le dosage de la bouffonnerie est difficile, et l’on sent clairement qu’Offenbach a cherché à la maintenir en lisière, sans pouvoir nier sa nécessité pour inclure les personnages secondaires. Si la partition se révèle d’une haute qualité, faisant montre d’ambitions musicales parfaitement maîtrisées et réalisées, la synthèse entre les deux aspects (comique et sentimental) n’est pas encore idéale, et si le scandale n’est pas au rendez-vous, la critique ne manque pas de relever la trahison de l’ouvrage de Defoe. Sensible à ce problème, la direction de l’Opéra-Comique avait pris les devants en publiant un communiqué dans L’Entracte, en insistant sur la nature d’opéra-comique à part entière de l’œuvre5. Mais le public et la critique reste peu sensibles à la synthèse opérée pourtant avec goût par le compositeur, et l’on ne manque pas de mettre en lumière l’inadaptation du musicien au genre :
| Malheureusement, il fallait entrer dans la place en se contentant de modifier un peu son costume, peut-être trop primitif pour un théâtre où la distinction a toujours remplacé la charge. L’auteur du Mariage aux lanternes a voulu prendre la livrée de la maison sans s’apercevoir qu’elle était beaucoup trop large pour lui, Qu’importe que son verre fût petit, il fallait boire dans son verre et non dans celui des autres6. |
La première de Robinson Crusoé est un événement parisien, mais le sujet dessert l’ambition d’Offenbach. En évitant les difficultés que le sujet de Barkouf avait entraînées, celui de Robinson Crusoé supposait des contraintes qui ne servaient pas tout à fait la vision du compositeur. La finesse, la délicatesse de touche sont largement présents dans Robinson, et le musicien s’y montre à son meilleur, mais le côté intimiste du sujet n’étant pas adapté au cadre scénique, c’est son élargissement qui déroute le public : la présence des Pieds-Verts rappelle trop les excentricités de Ba-Ta-Clan (1855) ou d’Oyayaye ou la reine des îles (1855). Là où Offenbach tente une synthèse hardie, le public attend encore une séparation des genres à laquelle le compositeur se refuse : réduire l’opéra-comique à ce qu’il était au début du siècle revient à l’appauvrir sur le plan dramatique, alors qu’Offenbach ne cherche qu’à l’enrichir, le fortifier pour le présent et l’avenir.
Vert-Vert ou la revitalisation par le théâtre
C’est sur un livret d’Henri Meilhac (1830-1897) et Charles Nuitter (1828-1899)7 que le compositeur entreprend, en 1869, la composition de Vert-Vert, opéra-comique en trois actes. Fort de ses deux expériences précédentes, Offenbach choisit de puiser cette fois aux sources du genre, en utilisant un livret déjà éprouvé, dont il espère mettre en lumière les aspects qui touchent à la fois à la tradition de l’opéra-comique et à ce qu’il espère en rénover.
Le sujet, en effet, a déjà été porté à la scène lyrique en 1790 par N. Dalayrac8, et est issu d’une pièce de 1754, signée Jean-Baptiste Gresset (1709-1777). Offenbach entend bien se situer dans une filiation qu’il ne s’interdit pas de renouveler. Mais en 1832, la pièce de théâtre originale avait été adaptée par Leuven et Pittaud de Forges pour la célèbre Virginie Déjazet (1798-1875), sous la forme d’une comédie-vaudeville en trois actes donnée au Palais-Royal. Or, le succès de cette adaptation, dont le genre sous-entend qu’elle était mêlée de musique empruntée à des thèmes à succès, avait connu un réel succès, et le compositeur entend donc jouer sur deux tableaux complémentaires, la tradition de l’opéra-comique XVIIIème d’une part, et l’actualité d’un genre appartenant à cette culture de masse dont Offenbach se veut l’un des passeurs. Après la tentative de l’adaptation littéraire de Robinson Crusoé, le maestro pense que le recours à une dynamique directement issue du théâtre évitera les déséquilibres de sa précédente tentative. Or, si l’ouvrage de Dalayrac ne fait déjà plus partie du répertoire ni de la mémoire du public en 1869, le vaudeville de 1832 est connu, et l’art du sous-entendu un peu leste, dont V. Déjazet s’était fait une spécialité avec beaucoup d’élégance y tenait une place de choix. Une fois de plus, le foisonnement de la partition se heurte à la réception du livret, trop leste pour une partie du public et de la critique, trop édulcoré pour l’autre (le compositeur et les librettistes avaient précisément veillé à minimiser cette composante), et c’est toujours le même argument que les détracteurs de l’ouvrage enfourchent, en reprochant au style d’Offenbach l’incapacité à se hisser au niveau de l’opéra-comique :
| Le perroquet n’a pas été plus heureux que le chien à la Salle Favart. Vert-Vert, pas plus que Barkouf, ne fera de vieux os. L’auteur d’Orphée, de La Belle Hélène et de La Vie parisienne fera bien de renoncer à un théâtre que son genre bouffe ne lui permet pas d’aborder. Il fera bien de ne plus se hasarder sur une scène que de vrais maîtres ont illustrée depuis Grétry jusqu’à Auber ; et de s’en tenir aux trois théâtres sur lesquels les ouvrages que nous venons de citer ont eu le seul succès auquel l’ancien des Bouffes-Parisiens puisse viser9. |
Il semble que le compositeur, dans sa démarche synthétique, soit décidément en avance de quelques décennies sur la réceptivité du public, et plus encore de la critique. La guerre de 1870 puis les débuts de la Troisième République vont modifier profondément le contexte social et les attentes de ce public. Offenbach sent clairement que l’époque ne va plus permettre avec la même efficacité la dimension parodique, encore moins la satire sociale ou politique. La synthèse souhaitée devra attendre, sauf à substituer à la composante burlesque une dimension douce-amère voire sardonique.
Fantasio ou l’idéal de l’opéra-comique offenbachien
L’année 1873 sera celle de Fantasio, opéra-comique en trois actes sur un livret de Paul de Musset (1804-1880), d’après la pièce de son frère Alfred (1810-1857). Les affinités profondes d’Offenbach avec le romantisme de Musset, ces amours adolescentes dont la brûlure peut durer toute une vie, même si leur caractère demeure souvent fugace, en proportion avec la profondeur des sentiments, ne sont plus à démontrer. Sa musique de scène pour Le Chandelier lors de son entrée au répertoire de la Comédie-Française, en 185010 dénote une forme de tropisme électif, qui porte naturellement Offenbach vers l’univers de Musset, avec ce voisinage frémissant de légèreté et de douleur à fleur de peau. Déjà dans La Chanson de Fortunio, opéra-comique en un acte sur un livret d’H. Crémieux et L. Halévy, composé en 1860, il avait ressenti l’envie et le besoin de faire monter sur scène le personnage de Musset vieilli et, en quelque sorte, réincarné en la personne d’un de ses jeunes clercs.
Dans Fantasio, la fantaisie n’apparaît que comme un moyen d’éclairer la mélancolie profonde du héros, et Offenbach y ose la sensibilité à visage découvert. Comme l’Octave des Caprices de Marianne11, le musicien comme son personnage sont des « danseurs de cordes en brodequins d’argent »12, oscillant entre les pleurs et un rire cathartique qu’il ne faudrait guère pousser pour qu’il touche au sardonique.
L’œuvre mérite bien plus que le statut de « laboratoire des Contes d’Hoffmann » auquel elle est trop souvent réduite. La composante bouffe y atteint une subtilité, une forme de transparence, de bulle qui pourrait à tout moment éclater pour ne laisser affleurer alors que les larmes qu’elle cache. D’extraversion, elle devient voile de pudeur, et le compositeur réalise magistralement la synthèse à laquelle il travaille depuis 1860, sans doute parce que le sujet s’y prête idéalement, et qu’aucun travail de ré-équilibrage du livret n’était à pratiquer. La vision de Musset dans le domaine de la tragi-comédie et celle d’Offenbach dans celui de l’opéra-comique se superposent totalement, et l’on se plait même à rêver de ce qu’aurait pu donner un livret de Musset conçu spécialement pour le compositeur, si la vie l’avait permis.
On sait que Fantasio ne tiendra pas longtemps l’affiche de l’Opéra-Comique (du 18 Janvier 1873 au 9 Février seulement). La critique est plutôt terne et indifférente, le milieu parisien carrément hostile, d’Émile Zola (1840-1902) à Gustave Flaubert (1821-1880). Mais à parcourir cette presse, le sentiment dominant est réellement dû à un ressentiment accumulé contre un succès persistant13, dans un contexte anti-prussien dont le compositeur fait manifestement les frais. En effet, Fantasio réalise de façon magistrale et définitive l’idéal de genre vers lequel le compositeur tendait. Le recul du goût satirique chez le public le sert au lieu de constituer un handicap, il peut désormais parler à visage découvert, écartant par instant totalement le masque du bouffon14.
Le genre opéra-comique dans le corpus offenbachien
Notons que l’appellation opéra-comique est fréquente sous la plume du maître dès la fin des années 1850, et qu’elle intervient chaque fois que l’œuvre se déploie dans un contexte de délicatesse dont la satire est absente :
- La Chanson de Fortunio, déjà signalée,
- Bavard et Bavarde (1862), opéra-comique en deux actes sur un livret de C. Nuitter15 d’après Cervantès,
- Monsieur et Madame Denis, opéra-comique en trois actes sur un livret de Laurencin (1806-1890) et Delaporte (1806-1872),
- Il Signor Fagotto (1863), opéra-comique en un acte sur un livret de C. Nuitter et Etienne Tréfeu (1821-1903),
- Le Soldat magicien (1864), opéra-comique en un acte sur un livret de C. Nuitter et E. Tréfeu,
- Coscoletto ou le lazzarone (1865), opéra-comique en deux actes sur un livret de C. Nuitter et E. Tréfeu,
- Les Bergers (1865), opéra-comique en trois actes sur un livret de Philippe Gille (1831-1901) et H. Crémieux,
- La Permission de dix heures (1867), opéra-comique en un acte sur un livret de P. Carmouche (1797-1868) et Mélesville (1788-1865).
Mais l’appellation va se généraliser après 1870, au fur et à mesure qu’Offenbach rend plus évident le lien entre lui et l’opéra-comique du XVIIIe. Qu’il s’agisse de La Jolie Parfumeuse [1873, trois actes, livret d’Ernest Blum (1836-1907) et H. Crémieux], La Créole [1875, trois actes, livret d’Albert Milhaud (1844-1892)], Madame Favart (1878, trois actes, livret de Henri Chivot (1830-1897) et Alfred Duru (1829-1889)], La Fille du Tambour-Major (1879, trois actes, livret de Chivot et Duru) ou Belle-Lurette [1880, trois actes, livret de E. Blum, Édouard Blau (1836-1906) et Raoul Toché (1850-1895)], le genre devient quasiment dominant dans l’inspiration du musicien (bien des opéras-bouffes de la période s’y apparentent également), en partie en raison des goûts du public, en partie également parce que l’équilibre atteint dans Fantasio est désormais la marque du style offenbachien. Il est, à cet égard, regrettable que les œuvres de la décennie 1870-1880 ne bénéficient pas de la même popularité que leur homologues d’avant 1870, car Offenbach ne cesse d’évoluer, et atteint dans sa dernière décennie une maturité créatrice qui va de pair avec l’accomplissement de sa vision du genre opéra-comique.
Les Contes d’Hoffmann, ou l’opéra-comique de l’avenir
Les biographes d’Offenbach, de Siegfried Kracauer (1899-1966) à A. Decaux, ont souvent fait des Contes d’Hoffmann une exception dans l’univers d’Offenbach, d’autant plus géniale qu’elle se doublerait d’un pari contre la mort en marche. Pour séduisante qu’il soit, ce point de vue ne doit pas tout à la réalité. Dès 1875, Georges Bizet (1838-1875) avait, dans sa Carmen, élargi considérablement le champ de l’opéra-comique, qui va devenir par opposition avec l’opéra historique à la française, le genre de la liberté, de la Manon (1883) de Jules Massenet (1842-1912) à Pelléas et Mélisande (1902) de Claude Debussy (1862-1918) qui, sans tenir du genre, a été créé sur la scène de l’Opéra-Comique, alors qu’il eût été inenvisageable de faire la même chose à l’Opéra.
Les Contes d’Hoffmann reprennent le contexte de Fantasio, avec cette dynamique des masques successifs (Lindorf, Coppélius, Dapertutto, le Docteur Miracle comme autant d’incarnation du mal destructeur, Stella, Olympia, Giulietta, Antonia comme les visages de la Femme), en l’élargissant vers cette dimension sardonique que nous évoquions par anticipation. C’est l’attrait d’Offenbach pour le romantisme weberien qui se trouve conjugué à la plasticité de l’opéra-comique tel qu’il le conçoit, et qui dote le genre d’un futur d’une singulière richesse. Le compositeur se montre capable de dépasser son attachement au modèle du XVIIIe siècle pour ouvrir consciemment sur le XXème à venir. De ce point de vue, Les Contes, dont Fantasio n’est en rien le laboratoire musical, Offenbach composant souvent « vierge » et ne se citant que rarement, ne sont ni une exception en forme de légende, ni une tabula rasa : l’œuvre est une ouverture nouvelle de la synthèse dont Fantasio avait signé la perfection, elle aurait certainement annoncé une nouvelle manière du maître. Aucune rupture dans le cheminement d’Offenbach, mais une capacité surprenante à renouveler son point de vue lorsqu’il pense avoir atteint la maturité dans la phase précédente.
L’opéra-comique n’aura cessé de demeurer un champ de réflexion ouvert pour le compositeur, il aura fait d’un genre très lié à une époque un espace de liberté, lui apportant la plasticité en lui conservant sa part de délicatesse et en diversifiant l’apport du bouffe dans la dramaturgie. ◊
___________
Dossiers

Jacques Offenbach©Roselyne Bordas-AMF, 1998
FANTASIO, opéra comique en 3 actes
Création parisienne, Opéra-Comique Paris 1872
Reprise, Opéra-Comique Paris, 2017
- Page FACEBOOK de Jean-Christophe KECK, chef d’orchestre, musicologue
- Opéra Comique, page officielle
- Médiapart, Blog L’œil d’Olivier
- Concert Classic
- ResMusica
- TouteLaCulture
- Télérama
- WebThéâtre
Les admirateurs d’Offenbach sont comblés d’observer que Fantasio, cette partition majeure et pourtant bien mal accueillie en janvier 1872 à l’Opéra-Comique [une version, avec le rôle principal repensé pour soprano, ne connût qu’un succès d’estime à Vienne], soit enfin reçue et saluée avec autant d’enthousiasme en ce mois de février 2017. Le Théâtre national de l’Opéra-Comique, provisoirement déplacé – en raison de travaux – au Théâtre du Châtelet, est l’instigateur inspiré de cette reprise. Cent-quarante-cinq années se sont écoulées pour vivre cet incroyable revirement, dont avait eu cependant la vision prémonitoire le critique A. W. Ambros qui assistait à la création de l’œuvre à Vienne :
| « Fantasio est un tournant. Jamais Offenbach n’a composé un ouvrage avec autant de soin et d’amour. Il a voulu nous prouver sa capacité à composer un opéra-comique de haute tenue. »[2] |
Honte à Camille Du Locle, directeur de l’Opéra-Comique en cette année 1872, à qui Jacques Offenbach, cruellement meurtri, écrivait en mars 1872 :
| « […] ce qui s’est passé pour ce pauvre Fantasio est je crois sans précédent dans les annales du théâtre. Ce qu’un directeur ordinaire n’eût osé faire, un directeur extraordinaire, doublé d’un ami, l’a mis à exécution… et de quelle façon. […] Et d’un coup de baguette, vous enlevez ma pièce, tout çà pour pouvoir jouer tranquillement le lendemain Fra Diavolo. Ah, que de vilaines excuses et que je vous plains mon pauvre garçon ! Avez-vous fait au moins quelque chose pour soutenir Fantasio ? […] Vous ne vouliez rien essayer, rien faire pour le faire marcher et vous vouliez à toute force vous en débarrasser et vous l’avez fait avec un sans-gêne qui vous fait le plus grand honneur au point de vue de l’indépendance d’affaires et de cœur. Comme directeur vous n’avez montré aucune énergie, comme ami vous avez agi sans loyauté et sans délicatesse. J’espère que d’autres seront plus heureux auprès de vous – ce qui ne sera pas difficile. Je ne me dis pas moins votre serviteur le plus dévoué. »[3] |
Un peu plus tôt, depuis Vienne, le 10 février 1872, Offenbach adressait une lettre particulièrement sombre, teinté même de désespoir, au même Camille Du Locle :
| « Ici, je travaille comme un “aigre”, je le suis d’ailleurs, aigre, grâce à tout ce que je fais. Boule de neige a eu un vrai succès – Fantasio, mon cher Fantasio, passe cette semaine. Moi, je ne tarderai guère à passer également. Le plaisir de la vie, c’est la lutte et quand on a bien lutté, c’est la mort. »[4] |
Jean-Claude Yon fait cette analyse de l’épreuve vécue par Offenbach devant cet échec :
| « Dans le personnage de Fantasio, il a mis beaucoup de lui-même. L’attrait du jeune étudiant pour la défroque du bouffon et sa fascination pour le rire grinçant et la difformité… ont trouvé un écho au plus profond de lui. […] À bien des moments, Fantasio apparaît comme une préfiguration des Contes d’Hoffmann dont il annonce le désespoir foncier… la partition, écrite avec un soin tout particulier, est d’une exceptionnelle qualité et mêle avec bonheur le grotesque et la poésie. »[5] |
Jacques Offenbach était un romantique qui a dû vivre et faire vivre ses interprètes. Rarement un compositeur fut originaire d’un milieu aussi humble. Venu à Paris avec son frère Jules, c’est avec de très modestes moyens qu’il commença à exercer ses talents. Mais son génie le consacra de manière fulgurante dans la veine de l’opéra bouffe où ses succès et triomphes furent aussi retentissants que réitérés. Songeons au permanent feu d’artifice qui enchanta Paris et toute l’Europe entre 1858 et 1869 : Orphée aux enfers (1858), Geneviève de Brabant (1959), La Chanson de Fortunio (1861), Le Pont des soupirs (1861), Monsieur Choufleuri restera chez lui le… (1861), Les Bavards (1863), La Belle Hélène[6] (1864), Barbe-Bleue (1866), La Vie Parisienne (1866), La Grande-Duchesse de Gérolstein (1867), L’Île de Tulipatan (1868), La Périchole (1868), La Princesse de Trébizonde (1869), Les Brigands (1869).
Tous les théâtres de la capitale, de Vienne et d’Europe étaient acquis aux recettes mirifiques qu’une œuvre d’Offenbach mise à l’affiche garantissait, presque à coup sûr. Au faîte de la gloire, lors de l’Exposition Universelle de 1867, alors que triomphait La Grande-Duchesse de Gérolstein aux Variétés, les autres théâtres parisiens proposaient un opéra bouffe du maître au public !
Un tel succès engendre fatalement de vives indispositions, d’amères critiques, elles furent nombreuses et parfois si virulentes qu’elles n’honorent certainement pas leurs auteurs aussi célèbres soient-ils. Les frères Goncourt s’adonnèrent à leur inéluctable jactance au vitriol, aspergeant ignominieusement les personnages : Hector Crémieux « qui monte et monte, gagne de l’argent avec les pièces qu’il ne fait pas », Ludovic Halévy « pitre juif, bobèche qui maquignonne des couplets de facture », Villemessant et Offenbach « tripotant, vendant un peu de tout, vendant un peu leurs femmes, les mêlant aux acteurs et aux actrices… », Morny « le mécène d’Offenbach, le musicien amateur, homme type de l’Empire, frotté et pourri de toutes les corruptions parisiennes… ». Offenbach doit sans cesse, malgré et sans doute même à cause de ses innombrables succès, prouver, démontrer qu’il est un authentique musicien. Émile Zola lui sera toujours hostile : « J’aboie dès que j’entends la musique aigrelette de M. Offenbach. Je hais les cascades de toutes mes haines littéraires. Jamais la farce bête ne s’est étalée avec une pareille impudence. »[7]. 1878 : nouvelle Exposition Universelle à Paris, et un des rares moments que l’on pouvait interpréter comme de désaffection du public pour le maestro. Zola ne retient plus ses foudres :
| « Songez donc ! M. Offenbach a été roi. Il n’y a pas dix ans, il régnait sur les théâtres ; les directeurs à genoux lui offraient des primes sur des plats d’argent ; la chronique chaque matin lui tressait des couronnes. On ne pouvait ouvrir un journal sans tomber sur des indiscrétions relatives aux œuvres qu’il préparait, à ce qu’il avait mangé à son déjeuner et à ce qu’il mangerait le soir à son dîner. […] Il y a dix ans ! et, bon Dieu ! comme les temps sont changés ! Il faut se souvenir que ce fut lui qui conduisit le cancan de l’Exposition Universelle de 1867. Dans tous les théâtres, on jouait de sa musique. Les princes et les rois venaient en partie fine à son bastringue. […] et voilà qu’aujourd’hui le dieu est par terre. Nous avons encore une Exposition Universelle ; mais d’autres amuseurs ont pris le pavé. Toute une poussée nouvelle de maîtres aimables se sont emparés des théâtres, si bien que l’ancêtre, le dieu de la sauterie, a dû rester dans sa niche, solitaire, rêvant amèrement à l’ingratitude humaine. À la Renaissance, Le Petit Duc ; aux Folies-Dramatiques, Les Cloches de Corneville ; aux Variétés, Niniche ; aux Bouffes, clôture ; et c’est certainement cette clôture qui a été le coup le plus rude pour M. Offenbach. Les Bouffes fermant pendant une Exposition Universelle, les Bouffes qui ont été le berceau de M. Offenbach ! N’est-ce pas l’aveu brutal que son répertoire, si considérable, n’attire plus le public et ne fait plus d’argent ? »[8] |
Et si le théâtre de La Gaîté reprend Orphée aux enfers, dans sa version en 4 actes de 1874, c’est uniquement par charité pour le malheureux maestro, affirme Zola qui prophétise que l’heure du jugement est arrivé pour Jacques Offenbach : « et c’est une terrible chose pour un artiste que cette justice lorsqu’il est encore vivant et qu’il assiste à sa déchéance. […] On se voit enterré avant d’être mort. Je ne connais pas de vieillesse plus abominable. » Peut-on être plus venimeux et plus injuste ? L’avenir mettra en pièce ces vociférations.
Voilà, n’est-ce pas, qui permet de comprendre l’animosité féroce dont Offenbach fut victime pour ses œuvres bouffes. Il n’est alors pas bien difficile d’imaginer l’âpre combat de toute une vie face aux cabales et obstructions permanentes rencontrées par le compositeur pour accéder ou se maintenir sur les scènes officielles de l’Opéra-Comique et de l’Opéra. Il y parvint somptueusement en février 1881, mais sa mort en fut le prix.
| « Nombreuses sont les légendes véhiculées autour de Jacques Offenbach. Une des plus tenaces tend à le présenter exclusivement comme un compositeur de musique légère ayant commis à la fin de ses jours un seul et unique ouvrage sérieux, Les Contes d’Hoffmann. Il n’en est rien. Tout au long de sa carrière, le père de La Belle Hélène proposera à son public des ouvrages beaucoup plus sérieux qu’Orphée aux enfers ou La Vie parisienne. Barkouf (1860), Les Bergers (1865), Robinson Crusoé (1867), Vert-Vert (1869) et surtout Fantasio (1872), ne recevront malheureusement pas le succès qu’ils méritent. »[9] |
* * *
Le 26 novembre 1860, l’Opéra affiche Le Papillon, un des meilleurs ballets romantiques, chorégraphié par Marie Taglioni, devant un auditoire de choix, l’Empereur assiste à l’évènement. Le public réserve un indéniable succès au spectacle que confirment plus de quarante représentations. Le 29 novembre 1860, Stéphen de la Madelaine, critique de L’Univers musical, résume l’interrogation que soulève l’accession du compositeur à l’Opéra :
| « Il y a bien des choses à dire pour ou contre la musique dont M. Offenbach avait eu l’incroyable fortune d’obtenir la commande. En passant, d’un seul bon, de son théâtre en miniature sur notre scène nationale, on peut dire que le compositeur avait réalisé le plus surprenant truc du ballet dont il s’agit. Hâtons-nous de dire que, si le directeur des bouffes-Parisiens n’a point justifié toutes les espérances de ses prôneurs d’office, il n’a point non plus confirmé les mauvais bruits qu’on faisait courir sur les excentricités de sa partition. […] En somme, la musique ne nuira pas au charmant ballet de M. de Saint-Georges, bien au contraire. Elle a du fouet et de l’entrain ; – c’est moins qu’il ne fallait pour un compositeur qui change d’allure : c’est ce qu’il faut pour un ballet. »[10] |
Pour Paul Scudo, ce n’est pas seulement une interrogation, mais une volonté de déloger l’intrus et de la plus obscène façon. Scudo répand de manière nauséabonde sa haine du compositeur et révèle ainsi ce qui se dissimule derrière les moues de dédain de certains critiques moins hardis :
| « … idole de la belle jeunesse et des petits journaux… il a été planté, il a été arrosé et on l’a vu naître sous les yeux de l’autorité, ce beau rosier qui a donné à la France Orphée aux enfers. […] M. Jacques Offenbach est né à Cologne de la race sémitique (comme dirait M. Renan), dont il porte l’empreinte fatale. Ni la muse de la grâce ni celle de la beauté et du sentiment n’ont voulu veiller autour de son berceau.[…] M. Offenbach est une figure légendaire, qui n’est pas sans analogie avec ce Méphistophélès des marionnettes dont parle Goethe dans ses Mémoires : on le vit surgir et se produire dans Paris, vers 1848, au milieu des éclairs et au bruit de la foudre des révolutions, les cheveux longs et en désordre, le regard douteux, le sourire satanique, tenant à la main un violoncelle, dont il jouait comme d’un mirliton. […] Nous avons été surpris de la platitude et du néant de cette muse de fantoccini[11] venant gambader sur le premier théâtre lyrique de l’Europe.[…] On peut dire littéralement, si ce n’est noblement, qu’en abordant l’Opéra, M. Offenbach a perdu son sifflet, et qu’il ne lui reste plus que les yeux pour pleurer sa profonde et légitime disgrâce. »[12] |
Offenbach cultive peu d’espoir de se voir mieux traité à l’Opéra-Comique pour la création de Barkouf, opéra comique en 3 actes, représenté le 24 décembre 1860, après plus de quatre mois de préparation. Aux difficultés avec la censure s’ajoutèrent des défections sur plusieurs rôles, y compris au-delà de la première. La huitième représentation en janvier est même annulée. L’œuvre bien accueillie par le public est victime d’une campagne de presse d’une rare violence. Le livret de Scribe – auteur habituel des livrets d’Auber – est très critiqué pour « ses inepties » et pour le fait d’avoir dévolu le rôle titre à un chien. Tout y passe : « chiennerie musicale », musique faite « d’excentriques harmonies », « wagnérienne » et l’inimitable Scudo qui blâme « les rythmes grimaçants », alors qu’un autre d’un avis tout différent dénonce « le parti pris de démolir, de conspuer ». Jean-Claude Yon de conclure :
| « Il s’agit donc bien d’un combat dont l’enjeu n’est rien de moins que la place d’Offenbach dans la vie musicale parisienne. Toutes les jalousies provoquées par la création et le succès des Bouffes-Parisiens se donnent enfin libre cours. »[13] |
La création au Hofoperntheater de Vienne, le 4 février 1864, de l’opéra romantique en 4 actes, Die Rheinnixen, arrive après des répétitions émaillées de toute une succession de défections. Pour autant, le public lui réserve un vrai succès. Offenbach souffrant ne dirige pas l’orchestre lors de la première, mais se voit gratifié d’une véritable ovation après de nombreux rappels. Dix représentations confirment le succès d’estime réservé à l’œuvre.
| « C’est la critique, et plus particulièrement la presse wagnérienne, qui va essayer de nuire à ce succès. Il faut dire que Richard Wagner, ennemi déclaré du maestro, accepte difficilement que Salvi, le directeur du Hofoper, offre à Offenbach la possibilité de faire jouer Les Fées du Rhin, et ce, en remplacement de son Tristan originellement prévu… »[14] |
Offenbach de retour en France, saisi par une frénésie de commandes suite au succès de La Belle Hélène, ne prendra pas le temps de faire représenter son opéra à Paris. Il faudra attendre cent trente-huit années pour que réapparaissent ces Fées du Rhin. Sur Forum Opéra, Christian Peter, évoque la création de la version française réalisée avec grand soin par Jean-Christophe Keck :
| « …Comme ont pu le constater les spectateurs du concert triomphal donné à Montpellier le 30 juillet 2002, il s’agit d’un véritable chef-d’œuvre ! Près de trois heures et demie d’une musique absolument somptueuse, d’une formidable puissance dramatique, qui ne génère aucun moment d’ennui et témoigne de l’immense talent d’orchestrateur d’Offenbach autant que de la variété de son inspiration. La surprise est d’autant plus inattendue que, pendant plus d’un siècle, on a considéré cet ouvrage comme une tentative ratée de grand opéra, dont le compositeur s’était résigné à réutiliser les meilleures pages dans ses Contes d’Hoffmann…»[15] |
Lorsque vient l’heure de revenir Salle Favart, l’enjeu est grand pour Offenbach. L’affront de son échec de 1860 avec Barkouf doit être relevé. Après l’immense succès de sa Grande-Duchesse, il est à l’apogée de sa gloire.
« Il a remporté les plus grands succès auxquels il pouvait rêver ; il lui faut à présent séduire le public dans un registre plus sérieux. Robinson Crusoé doit montrer tout ce qui le sépare des autres compositeurs qui se font jouer sur les théâtres de genre… »[16]
Le compositeur consacre donc toutes ses forces aux répétitions (interrompues cependant par des crises de goutte) de son nouvel opéra-comique en 3 actes. À la première de Robinson Crusoé, le 23 novembre 1867, le spectacle dure plus de 4 heures. Les traditionnelles coupures vont intervenir rapidement. Savigny dans l’Illustration commente l’œuvre :
| « Vous le voyez, la pièce est décousue, diffuse ; elle se complique de situations les plus inattendues, elle ne se décide ni pour la bouffonnerie, ni pour la gaieté, ni pour le drame. De tout un peu, voilà son défaut. »[17] |
La majorité des critiques reprochent à la partition « des longueurs excessives », trop de soin et d’effort, d’avoir trop voulu prouver une capacité à entrer dans le moule attendu. La critique la plus sévère émane d’Albert Vizentini, pour autant futur collaborateur du compositeur :
| « Si Robinson Crusoé avait répondu à l’attente générale, la Salle Favart appartenait en toute propriété à ce grand vainqueur du public cosmopolite. Malheureusement, il fallait entrer dans la place en se contentant de modifier un peu son costume peut-être trop primitif pour un théâtre où la distinction a toujours remplacé la charge. L’auteur du Mariage aux lanternes a voulu prendre la livrée de la maison sans s’apercevoir qu’elle était beaucoup trop large pour lui. Qu’importe que son verre fût petit, il fallait boire dans son verre et non se noyer dans celui des autres. […] Ce ne sont ni le poème, ni le cadre qui ont trahi le compositeur, c’est sa propre faiblesse. Au lieu de forcer son talent, il aurait dû rester le premier dans son village. »[18] |
Gustave Bertrand, lui, reproche au public de tirer le compositeur vers la facilité :
| « La seconde tentative du maestrino Offenbach à l’Opéra-Comique était chose plus grave et de plus de conséquence pour lui que la première. Au temps de Barkouf, il n’était que le roi des Bouffes-Parisiens ; aujourd’hui, c’est une des influences, une des dominations universelles de la musique. […] Ce monde élégant, aristocratique, qui a patronné M. Offenbach et, entraîné par son exemple éclatant, l’immense foule moutonnière, ce monde était surtout pour le gros sel en musique. Ce sont ces patrons-là qui ont poussé le maestro dans le sens de Trom-Al-Ca-Zar plutôt que dans celui de Fortunio ; ce sont eux qui ont tué, par exemple, sa charmante partition des Bergers[19], la meilleure peut-être qu’il ait faite, et ils l’ont tuée sous cet arrêt terrible : « ce n’est pas drôle ! » Eh bien ! ces mêmes gens se déclareront-ils satisfaits ? En se compromettant près de ses amis, le compositeur est-il sûr d’en trouver d’autres aussi nombreux et décidés ? »[20] |
Certes, le public de 1867 n’est plus celui de 1860, il est désormais beaucoup plus favorable au compositeur à qui ses triomphes successifs ont assuré, en quelques années, un indéniable prestige, mais il a surtout applaudi les passages enlevés ou bouffes qui ont fait sa renommée. Quoiqu’il en soit, la première fut un évènement parisien. Robinson Crusoé se solde par un succès d’estime avec trente-deux) représentations, alors qu’Offenbach avait espéré une consécration.
1969 : deux années se sont écoulées lorsque le maestro réapparait à la Salle Favart. Le livret de son nouvel opéra-comique, Vert-Vert est inspiré d’un vaudeville assez leste que le talent de Virginie Dejazet avait rendu populaire. Pour autant, la critique se montre sévère avec ce texte considéré comme démodé, ce qui n’empêche pas le compositeur d’écrire une vaste partition. La création le 10 mars 1969 voit le succès du superbe jeune ténor Vincent Capoul dans le rôle de Valentin, son premier grand rôle. Vert-Vert est joué trente-six fois de suite jusqu’au 31 mai, puis sera redonné dix-huit fois durant l’été. Peu importe pour les ennemis consacrés de Jacques Offenbach que le succès soit notable, ils reprennent leurs sempiternelles admonestations, vilipendant le compositeur et l’invitant à ne plus paraître Salle Favart :
| « Le perroquet n’a pas été plus heureux que le chien à la Salle Favart. Vert-Vert, pas plus que Barkouf, ne fera de vieux os. L’auteur d’Orphée, de La Belle Hélène et de La Vie parisienne fera bien de renoncer à un théâtre que son genre bouffe ne lui permet pas d’aborder. Il fera bien de ne plus se hasarder sur cette scène que de vrais maîtres ont illustrée depuis Grétry jusqu’à Auber ; et de s’en tenir aux trois théâtres sur lesquels les ouvrages que nous venons de citer ont eu le seul succès auquel l’ancien directeur des Bouffes-Parisiens puisse viser. […] On ne cultive pas impunément pendant quinze ans la bohème musicale. Le jour qu’on [sic] veut passer du bastringue au salon, on y est gauche, emprunté, mal à l’aise ; on s’y sent intrus. »[21] |
Fantasio, dont la création était programmée en 1870, arrive à l’Opéra-Comique dans une période particulièrement néfaste pour Offenbach, la guerre l’ayant contraint à s’exiler en Espagne puis en Italie, victime d’attaques virulentes dans les journaux, en raison de ses origines allemandes, de ses satires du pouvoir, de l’armée, et d’un antisémitisme certain. Les répétitions de Fantasio, inaugurant la réouverture du Théâtre de l’Opéra-Comique après la guerre, se déroulèrent donc dans un climat de grande hostilité. Bizet fut un des plus implacables en écrivant à son confrère Paul Lacombe :
| « Il faut que tous les producteurs de bonne musique redoublent de zèle pour lutter contre l’envahissement toujours croissant de cet infernal Offenbach !… L’animal, non content de son Roi Carotte à la Gaîté, va nous gratifier d’un Fantasio à l’Opéra-Comique. De plus, il a racheté à Heugel son Barkouf, a fait déposer le long de cette ordure de nouvelles paroles et a revendu le tout 12 000 francs à Heu (Heugel). Les Bouffes-Parisiens auront la primeur de cette malpropreté. »[22]. |
Le climat entourant cette création, est donc, on le voit, pour le moins délétère !
L’immense succès de la création du Roi Carotte, opéra-féérie en 4 actes, au théâtre de La Gaîté, le 15 janvier 1872, n’avait pas inspiré de critique à Gustave Bertrand, mais l’échec de Fantasio lui inspire un papier qui donne le ton dans Le Ménestrel : « Partout de l’Offenbach ! C’est [de] la production dévorante, absorbante, à l’année, au mois, à la petite semaine. Offenbach s’est fait légion et nous envahit… »[23]
Dans son second texte Offenbach, un romantique ? écrit pour notre livret consacré à Jacques Offenbach[24], Lionel Pons souligne les affinités de l’écriture du compositeur avec Weber, Schubert, Wagner, puis dans un chapitre consacré à Offenbach et Alfred de Musset après avoir abordé l’opéra-comique La Chanson de Fortunio, il s’attache à la partition qui nous importe aujourd’hui :
| « Avec Fantasio écrit pour l’Opéra-Comique, Offenbach signe, sept ans avant Les Contes, une partition véritablement selon son cœur. Le compositeur romantique, qui affleurait dans tant de passages, se livre enfin en toute liberté. Il n’y a guère que le finale du deuxième acte pour rappeler ici l’Offenbach champagne de La Belle Hélène ou La Vie parisienne. Le compositeur, dont Napoléon III confessait que sa musique s’écoutait avec les pieds, cède la place à un romantisme frémissant et pudique, à l’image de son personnage principal qui se travestit en bouffon pour mieux séduire l’héroïne. Jamais Offenbach n’est allé plus loin dans l’identification totale à un personnage, jamais son univers propre et celui de Musset ne se sont à ce point interpénétrés. C’est dire que Fantasio voyait le compositeur renoncer à beaucoup de ce qui avait jusque-là fait son succès le plus large : plus de parodie, le comique n’est plus qu’allusif et l’œuvre ne doit son appellation d’opéra-comique qu’à l’absence de mort violente et à la présence de dialogues parlés. Le public ne comprit pas Fantasio, qui reste l’une des œuvres les plus attachantes du maître. Aucune reprise française n’était venue la tirer de l’oubli depuis plus d’un siècle, et il a fallu à la fois la patiente ténacité, le dévouement de Robert Pourvoyeur et le courage de la direction du Théâtre de Rennes pour que Fantasio nous soit enfin rendu, incarné par Martial Defontaine. La surprise du public s’est renouvelée, tant le climat poétique de l’œuvre d’un bout à l’autre de la partition (écoutez la Ballade à la lune que chante le héros au premier acte) surprend, mais son adhésion et son enthousiasme montrent combien Offenbach avait compris Musset, quelles résonances secrètes il trouvait dans le romantisme de l’auteur de Lorenzaccio. » |
C’était en 2000, qu’eut lieue cette reprise à Rennes, et sur quelques autres scènes françaises, de Fantasio dans une version hybride entre la version pour mezzo-soprano de 1872 de Paris et celle de Vienne pour soprano, toutefois chanté par un ténor, avec des parties réorchestrées. D’autres reprises eurent lieu en Allemagne.
Il faudra l’infatigable et passionnel travail de bénédictin réalisé par le musicologue et chef d’orchestre, Jean-Christophe Keck, pour que la version pour mezzo-soprano soit enfin reconstituée, éditée chez Boosey & Hawkes & Bock et donné en version de concert au Festival de Radio-France-Montpellier, en 2015. C’est cette version Keck qui présida à l’enregistrement de l’œuvre chez Opera Rara, en 2013 – avec le soutien du Palazetto Bru Zane –, et qu’a retenu l’Opéra-Comique, pour sa réouverture de 2017.
Nous ne serons jamais assez reconnaissant à Robert Pourvoyeur (1924-2007) et plus encore à Jean-Christophe Keck d’avoir rendu possible la résurrection historique de ce chef-d’œuvre.
Il est relativement commun de posséder la carte bénéfique d’une bonne naissance, un peu moins celle de posséder du talent, ou encore celle d’avoir eu l’opportunité de poursuivre de brillantes études et de posséder de sérieuses connaissances musicales, pour autant celle du génie les surclassent toutes lorsqu’elle se manifeste, faisant fi de tout le reste, et ce malgré toutes les réticences et les embûches soigneusement distillées. Il aura fallu qu’Offenbach disparaisse à 61 ans pour que ses Contes d’Hoffmann surclassent les œuvres de ses rivaux excédés, amers, sans doute jaloux de l’abondance intarissable de sa source et encore 145 années de rejet, d’oubli, puis de patiente reconstruction pour que Fantasio, cet autre joyau du maestro, soit couronné à l’Opéra Comique et prenne sa place au grand répertoire.
Et dire que cela se passe à Paris en 2017… qui s’apprête, d’ici 2 ans, à fêter le bicentenaire de la naissance, en 1819, de Jacob Eberst à Offenbach-sur-le-Main, près de Francfort, de celui qui devint le « Mozart des Champs-Élysées » ou le plus parisien des compositeurs, un des plus considérables génies du théâtre musical de tous les temps, que l’on en soit dépité ou enchanté !
______________________________________
L’ÉNIGME GENEVIÈVE DE BRABANT
La parution toute récente de l’une des six versions radiophoniques de la Geneviève de Brabant d’Offenbach, dans la collection I.N.A Mémoire Vive, relance l’intérêt des auditeurs pour l’un des ouvrages les plus énigmatiques du grand Jacques. Comme le souligne Alain Joubert, il a toujours été plus qu’attentif à cette « fille » pourtant mal aimée du public, qui jamais ne s’est finalement imposée au répertoire (malgré un beau succès pour les versions remaniées) de façon durable. Pourtant, la partition, comme l’enregistrement permet d’en juger à nouveau, est un véritable condensé du génie du compositeur et accumule airs, ensembles et finales plus réussis les uns que les autres, à la fois dans la veine tendre qui laisse entrevoir à nu l’âme d’un compositeur romantique, et dans celle de la bouffonnerie la plus échevelée. Pourquoi donc cet opéra-bouffe si copieux, et auquel visiblement Offenbach tenait plus qu’à d’autres, constitue-t-il une énigme, cent cinquante ans après sa création ?
Le livret de Jaime et Tréfeu, conçu pour la première version en deux actes, est un parfait contre-exemple de la bonne recette de théâtre. Offrant une trop grande abondance de personnages et de péripéties secondaires, décousu, confinant dans son sens burlesque au surréalisme (ce en quoi il anticipe sur les chefs-d’œuvre à venir d’Hervé, Chilpéric ou L’Œil crevé), il ne possède en rien la cohérence dramatique, l’efficacité ramassée des futures pièces de Meilhac et Halévy. Et l’on se prend même à s’interroger sur ce qui, dans cet amoncellement de gags et de situations proches de la revue ou de la comédie à sketches, a pu tenter un compositeur dont l’instinct théâtral n’est pourtant pas sujet à question. Le problème a été précisément évoqué par Jean-Claude Yon dans sa biographie de référence sur le compositeur.
Mais si là se limitait le problème, il ne serait pas spécifique en somme de Geneviève de Brabant, puisque aussi bien les mêmes interrogations peuvent être soulevées à propos de Maître Peronilla, par exemple. La vraie spécificité de Geneviève réside dans son héroïne. Force est de constater que la femme chez Offenbach est toujours figure agissante. C’est elle qui décide, elle qui prend l’initiative amoureuse, elle qui constitue le moteur du drame, qu’il s’agisse d’Eurydice, d’Hélène, de Catarina, de Metella, de la Grande Duchesse, de la Périchole, de Fiorella, de Madame L’Archiduc ou de Madame Favart. Dans tous les cas, Offenbach se fait, plus encore que Massenet, pour qui le qualificatif a été pourtant forgé, le musicien de la femme, et plus encore celui de l’éternel féminin, servi sous tous ses visages. Geneviève est une exception en la matière. Elle subit son destin sans en être le moins du monde acteur, sans tenter d’infléchir le cours de l’injustice qui la frappe. Malheureuse en amour, elle n’essaye aucunement de forcer son époux à consommer une union, si ce n’est en espérant que le fameux pâté y changera quelque chose, mais se résigne tout aussitôt. La présence du petit pâtissier-page Drogan (qui anticipe celle d’Amoroso dans Le Pont des soupirs) ne débouche pas, de sa part, sur un désir de vengeance que n’auraient pourtant dédaigné ni Hélène ni la Grande Duchesse. Le malaise vient précisément de cette figure d’anti-héroïne, qui ne se voit d’ailleurs attribuer aucun grand air. Sa présence dramatique est, en fait, une absence et c’est cette absence qui, par jeu de miroir, prive les autres protagonistes de profondeur dramatique. Que Drogan devienne un équivalent de Chérubin, et le voilà converti en roué Amoroso ; que Geneviève résiste ou feigne simplement de lui céder, et voilà Golo parvenu au rang de véritable Iago d’opérette. Mais précisément, l’ouvrage s’arrête toujours à mi-chemin de ces caractérisations.
S’il est un modèle moral de Geneviève, c’est du côté de la Comtesse des Noces de Figaro que nous pouvons le trouver. La Comtesse de Mozart, si elle demeure noble et blessée dans son sentiment amoureux, reste ferme dans son désir de voir revenir à elle un époux qu’elle n’a jamais cessé d’aimer. Elle trouve son prolongement en Suzanne, qui devient le versant actif de cette démarche. Brigitte, dans l’opéra bouffe, ne remplit nullement cette fonction vis-à-vis de sa maîtresse.
Sur le plan de la caractérisation vocale, Geneviève est également un cas à part. Les héroïnes d’Offenbach sont, soit des voix dont la couleur de mezzo reste toujours marquée, soit des sopranes capables de virtuosité dans l’aigu. Or, bien que soprano, Geneviève ne recoupe nullement l’une ou l’autre des catégories. Le personnage se dessine en négatif, ce qui n’est pas sans le rendre attachant, mais ne suffit pas à garantir l’unité de l’œuvre.
Malgré ces faiblesses, dont il était parfaitement conscient au moment de la création de la première version, et qui ne disparaîtront pas lors des agrandissements successifs de l’ouvrage, Offenbach tenait à cette figure de femme à la fois effacée et présente. Il ne nous appartient pas de tenter une explication d’ordre psychanalytique, mais sans en arriver à des extrémités spéculatives qui ne seraient le reflet d’aucune réalité vérifiable, il n’est pas incongru d’y voir un reflet de l’attitude qui sera celle de l’épouse du compositeur, de cette patiente Herminie toujours si douce, si loin de ce microcosme agité du théâtre, et qui saura fermer les yeux sur l’épisode Zulma Bouffar. Bien que sans enfant, Geneviève reste une figure maternelle, qualité que ne possède rigoureusement aucune autre héroïne du musicien, ce qui explique sans doute qu’elle ne réponde pas à l’attachement de Drogan sur le mode amoureux.
Je n’ai nullement la prétention, en quelques lignes, de résoudre une énigme, mais tout au plus de proposer quelques pistes de réflexion supplémentaires à propos d’un ouvrage dont la qualité musicale demeure indéniable, et même particulièrement soutenue, mais qui brille dans la constellation offenbachienne d’un éclat tout à fait particulier. Ce qui peut passer pour un relâchement dramaturgique propose en creux le profil d’une femme sur laquelle Offenbach ne reviendra que pour la confirmer, comme si elle avait constitué un pôle d’attachement, une sorte de catharsis nécessaire. Profitons donc, sans retenue aucune, de l’opportunité de la redécouverte que nous offre I.N.A Mémoire Vive (même si le choix de la version peut laisser perplexe, tant celle qui réunissait Annick Simon et Bernard Plantey présentait des conditions d’écoute préférables encore). Geneviève de Brabant est une œuvre de troupe, et il est difficile à ce titre d’espérer la revoir sur scène ; elle semble faite sur mesure pour les chanteurs attitrés du service Radio Lyrique, dont la cohésion scénique reste perceptible, même dans le cadre d’une simple écoute.
ψ ψ ψ ψ
Geneviève de Brabant de Jacques Offenbach
Opéra-bouffon en 2 actes, 1859
Nouvelle version en 3 actes, 1867
― version double CD, INA, mémoire vive IMV080 ―
opéra-bouffon-féerique en 5 actes, 1875
_______
Il y a des années, je plongeais mes collègues de travail dans l’hilarité la plus débridée avec les Couplets de la poule, du premier acte de Geneviève de Brabant, exubérante exaltation (bien vite démentie) de l’infortuné duc Sifroy : Une poule sur un mur… qui picotait du pain dur appelait en cocotant son coq absent pour l’instant ; on était au mois de mai et déjà l’air enflammé émoustillait jusqu’aux os, les chats, les chiens, les oiseaux ! Frank T’Hézan en donnait une version délirante et vertigineuse, lors du concert de Radio France du 31 mai 20021.
Pourtant cette Geneviève, riche de « tubes », laisse peu d’empreinte dans la mémoire collective. À la satire des Dieux de la mythologie succède celle des preux chevaliers et croisés des temps médiévaux. La première version, avec laquelle Offenbach avait espéré une réplique du considérable succès de son Orphée aux enfers (1858), reçoit un accueil médiocre que d’immédiates retouches et révisions ne sauvent pas d’un désintérêt du public. La version féerique de 1875, avec ses rôles supplémentaires inutiles, ses ballets, ne résiste pas au temps, ni à la furieuse folie budgétaire qu’elle réclame. La version en 3 actes de 1867 s’est imposée pour toutes les reprises de l’ouvrage2. Pour cette version, Offenbach avait exigé une refonte du livret d’Adolphe Jaime fils et Étienne Tréfeu. Hector Crémieux et Tréfeu restructurèrent l’intrigue et lui donnèrent la cohésion qui faisait défaut à la version de 1859. Les ajouts musicaux soignés confirment le vif intérêt du compositeur pour cette partition, l’une de ses préférées. Il ne fera de semblables remaniements que pour La Périchole, Orphée aux enfers, Les Brigands et La Boulangère a des écus. Mais une succession de trois versions, sans tenir compte des modifications immédiates, n’aura été réservée qu’à cette seule Geneviève de Brabant.
Le Moyen-Âge revu et corrigé par Offenbach3. Cour grotesque et flatulente où l’on attrape des indigestions d’un pâté aux effets prétendus magiques et bien évidemment mensongers ― mollement compensés par un thé purgatif ― qui aurait dû parer aux faiblesses du duc Sifroy (duc de Curaçao). Margrave, entouré d’un conseiller maléfique Golo (type de l’homme politique moderne, amoral, doté d’une ambition forcenée qui ne recule devant rien, même devant le meurtre !), du bourgmestre Van der Prout ― qui, comme un des conseillers avisés du Prince Fridolin du Roi carotte, ménage astucieusement la chèvre et le chou (le Jack Lang de l’époque !) ―, et de Narcisse, poète de pacotille.
L’air d’entrée de Charles Martel campe un personnage haut en couleur. Ce Boléro trépidant est une page de caricature musicale hilarante… on comprend enfin l’utilité de l’arme des Pépins, lorsqu’elle accueille une bassine d’eau « filtrée », jetée du haut de sa fenêtre par le duc irrité, indisposé par les suites malheureuses de son festin ! Les gendarmes Grabuge et Pitou dans les Couplets des deux Hommes d’Armes, « Protéger le repos des villes… », à l’acte II, ridiculisent les forces de l’ordre. L’opinion d’Offenbach sur l’autorité, sous ses diverses formes, est ici mordante. On en avait déjà eu une cinglante idée avec Orphée aux enfers !
Le départ en train à la gare du chemin de fer du Nord annonce le finale de l’acte premier de la Belle Hélène, une des pages les plus justement célèbres du compositeur. Après la tragi-comique scène de répudiation de Geneviève (absente de cet enregistrement) dans laquelle Golo – ayant l’intention de l’épouser après avoir détrôné le duc Sifroy – la fait passer pour infidèle, la compagnie entonne le chant du départ pour la Palestine, thème si typique des finales étourdissants du maestro, et qui aurait dû être aussi populaire que ceux de ses autres chefs-d’œuvre, car Offenbach aime que l’on s’amuse et qu’on l’applaudisse !
Nous suivons ensuite les errances de Drogan, de Geneviève et de sa fidèle confidente parmi tous les dangers : orages, ravins, hommes d’armes et monstrueux Golo.
Puis nous retrouvons les croisés à Asnières, stoppés là, fort joyeusement dans leur étrange croisade. En effet, la grande fête du finale de l’acte II se déroule chez Charles Martel : Chanson des cocodettes, Ronde des infidèles, Tyrolienne hystérique, Farandole furieuse, déclinent le catalogue des dévergondages et s’achèvent en bacchanale. On se souvient, éblouis, d’une reprise de ce final dans son intégralité lors du concert de Radio France précité, programme concocté par Jean-Christophe Keck, maître incontestable de l’actuelle Offenbacchiade.
L’acte III, toujours bref, comporte en dehors des Couplets de la biche (alla Mozart, petit bijou de tendresse) un inénarrable Quatuor de la chasse4 qui, à lui seul, mérite le détour. C’est l’une des pages les plus amusantes du maestro. Tout se termine bien, Golo sera puni par sa propre femme qu’il avait lâchement abandonnée. Les beaux rôles sont toujours pour la femme chez notre musicien, elles donnent des leçons cinglantes aux hommes assez frustes, lamentables ou médiocres et surtout risibles… comme dans la vraie vie ! Un Offenbach ici sans masque ?
En cet enregistrement se manifeste aussi l’autre Offenbach avec la fileuse, « travaillons comme des fées », le Trio de la main et de la barbe, les Couplets de la mèche et ceux encore de la Biche, celui qui annonce le grand romantique des partitions telles que Die Rheinnixen, Fantasio, La Chanson de Fortunio, Les Contes d’Hoffmann…. L’amour du page Drogan pour Geneviève inspire des pages bucoliques et tendres au compositeur. Drogan, ainsi que le note subtilement Jean-Claude Yon, est double de Chérubin. Ne le retrouve-t-on pas, caché derrière un fauteuil, dans le boudoir de son aimée ?
L’I.N.A. nous restitue, à prix modique, une des six versions réalisées par les services de Radio-Lyrique. Datée de 1956, celle-ci fut la première de la série. Les têtes d’affiche en justifient l’exhumation. Jugez-en : Denise Duval, Jean Giraudeau, Robert Massard et Michel Hamel sous la direction de Marcel Cariven. Que du beau monde ! Deux autres versions avaient été momentanément disponibles, difficilement trouvables aujourd’hui.
Se servir d’Offenbach ― ce qui est commun ―, c’est monter une de ses œuvres qui remplit à coup sûr les théâtres et les caisses. Servir Offenbach, c’est montrer la constance et l’étendue de son génie en représentant ou en enregistrant une œuvre moins connue et ressassée. Nous aurions tous à y gagner, à commencer par Geneviève de Brabant, « où les trésors abondent »5, ouvrage assez riche pour prendre place parmi les chefs-d’œuvre offenbachiens. Voilà le cadeau à faire aux mélomanes, mais aussi au compositeur dont Geneviève était une fille chérie entre toutes. □
______________________________
La Vie parisienne
ou notre reflet dans le miroir
Votre serviteur attendait avec quelque impatience la sortie du DVD que le label Virgin Classics consacre à La Vie parisienne de Jacques Offenbach dans la production de l’Opéra de Lyon fin 2007 et dans la mise en scène de Laurent Pelly. Au risque de paraître un peu rabat-joie, j’avoue avoir franchement détesté les précédentes incursions de Laurent Pelly chez le compositeur. L’obsession du mouvement y remplaçait parfois l’esprit, faisant presque double emploi avec ce que la musique suffisait amplement à suggérer. Cette remarque ne vaut d’ailleurs que pour la scénographie, tant les distributions étaient chaque fois non seulement idoines, mais même luxueuses, rendant pleine justice à l’œuvre.
Cette production de La Vie parisienne, qui n’a pas bénéficié dans la presse d’un accueil toujours chaleureux tranche pourtant de façon très heureuse sur les faiblesses du travail de Laurent Pelly dans Orphée aux enfers, La Belle Hélène ou La Grande-Duchesse de Gérolstein. Passons rapidement sur l’apport de la « dramaturge » attitrée du metteur en scène. Visiblement, Agathe Mélinand est persuadée que la suppression de quelques répliques parlées que, sans doute, elle ne juge pas assez « dans le vent », et l’adjonction de quelques trivialités bien senties sont indispensables à la remise au goût du jour de Meilhac et Halévy. Faisons jeunes, que diable, et conjurons la peur de la ringardise avec ces quelques replâtrages qui ne sont pas précisément drôles ! Un livret est affaire d’esprit, et les comparses d’Offenbach n’en manquaient pas, mais n’est pas drôle ou corrosif qui veut. En dehors de cette réserve, on ne peut que louer ce DVD qui se regarde et s’écoute avec un plaisir manifeste.
La distribution est jeune, mais mieux que bien choisie. Pélleas de premier ordre, Jean Sébastien Bou est un Gardefeu de premier rang. Vocalement parfaitement en place, bon comédien et s’acquittant de sa tâche avec un plaisir visible et partagé, il irradie de présence scénique l’ensemble du plateau. Marc Callahan surprend agréablement en Bobinet. On s’habitue très vite à son accent, et même si la voix n’est pas celle d’un fort baryton, il est parfait d’un bout à l’autre, drôle et attachant. Du côté de ces dames, la palme revient haut la main à Marie Devellereau. Sa prestation dans le rôle de la gantière la conduit à passer de l’ingénue à la courtisane avec une aisance déconcertante, renforcée par une technique sans faille. Plus retenue, mais pleine de qualités se révèle la Metella de Maria Riccarda Wesseling.
Laurent Naouri rend presque touchant le personnage du Baron suédois entraîné, avec son propre consentement, dans le tourbillon des fêtes parisiennes. Mais c’est l’ensemble de la distribution qu’il nous faudrait citer ici. Mention toutefois au brésilien de Jésus Garcia. Vibrant de joie de vivre, crédible jusque dans ses débordements, il incarne à la perfection ce personnage fugace mais si représentatif.
Représentation, c’est bien le mot dont il s’agit. Car la mise en scène souligne l’actualité du livret. Cette société qui s’étourdit, s’oublie, s’anéantit dans la quête effrénée du plaisir, dansant comme sur un volcan, n’en doutons pas c’est la nôtre, plus de cent ans après la création de l’œuvre. Chaque détail scénique est une trouvaille qui nous transporte du sourire au malaise. Jamais Pelly n’a aussi bien servi Offenbach, et la direction énergique (mais pas trop précipitée) de François Roussillon ne contribue pas peu à la présente réussite. C’est un miroir qu’il nous tend, et qui ne nous renvoie guère d’image flatteuse. Qu’importe, il faut avoir la force d’en sourire, le message n’a pas vieilli depuis Rabelais.
La parfaite coïncidence de la mise en scène et de la musique vient sans doute de ce que la première ne sonne pas comme un pléonasme avec la seconde, mais comme un prolongement logique. Le seul regret que l’on formulera est la suppression, hélas commune, de l’acte IV. Presque entièrement parlé (un seul numéro chanté), ce dernier fait apparaître la fiancée officielle de Gardefeu et permet de comprendre comment et pourquoi la baronne est informée de l’inconduite de son mari. Cet « acte des femmes » manque cruellement, d’abord parce que les chanteurs, excellents comédiens ici, lui auraient donné toute sa dimension, ensuite parce qu’il demeure indispensable à la cohérence de l’action. Rien n’explique le dénouement de l’ouvrage : pourquoi Metella connaît-elle la baronne, comment le baron réalise-t-il que Gardefeu l’a berné ? Plutôt que l’ajout de quelques répliques discutables, le travail de la dramaturge attitrée de Laurent Pelly aurait pu contribuer à maintenir tout ou partie de cet acte négligé.
C’est une réserve de pure forme, face à une réalisation exemplaire, dont on souhaite qu’elle ne soit pas la dernière du genre et surtout qu’elle trouve un accueil chaleureux auprès de tous les publics.
Le Docteur Ox
Jean Alain Joubert
Avril, novembre, décembre 2004, révision mai 2017
Jacques Offenbach n’aura jamais cessé d’écrire des œuvres pour le théâtre depuis 1839 avec Pascal et Chambord (il avait juste vingt ans !), puis de manière « intempestive » – disaient ses détracteurs – à partir de l’ouverture de ses Bouffes-Parisiens, en raison de l’abondance invraisemblable de sa production sur vingt-cinq années : soit plus de cent ouvrages lyriques !
On ne cesse de le voir comme le musicien du Second Empire, même si cette image est réductrice et surtout inexacte. En 1870, il avait encore dix années à vivre, et son intensité créatrice ne faiblit jamais jusqu’à son ultime opéra-comique en 3 actes Belle Lurette (1880) – orchestrée par Léo Delibes – et son opéra fantastique Les Contes d’Hoffmann (1881), dont l’achèvement de l’orchestration fut, cette fois, confié à Ernest Guiraud (1837-1892).
Sans aucun doute, les circonstances furent moins favorables et heureuses pour lui après le Second Empire, mais nombre de ses œuvres sont des chefs-d’œuvre tout autant que certaines Belle Hélène (1864), Vie Parisienne (1866), Périchole (1868)… Nous avons le privilège d’en connaître un certain nombre, qui nous confirme dans cette vision. Citons : Fantasio de 1872 (opéra-comique), Pomme d’Api et La Jolie Parfumeuse de 1873, Madame l’Archiduc de 1874, La Créole et Le Voyage dans la lune de 1875, Maître Péronilla et Madame Favart de 1878, La Fille du tambour-major de 1879, Belle Lurette de 1880.
Mais qui se souvient de ce Docteur Ox, opéra-féérie en 3 actes, dont la création eut lieu le 26 janvier 1877 ?
Il convient de resituer cette période de la vie du compositeur pour mieux en comprendre le sens. La guerre de 1870 fut une rude épreuve pour Offenbach, et il est certainement aujourd’hui difficile d’imaginer qu’on le tenait en quelque sorte pour « responsable » de ce conflit et de ses conséquences. Les attaques dans certains journaux français furent particulièrement violentes, et cela se pourrait comprendre si l’on adopte la vue simpliste consistant à penser que ce petit juif allemand serait venu en France pour se moquer et ridiculiser nos institutions et les démolir. Par contre, plus difficiles à concevoir, s’avèrent les attaques des journaux allemands l’accusant de trahison : « Offenbach s’est rendu coupable d’un véritable attentat contre son pays natal en composant ses opérettes, écrit le Leipziger Allgemeine. Ce qui lui a permis d’obtenir la richesse et la Légion d’honneur, c’est précisément ce contre quoi la guerre est entreprise aujourd’hui[2]. »
Le 12 février 1871, Anton Lager écrit à Johann Strauss : « Il te revient la tâche de nous réjouir désormais par des œuvres saines, fraîches, splendides et de le faire en cette année où les armées allemandes se sont montrées si supérieures à l’armée française, de sorte qu’Offenbach lui aussi soit obligé de lutter en Allemagne.[3] » La presse autrichienne n’est pas moins chauvine et le journal satirique Der Floh fanfaronne : « Avant-hier est survenu un grand événement. La France a été battue… pas la noble et grande France, mère des libertés… non ! la France libertine, celle du cancan et de la frivolité, la France de M. Jacques Offenbach a été touchée en plein cœur[4]. » Ainsi l’Indigo de Johann Strauss, créé le 10 février 1971, se voulait telle une nouvelle victoire sur la France : celle de l’opérette ! Mais la riposte bienveillante de Jacques Offenbach – qui entretenait de bonnes relations avec Johann Strauss qu’il avait lui-même invité à écrire des œuvres lyriques – allait être un coup de maître : il propose la version allemande de sa Princesse de Trébizonde, créée en 1869 à Paris. Ainsi Die Prinzessin von Trapezunt est jouée au Carltheater le 18 mars 1871, sous la direction du compositeur. Cet ouvrage sera un des plus grands succès viennois d’Offenbach, qui pourtant en avait obtenu de nombreux et retentissants en cette ville. Si Indigo, l’ouvrage de Johann Strauss, connaît un très honorable succès avec 70 représentations entre 1871 et 1874, La Princesse de Trébizonde atteint la cinquantième en mai 1871 ; le compositeur en personne dirige la centième en juillet 1873 et, comble de revanche, l’empereur François-Joseph honore de sa présence la soixante-seizième représentation en début d’année 1872 !
En France, il doit affronter quelques revers assortis de critiques, vives et âpres, de la part de ses confrères. Bizet, par exemple, aura des mots d’une inexplicable aigreur, alors qu’Offenbach avait contribué à son lancement en le faisant lauréat du concours des Bouffes en 1856-57 avec l’opérette Le Docteur Miracle – Charles Lecocq signait l’autre partition primée. Ainsi en 1872, Paul Lacombe recevait ces lignes de Georges Bizet : « Il faut que tous les producteurs de bonne musique redoublent de zèle pour lutter contre l’envahissement toujours croissant de cet infernal Offenbach !… L’animal, non content de son Roi Carotte à la Gaîté, va nous gratifier d’un Fantasio à l’Opéra-Comique. De plus, il a racheté à Heugel son Barkouf, a fait déposer le long de cette ordure de nouvelles paroles et a revendu le tout 12 000 francs à Heugel. Les Bouffes-Parisiens auront la primeur de cette malpropreté[5]. » Propos qui se révèlent inexacts, les révisions effectuées par Jean Christophe Keck pour une réédition, montre que Boule de neige est une nouvelle partition du compositeur.
Peut-on dire que ce soit seulement à la manière d’Anarin[6] affirmant qu’ils « lui ont offert un bel enterrement pour le remercier de les avoir quittés », ou plus vraisemblablement en raison d’une sincère admiration – alliée il se peut, à un pressentiment de ce qui allait lui advenir – qui inspira à Offenbach une pensée émue et obligeante pour son malheureux confrère. Il adressait, en effet, à son cher Halévy, ces lignes[7] de Vienne, le 20 janvier 1876 : « … J’ai vu à l’Opéra Carmen de notre pauvre Bizet. C’est admirablement donné, et cela fait grand plaisir. Ah, quelle adorable musique, quelle orchestration. Comme c’est compris ! Pauvre Bizet. Ce 3ème acte m’a fait venir les larmes aux yeux. Quel talent perdu à jamais. »
Dans cette situation contrastée – avec des rivaux qui, en France, sonneront le glas de l’opéra bouffe selon Offenbach pour en arriver à l’opérette bourgeoise – il va s’adapter et inventer des formes nouvelles, donner libre cours à sa poésie et à sa plume romantique et mélancolique, revenant par intermittence à ce qui avait fait sa plus grande gloire. C’est dans ce contexte que le début de l’année 1877 voit apparaître l’œuvre nouvelle : Le Docteur Ox.
Si Robert Pourvoyeur[8] conteste, en cet ouvrage, l’étirement de l’intrigue sur trois actes, avec l’introduction d’une histoire d’amour qu’il juge peu intéressante et qui n’est pas dans l’excellent texte de Jules Verne, il reconnaît que la musique abonde en trouvailles. Une version allemande que nous avons le privilège de connaître, fait entendre cet Offenbach trépidant qui pourvoit en délices les nombreux admirateurs de La Vie Parisienne ou des Brigands. Le final de l’acte II, galop effréné qui fait penser à celui du quatrième acte d’Orphée aux Enfers, est repris avec la Marche Bohémienne ainsi que la Scène n° 7, dans Christopher Colombus, compilation faite essentiellement d’extraits d’œuvres[9] d’après-guerre du Maestro [enregistrement Opera Rara].
Dans son ouvrage, Jean-Claude Yon nous relate les péripéties des répétitions en décembre 1876 et les vives tensions entre Eugène Bertrand, directeur des Variétés, et le compositeur. Rien cependant ne saurait arrêter Offenbach dans son frénétique besoin de créer. Comment résister au plaisir de vous faire entendre le récit d’Arnold Mortier[10] – confirmé par plusieurs autres témoignages – d’une répétition du Docteur Ox aux Bouffes en janvier 1877 :
|
L’œuvre reçoit un accueil très favorable autant du public que de la critique. Lisons Savigny[11] exprimant son admiration pour le maestro :
| C’est toujours cette verve de M. Offenbach qui se donne depuis tant d’années sans s’épuiser. J’entends quelquefois reprocher à ce compositeur de se ressembler à lui-même. Il ne se modifie pas, dit-on. À moins de devenir ennuyeux, que voulez-vous qu’il fasse ? Il conserve toujours son accent à lui, comme les bons crus gardent toujours leur goût. Ses formules sont les mêmes, je le veux bien, mais il vit toujours par le rythme, par la clarté et par un sentiment tout particulier de l’effet scénique. |
Par sa verve délicieuse, la grande vedette de cette œuvre est Anna Judic[12] pour laquelle Offenbach avait écrit trois des joyaux de la partition : la Légende de la guzla, la Chanson bohémienne et le Rondeau de la kermesse. Offenbach lui dédie la partition et lui adresse une lettre publiée par la presse le 30 janvier :
| Je ne peux laisser passer la journée sans vous dire combien vous avez été admirable hier au soir. Quelle diction merveilleuse ! Quelle admirable façon de chanter ! Je suis, comme le public, encore sous le charme. Aussi pour vous punir de tout le plaisir que vous m’avez fait, et aussi pour vous remercier, je vous prie de laisser mettre en grosses lettres votre nom sur la partition du Docteur Ox. Je vous la dédie. Tant pis pour vous[13]. |
Même succès lors de l’audacieuse reprise en décembre 2003, au Théâtre de l’Athénée à Paris, par la Compagnie Les Brigands sous la direction du fils de nos amis Arlette et Jean-Claude Lévy. Benjamin Lévy, assistant de Marc Minkowski, fut aussi l’élève de notre ami le maître et chef d’orchestre Jean-Jacques Werner :
|
Le même souci anime l’interprétation musicale, tant de la quinzaine de chanteurs presque tous issus des chœurs des Musiciens du Louvre que de la douzaine d’instrumentistes puisés à la même source par Benjamin Lévy, assistant de Marc Minkowski qui témoigne à 27 ans d’une remarquable aisance : pas de doute, ce Docteur Ox est bien fils de La Belle Hélène qui triomphe actuellement au Châtelet ! Une parenté qui autorise exigence et sévérité…
L’orchestre galope, les chanteurs comédiens esquissent des quadrilles endiablés, les couples légaux cèdent devant le désir, une servante à la cuisse avenante et au caquet digne de Toinette règne sur la maison du maire avec un toupet entraînant (l’excellente Karine Godefroy). Quant au Docteur Ox du ténor Christophe Crapez, il s’affirme dans son délire scientiste comme le père du Spalanzani des Contes d’Hoffmann.
|
La critique de Jacques Doucelin (Figaro du 19 décembre 2003) émet bien quelques réserves sur la mise en scène de Stéphane Druet, tout en rejoignant l’assentiment et l’enthousiasme général (Jean-Luc Macia, La Croix ; Michel Parouty, Les Échos). Ce Docteur Ox quitta le Théâtre de l’Athénée pour une tournée en France, début 2004, qui aura quelques prolongements en 2005, à Blagnac (Haute-Garonne) et à Vevey (Suisse). Un documentaire de 52 minutes, intitulé Un certain Docteur Ox, sera présenté sur Arte le 8 janvier 2005. Il est déjà disponible, ainsi que cet ouvrage, sur support DVD.
Benoît Duteurtre recevait le 4 décembre 2004, dans son émission « Étonnez-moi Benoît », sur France Musiques, le jeune chef Benjamin Lévy. Ce dernier dirige Ta Bouche[14] avec la même troupe intrépide qui donnait Barbe-Bleue [ma nièce Sophie, journaliste à L’Est Républicain, avait rédigé plusieurs articles[15] enthousiastes lors de la représentation de l’œuvre, en 2000, à Montbéliard] Geneviève de Brabant et Le Docteur Ox. Souhaitons bonne chance à Benjamin Lévy et à tous ses camarades qui redonnent une belle jeunesse à des œuvres trop négligées de notre répertoire léger.
Si aujourd’hui Offenbach semble reprendre une juste place dans l’univers musical français, après le purgatoire, traversé au XXe siècle, le laissant pour un amuseur, un pitre et même un musicien vulgaire – réputation due essentiellement aux réorchestrations et à certaines mises en scènes du plus mauvais goût –, sommes-nous pour autant conscients de son génie unique et de la force de son message ?
Avons-nous désormais assimilé la remarquable analyse de l’œuvre d’Offenbach, publiée en 1871, par l’écrivain Eiça de Queirós[16] ?
|
Non, amis dramaturges, vous n’avez pas compris Offenbach ! Offenbach ! Il vous dépasse tous. Lui a une philosophie, vous, vous n’avez pas une idée ; lui a une critique, vous, vous n’avez pas même une grammaire ! Qui, comme lui, a battu en brèche tous les préjugés de son temps ? Qui, comme lui, a discrédité pour toujours les vieilles institutions, avec quatre mesures et deux violons ? Vous, avec votre austérité, vous n’avez pas rendu un seul service au bon sens, à la justice, à la morale. Vous n’avez fait qu’endormir ! Et lui ? Le militarisme, le despotisme, l’intrigue, le sacerdoce vénal, la bassesse courtisane, la vanité bourgeoise, il a tout battu, tout retourné, tout ébranlé en un couplet fulgurant !
Non, haute bourgeoisie, tu n’as pas bien fait de l’applaudir et de le protéger. Tu as cru trouver en lui un passe-temps, c’est une condamnation qui t’attendait. Sa musique est ta caricature. Les théâtres sont-ils si mal éclairés, votre entendement est-il si étroit, que vous ne vous soyez pas reconnus chacun à votre tour dans cette éclatante galerie des médiocres de votre temps ? Le roi Bobèche n’est-il pas la fantasmagorie chantée de votre royauté ? Calchas de La Belle Hélène, n’est-il pas la mascarade païenne de votre clergé ? Le général Boum n’est-il pas la personnification éclatante de votre stratégie de salon ? Le baron Grog n’est-il pas la grotesque pochade de votre diplomatie ? Le trio de la conspiration n’est-il pas la photographie en couplets de vos intrigues ministérielles ? La Grande-Duchesse n’est-elle pas dans son entier la charge implacable de vos armées permanentes ? […] Offenbach est une philosophie chantée[17].
|
Relevant d’une identique observation, tout aussi pertinente et lucide, apparaît l’article nécrologique consacré au compositeur, paru le 5 octobre 1880 dans Le Gaulois, sous la plume de Fourcaud :
|
Il comprit que pour amuser son époque, il fallait se moquer d’elle, et il s’en moquait audacieusement, à visage découvert, comme jamais, en aucun temps, artiste n’osa le faire. […] Cet homme d’esprit et de talent, qui avait le respect des belles choses et le sentiment des petitesses présentes, a saisi, pour nous flageller, les verges que nous lui tendions. S’il nous a divertis, c’est à nos propres dépens. Par là, il s’est assuré une page dans l’histoire de l’art actuel et aussi dans les annales du monde où nous vivons. Sa physionomie de railleur ne ressemble à aucune autre. Vue sous un certain angle, elle est presque tragique. L’avenir nous reconnaîtra dans les caricatures qu’Offenbach a tracées et dont nous avons osé rire, alors qu’il n’était qu’urgent de nous corriger.
|
Dédions donc cette page de clairvoyance journalistique au rédacteur du journal Der Floh [18], chef de file de tous les pharisiens dont la société de ce temps regorgeait – et non sans quelques adaptations douteuses ou perverses, toujours aussi fastueusement jusqu’à ce jour –, et laissons le dernier mot à Richard Wagner, lui qui sut également se montrer infâme avec Offenbach, confier après la mort[19] de ce dernier, le 1er mai 1882, dans une lettre adressée à son ami Felix Mottl : « … Voyez Offenbach. Il sait faire comme le divin Mozart. Ami, c’est que dans ces choses les Français ont le secret[20]… ».
___________________________________
Portfolio
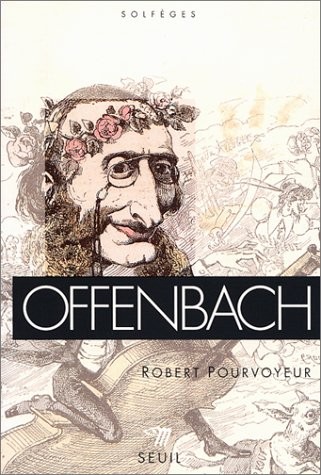 |
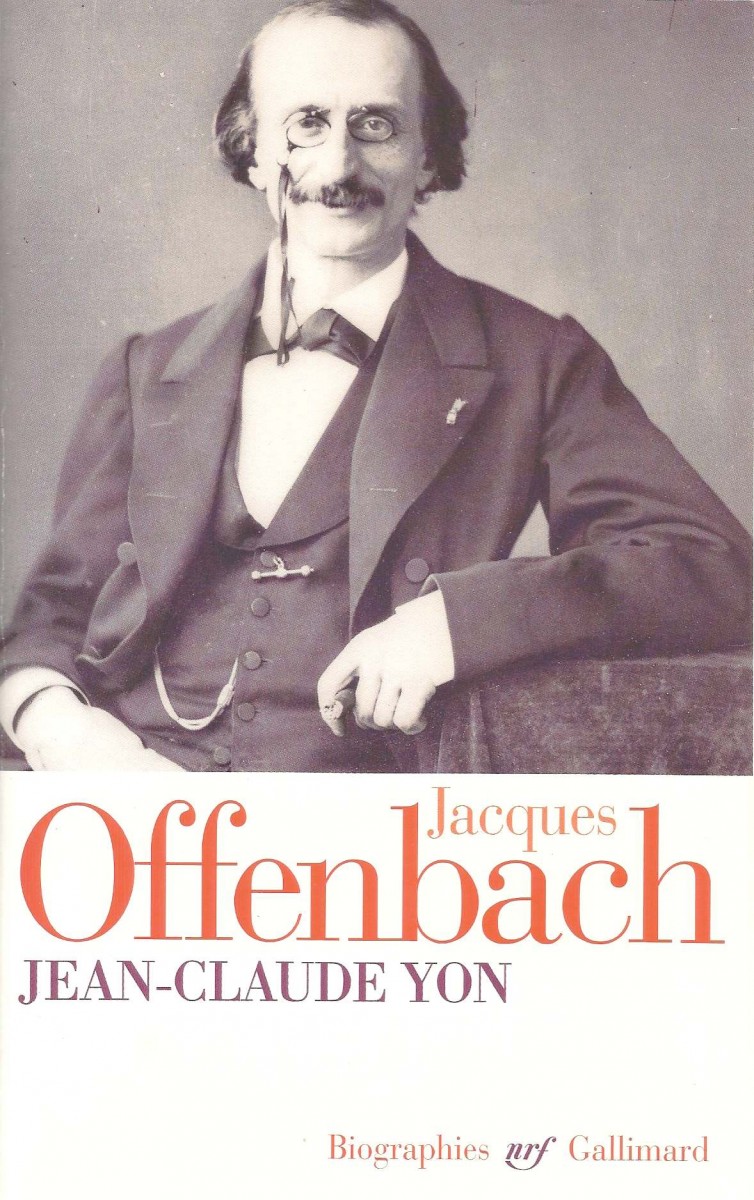 |
|
 |
 |
|
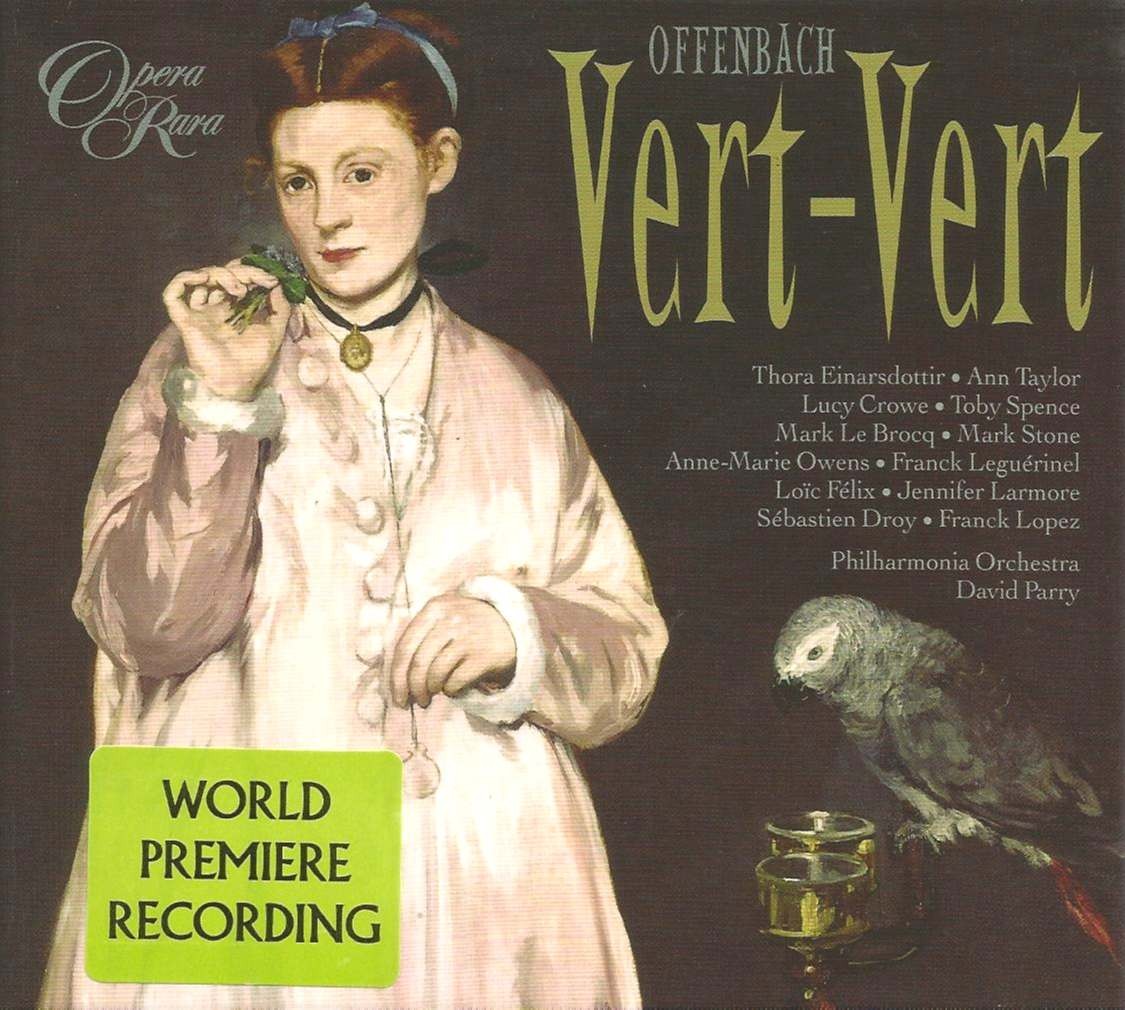 |
 |
|
 |
 |
|
 |
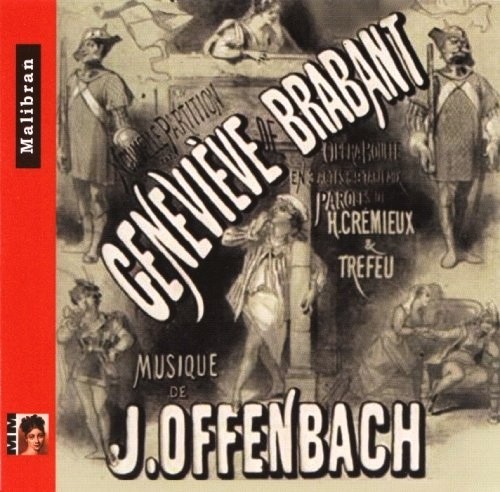 |
|
 |
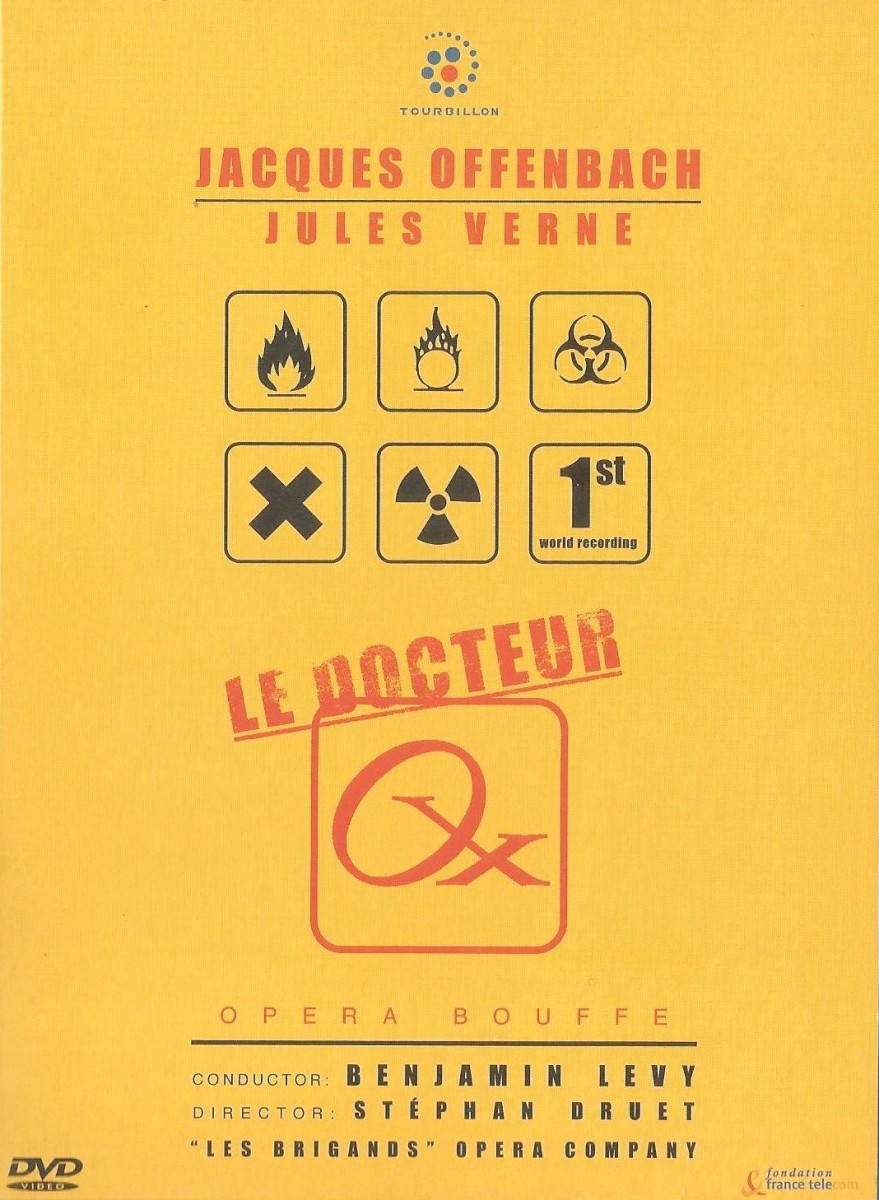 |
|
 |
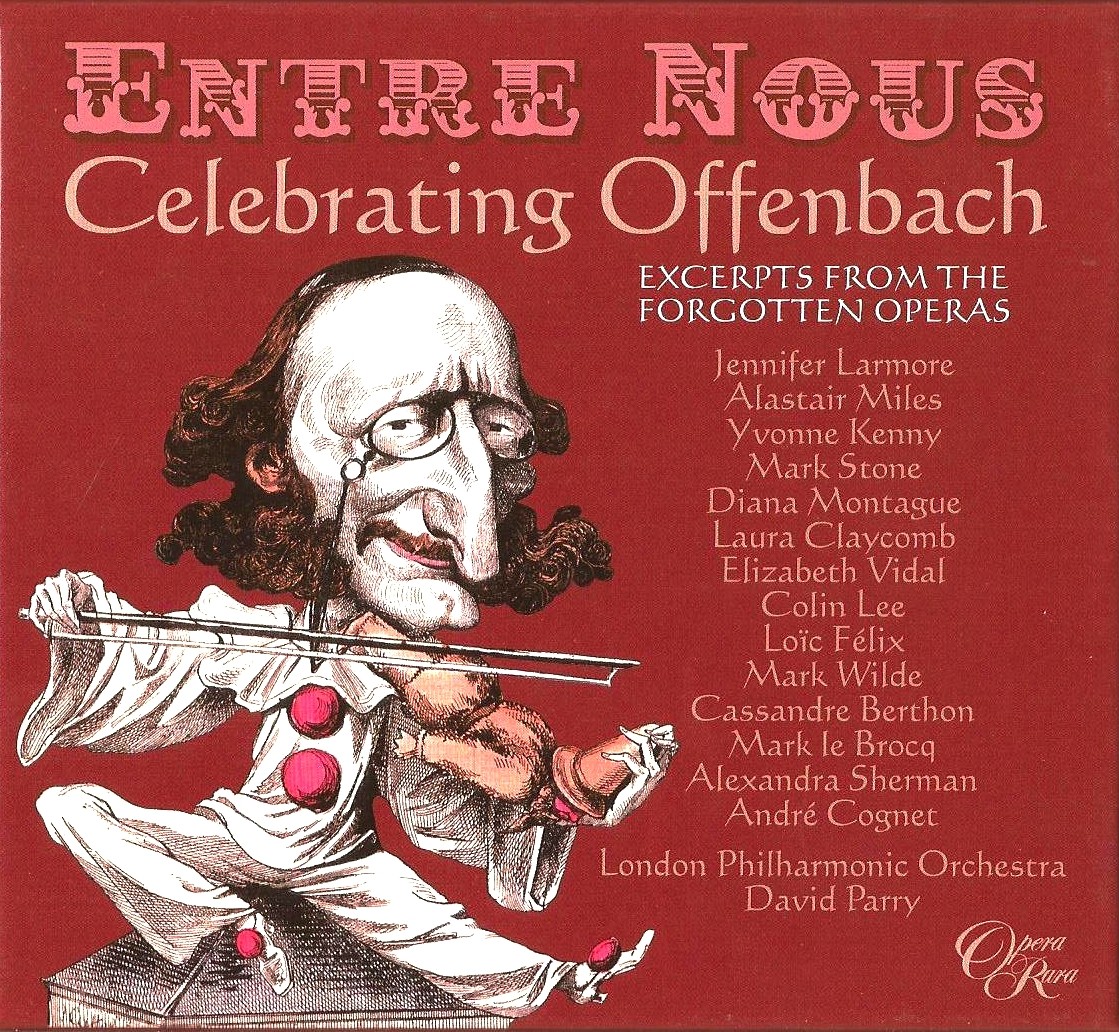 |
|
Partager sur :

